En parcourant un texte de M. de Beaurepaire, nous sommes partis de Vernon à Rouen. Poursuivons ici la route des bacs de Rouen à la mer. Nous aurons surtout pour passeur Jean-Pierre Derouard...
CHOISISSEZ VOTRE LIEU D'EMBARQUEMENT : le bac de Rouen à Croisset, la barque de Croisset, le bac de Croisset, bac de Dieppedalle à la chaussée de Grand-Quevilly, de Petit-Couronne au Val-de-la-Haye, de Grand-Couronne au Val-de-la-Haye, le passage de l'île du Val-de-la-Haye, d'Hautôt-sur-Seine à Grand-Couronne, Trémauville, bac de la Bouille à Sahurs, de Caumont à Saint-Pierre-de-Manneville, bac de Nouret, bac du Val-des-Leux, bac des Saint-Georges-de-Boscherville, le passage de la Fontaine, la chaussée Dupont, le bac de Duclair, le bac d'Yville au Mesnil-sous-Jumièges, le passage de la Roche, le passage du Gouffre, le passage de la Foulerie, le bac de Jumièges, le bac de Yainville, le passage du Trait, le bac de la Mailleraye, le bac de Caudebec, le passage de Villequier, le passage de Courval ou de Vieux-Port, le passage de Quillebeuf, le passage de Tancarville, le bac du Hode, le passage d'Harfleur à Honfleur,
Bac du bassin Saint-Gervais
Il n'a fonctionné que de 1924 à 1926. Qui a une photo ?
Bac de Rouen à Croisset.
 La
confrérie du S.-Esprit et de la Trinité,
fondée en l'église S.-Martin de Canteleu, avait
droit, en vertu d'une ancienne concession confirmée par
charte de l'année 1330, par lettres patentes de Henry V
d'Angleterre, 1440, à tous les deniers perçus
pour le passage des personnes et des marchandises de Rouen à
Croisset et de Croisset à Rouen, le dimanche
après la fête S.-George, le jour de
l'assemblée S.-Gorgon, autrefois fameuse dans le pays. Les
confrères s'adressaient aux juges du bailliage, et
à partir de 1755, au Vicomte de l'Eau, pour faire publier
leur privilège à son de trompe sur les quais de
Rouen et de Croisset. Ce droit est indiqué en termes un peu
différents dans l'aveu de la châtellenie de
Croisset rendu par François de Pardieu, le 12 novembre 1680.
« Les
bateliers qui passent et repassent les hommes, femmes et enfants, le
jour de S.-Jores, sont tenus de bailler la tierce partie de
leur gaing à l'église de Canteleu pour
l'entretien d'icelle. »
La
confrérie du S.-Esprit et de la Trinité,
fondée en l'église S.-Martin de Canteleu, avait
droit, en vertu d'une ancienne concession confirmée par
charte de l'année 1330, par lettres patentes de Henry V
d'Angleterre, 1440, à tous les deniers perçus
pour le passage des personnes et des marchandises de Rouen à
Croisset et de Croisset à Rouen, le dimanche
après la fête S.-George, le jour de
l'assemblée S.-Gorgon, autrefois fameuse dans le pays. Les
confrères s'adressaient aux juges du bailliage, et
à partir de 1755, au Vicomte de l'Eau, pour faire publier
leur privilège à son de trompe sur les quais de
Rouen et de Croisset. Ce droit est indiqué en termes un peu
différents dans l'aveu de la châtellenie de
Croisset rendu par François de Pardieu, le 12 novembre 1680.
« Les
bateliers qui passent et repassent les hommes, femmes et enfants, le
jour de S.-Jores, sont tenus de bailler la tierce partie de
leur gaing à l'église de Canteleu pour
l'entretien d'icelle. »Barque de Croisset

En 1816, ce passage concerne les
communes du Petit-Quevilly et de Canteleu avec un bateau.
1822 : Bailhâtre passager.
1824 : Bazière.
Philippe passager en 1839.
Viger en 1844.
Passage fermé en 1987.
 Bac de Dieppedalle
à la chaussée du Grand-Quevilly.
Bac de Dieppedalle
à la chaussée du Grand-Quevilly. Fermier de 1763 à la Révolution : Jean-Baptiste Delamare. Evincé au profit de Pierre Leclerc en 1792.
1802 : Paschal Gilles.
1811 : Chéron.
1816 : un bateau est attesté, commun aux communes de Grand-Quevilly et Canteleu.
1870 : Mettiez.
1933 : propriété de la famille Deschamps jusqu'en 1909 puis des Ponts-et-Chaussées, l'île Sainte-Barbe disparaît du paysage en 1933 après quelques mois de dragage. Elle tenait son nom du couvent situé en face.
1960 (env.) heurté par une péniche, le bachot coule.
1976 : mise en service du bac n° 19.
Aux termes d'un aveu rendu le 3 mai 1685, Charles d'Estampes avait droit de port et de passage tant à La Bouille, Caumont, Le Nouret et le Val-des-Leux fieffés par ses prédécesseurs avec exemption pour lui, sa maison et ses officiers de ne payer aucun droit de passage. Que reste-t-il de ces bacs de l'ancien régime...
1) le bac de la Bouille à Sahurs...
 |
 |
 |
|
| Il fut d'abord à rame... | ici doté d'un abri | Tracté par une vedette dès 1925 | |
 |
 |
 |
|
| La nouvelle vedette | 1960 : mise en service du n° 11 | Le bac n° 20 arrrive en 1988. | |
1816 : deux bateaux équipent le passage.
1925 : mise en service d'une vedette.
1940 : réalisation des installations de Sahurs.
1960 : mise en service du n° 11, construit aux chantiers Ziegler, Dunkerque. Moteur diesel, 3,4m.
1974 : abandon de la liaison Rouen-La Bouille.
1988 : mise en service du bac n° 20. Le 11 est reconverti en barge.
2022 : inauguration du bac 26 le 6 juillet, lancé aux chantiers Manche Industrie Marine à Dieppe. Marraine : Brigitte Manzanares.
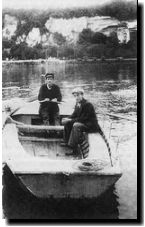
Le passeur, Marcel Agasse, en 1937.
Son passager serait René Briffault.
3) le bac de Nouret...
 |
Entre les communes de Mauny et
de Saint-Pierre-de Manneville.
de 1769 (passeur Charles Moine) à 1886 (Adolphe Capron, dernier passeur, victime de la concurrence du bac de Caumont) :
. |
Bac de S.-George
Concerne Bardouville et Boscherville
Le passeur, Maurice Saumon, sa belle-mère, Louise Mauger, sa femme Rollande et sa fille Mauricette.
Il avait l’obligation de faire prévenir le batelier du couvent la veille de la traversée, celui-ci devait se trouver au port à l’heure convenue, car le sire de Bardouville tenait à ce que l’on ne le fasse pas attendre ; toutes les causes légitimes de retard furent prévues avec un soin minutieux et il fit mettre à sa disposition tous les moyens nécessaires pour n’avoir point à souffrir de la mauvaise volonté du gardien du port.
Hubert Finot : Il y eut de tout temps un passage d’eau reliant les deux rives. Les moines de l’Abbaye en furent très tôt les propriétaires, ainsi que du port très proche. Le passage était loué par baux, le plus souvent à des pêcheurs, appelés « Passagers » résidant dans l’île attenante. Le 1er passage se situait avant le rattachement de l’île à la terre ferme à la hauteur de la propriété de M. Pécot. Le second où se trouve la calle actuelle. Il en existait une 3ème retrouvée récemment dans la propriété de M. Decroix, au pied d’un immense entrepôt disparu de nos jours, elle servait aux transports de cidre, eau de vie, fruits, foin, et abritait un pressoir impressionnant.
Le passage fut très fréquenté non seulement par les Boschervillais et Bardouvillais, mais aussi par les ouvriers agricoles de Roumois attirés par les salaires beaucoup plus élevés dans les filatures de la vallée du Cailly
1771: Louis Perdrix, le passager, s'est noyé.
1802 : Pierre Noël Delahaye, passager.
1812 : Quibel.
1816 : deux bateaux
1850 : Laurent Loisel
1862: Mr Pierre François Roger de Bardouville est déclaré adjudicataire des droits à percevoir du passage et il en a accepté l’affermage. Le 31 décembre 1867 un procès-verbal lui est dressé pour négligence apporté au service du passage, l’entretien des bachots laissant à désirer et le service étant fait le plus souvent par un vieillard ou un enfant de 12 ans.
1868: Le bail du Sieur Roger lui est renouvelé moyennant un loyer annuel de 100 Francs, l’entretien du
matériel étant à sa charge.
Le passage était naturellement payant, le tarif devait être indiqué sur un panneau, celui de 1899 nous renseigne :
- Un piéton 10 centimes, ainsi qu’un vélocipède à 2 roues.
- Une remorque accrochée à un vélocipède 25 centimes.
1877 : Veuve Bazille Letellier.
1931: M. André Mauger d’Hénouville obtient la concession et devient fermier du passage, qu’il exploitera jusqu’en 1944. Il viendra habiter à Bardouville avec sa famille.
1934. M. Guéroult exploite une barque à rame qui fut brisée, son amarre yant été rompue par le passage du steamer Hanseat. Il fit un procès mais fut débouté.
1940: C’est la guerre et l’invasion de la France par l’armée allemande. Mr Mauger est affecté par les
autorités françaises à la surveillance du pont de chemin de fer de Saint-Aubin-lès-Elbeuf. Pendant une
absence d’environ six mois, c’est son épouse Louise qui assure le service du passage, à la rame bien sûr, car à cette époque les bachots ne sont pas motorisés.
1944: Le bail de M. Mauger étant expiré, l’exploitation du passage est vacante.
10 janvier 1944: l’affectation d’un matelot est demandée à la Feldkommandantur par Mr Marcel Haussy
ingénieur en chef des Ponts et chaussées. C’est Mr Pierre Laloyer de Bardouville qui y sera affecté.
1945: Mr Maurice Saumon de Bardouville est affecté comme matelot.
1949: Le 1er juin la concession du passage est attribuée à Mr Joseph Decaux de Bardouville moyennant un loyer annuel de 230 000 Frs. Il assurera le service jusqu’en 1968.
14 mai 1956: Sur un voeu présenté par M. Raymond Brétéché, conseiller général et Maire au Trait, le Conseil Général accepte la motorisation des barques assurant le passage de Saint-Georges ainsi que celui de la Fontaine. Jusqu’à cette date les barques étaient actionnées à la rame. En fait les passeurs avaient tous déjà doté leurs barques (à leurs frais) d’un moteur auxiliaire hors-bord. Le Conseil général reconnaît et officialise cette situation.
1968: Après enquête de l’ingénieur en chef du Port Autonome de Rouen et un comptage discret du trafic effectué à l’insu du passeur, il apparaît que le passage n’est utilisé que par sa famille. Après délibération, la commission départementale décide de sa fermeture définitive le 1er Août 1968.
Dernier passeur : Joseph Decaux. Outre l'usage local il permettait le passage des ouvriers qui travaillaient dans les filatures de la Vallée du Cailly.
J.P. Derouard et G. Fromager : Histoire des bacs de Seine, de l’aviron au moteur.
Le hameau de la Fontaine, au bord de la Seine, se trouve dans sa majorité situé sur la commune d'Hénouville. Une petite partie dont justement le passage d'eau et la chapelle Saint-Anne accrochée à flanc de falaise, appartient à Saint-Pierre de Varengeville.
Ce passage d'eau existe à la Fontaine depuis fort longtemps. En janvier 1362, Philippe Harel, de Barneville, vend à Nicolas Le Couëtte, "huit milliers de tuiles et la fourniture dont il y en aura un miller de tuiles plombées rendues à la Fontaine sur Duclair pour 16 écus à payer à Pâques."
Le chemin de halage qui menait de rouen à Duclair changeait de rive à cet endroit. L'entretien en était à la charge des propriétaires riverains. Entre le Fontaine et l'Anerie, on trouve le sieur Leclerc condamné les 15 mai 1750 et 26 juin 1752 pour non entretien du chemin de halage et, le 23 juin 1752 on trouve le sieur Pigache condamné pour le même motif.
Mais revenons au passage d'eau. Au début du XIXe siècle, il est la propriété de M. de Marivaux, seigneur d'Ambourville,. Le 9 septembre 1780, le passager, c'est à dire le passeur, se nommait Dieppedalle. Il fut condamné pour n'avoir pas fait enregistrer son bail. Le 1er février 1790, le sieur Poullain déclare qu'il n'est pas passager. Par contre, il l'est en l'An 8 lors d'une inspection de la vicomté de l'eau. Le bachot de 19 pieds est au tiers usé. Le 28 vendémiaire An 8, la maison située près du passage est louée pour loger la garde nationale.
Les passeurs
La cale de la rive gauche fut remaniée après guerre et subsistera.
Des jeunes filles se rendirent au manoir d'Ambourville via le passage de la Fontaine le samedi 18 mars 1972 en fin d'après midi. Ce fut la dernière photo du passage (source : Jean-Bernard Seille).
La chaussée Dupont
Le bac de Duclair.
Concerne Berville et Duclair.
1776 : Jean Duramé est passeur. Par ailleurs journalier.
1784 : Le passeur, Nicolas Bardet, ose faire payer le seigneur du Pont. Procès.
1789 : François Feugray.
1799 : Quatre bateaux. Leroux nouveau passager mais aussi la veuve Feugray.
1813 : mise en service d'un bachot à tablier.
1816 : le bac est conduit par la femme et la fille de Désiré Vautier. Naufrage le 27 février.
1817 : Lachèvre passager.
1819 : travaux sur le bac pour 5.500F.
1838 : Delaunay est passeur. Soumis à contribution foncière, il conteste.
1868 : bac à rames de 13,20 m sur 4,30. Contenance : 180 passagers ou 20 têtes de bétail.
1870. Le bac, d'une longueur de 13 m, manœuvré par Savalle est coulé par les Prussiens.
1873 : inauguration du premier bac à vapeur. Longueur: 18 m. Lire :

1888 : Création d'une société anonyme.
1930 : inauguration du bac N° 6.
1940 : le 10 juin le bac se saborde. Renfloué par l'entreprise Cabioch.
1944 : coulé, le bac est remplacé par un remorqueur de Rouen.
1960 : bac N° 8 à vapeur venant de La Mailleraye.
1963 : Le bac N° 8 passe au diésel.
1970 : inauguration du bac N° 14, lancé le 22 mai aux chantiers de Normandie.
1999 : inauguration du 21.
2005 : Le 21 est repeint en blanc.
Le bac d'Yville au Mesnil-sous-Jumièges.

Le passage du port-d'Yville
Le passage de la Roche.

1816 : un bateau.
1863 : Saint-André passager.
1916 : Mme Deshayes batelière.
Fermé en 1972. Notre page spéciale

Les deux maisons de chaque côté du passage sont devenues des gîtes ruraux.
Le passage du Gouffre.
Propriété des moines de Jumièges.
En 1652, il est considéré comme une annexe du passage de Jumièges. Les passeurs sont Nicolas Marc en 1732, François Amand en 1771. Il semble avoir disparu avec la Révolution. On ne le cite pas en 1816.
Source : Jean-Pierre Derouard, Un passage de la Basse-Seine, Jumièges, Les Gémétiques, 1993.
Le passage de la Foulerie
Non cité par Beaurepaire.
Le bac de Jumièges.
Propriété des moines.
Un bac et deux bateaux en 1816.
Portrait de Michel Guyomard

Le passage de la Rue des Iles
Sert surtout aux gens d'Heurteauville pour venir à la grand messe de Jumièges.
Le passage d'Yainville à la grange aux dîmes
Le bac d'Yainville à Heurteauville
voir nos pages spéciales

Le passage du Trait à Heurteauville
En 1816, on ne signale qu'un bac au Trait, celui qui aboutit à Jumièges, autrement dit Heurteauville. Pourtant le bac du Trait à La Mailleraye est attesté en 1817.
Piétons. Attesté au XIVe siècle. Fermé en 1980.
1850 : Jean-Charles Leborgne
1857 : Etrot.
Le bac de La Mailleraye
 Jean de Moy,
seigneur de la Mailleraie, déclarait dans son aveu de 1583
« avoir le droit de bacs et bateaux pour passer le travers de
la rivière à venir et retourner de son
marché qui avait lieu tous les jeudis et de prendre tous les
profits qui y appartenaient». Le 30 avril 1783, la marquise
de Nagu baillait à ferme «
le bac pour passer la rivière devant la Mailleraie, en
embarquant aux endroits les plus commodes, depuis le bourg dudit lieu
jusqu'à la pointe du petit château, et en
débarquant sur la commune du Trait »,
à charge par le preneur de se conformer aux
règlements de l'amirauté et de la Vicomte de
l'Eau, et au tarif des droits fixes par l'arrêt du conseil du
mois d'août 1782. Elle baillait en outre le droit de
transport de toutes les marchandises, de la Mailleraye à
Caudebec et de Caudebec à la Mailleraye, avec
faculté d'embarquer et débarquer depuis le
Rouge-Saule jusqu'au puits Coquerel sous Aiziers du sud.
Jean de Moy,
seigneur de la Mailleraie, déclarait dans son aveu de 1583
« avoir le droit de bacs et bateaux pour passer le travers de
la rivière à venir et retourner de son
marché qui avait lieu tous les jeudis et de prendre tous les
profits qui y appartenaient». Le 30 avril 1783, la marquise
de Nagu baillait à ferme «
le bac pour passer la rivière devant la Mailleraie, en
embarquant aux endroits les plus commodes, depuis le bourg dudit lieu
jusqu'à la pointe du petit château, et en
débarquant sur la commune du Trait »,
à charge par le preneur de se conformer aux
règlements de l'amirauté et de la Vicomte de
l'Eau, et au tarif des droits fixes par l'arrêt du conseil du
mois d'août 1782. Elle baillait en outre le droit de
transport de toutes les marchandises, de la Mailleraye à
Caudebec et de Caudebec à la Mailleraye, avec
faculté d'embarquer et débarquer depuis le
Rouge-Saule jusqu'au puits Coquerel sous Aiziers du sud.1817 : Désiré Vautier passager.
1842 : mise en service d'un grand bac à rames.
1858 : Duramé.
1869 : Lebourgeois passager.
1876 : Edouard Lefranc.
1890 : Aubert
1892 : inauguration le 5 juin du bac à vapeur financé par souscription publique. Il remplace deux bacs pour piétons et bachot plat à rames pour véhicules et bétail. Cale décentrée à Gauville. Long de 22,6 mètres sans les queues et large de 5,2 mètres. L'équipage comprend 4 hommes : un patron, Mauger, un matelot, un mousse et un mécanicien.
1928 : mise en service du bac n° 5, le 1er août.
1944 : le bac est coulé.
1948 : bac n°8 construit chez Dubigeon à Petit-Quevilly. Six hommes d'équipge : un patron, un mécanicien et trois matelots de pont. Les patrons successifs : Amboise Bihannic puis on frère Joseph Bihannic
1960 : à l'arrivée du bac n°10 à Caudebec, le n°9 remplace le n°8 à la Mailleraye qui part remplacer le n°6 à Duclair, retiré du service. Pendant cette période le bac n°7 servait de bac de remplacement.
1977: fermeture du passage
I

Bac de Caudebec.
En 1277, Robert d'Esquetot le jeune, Jean de Nouier et Basire de la Meslerée (la Mailleraie) cédèrent à S.-Wandrille le droit qu'ils avaient sur le bateau de la Mailleraie, moyennant certaine rente, et en se réservant le droit d'usage pour eux, pour leur famille et pour leurs vassaux.
Pierre du Val, seigneur de la Mailleraie, confirma en 1279 la cession faite par Basire de la Meslerée sa mère, par Jean du Nouier et par ses prédécesseurs.
Les bateaux de Caudebec dépendaient de l'office du cuisinier de S.-Wandrille. En 1788, ils rapportaient 200 l. par an. Le tarif du passage avait été augmenté par arrêt du conseil du 6 juin 1663. Parmi les considérations que les religieux firent valoir à l'appui de la requête qu'ils présentèrent à cet effet à l'intendant, quelques-unes méritent d'être signalées.
Ils soutenaient que lors de la fixation des droits qui avait eu lieu, il y avait près de 140 ans, le port et passage de Caudebec était fort facile et de peu de distance, en sorte que l'on se parlait de bord en autre, et que les bacs et petits bateaux en ce temps servaient audit passage, au lieu que pour le présent l'impétuosité de la mer ayant ruiné et mangé toutes les terres voisines, le passage avait une demi-lieue de largeur et était devenu très-difficile ».
Les petites barques d'autrefois ne pouvaient plus servir ; il fallait de grands bateaux, et il était nécessaire de trois ou quatre personnes là où une seule suffisait jadis. Vers le milieu du XVIIIe siècle, ils sollicitèrent une nouvelle augmentation des droits de bac, en alléguant les difficultés du passage, la largeur de la Seine, qui, vis-à-vis de Caudebec, n'avait pas moins, de 396 toises, la nécessité de construire des bateaux de 700 à 800 l. qui pussent résister à la barre et à l'impétuosité des tempêtes. Ces raisons parurent plausibles, le tarif fut encore une fois réformé par arrêt du conseil du 29 aout 1778.
Les moines de S.-Wandrille soutenaient qu'il ne devait point y avoir d'autres bateaux que les leurs entre le Trait et Etelan. Le 9 juin 1485, un bateau, établi par Colard de Moy, seigneur de la Mailleraie, avait été sequestré. Cependant nous voyons en 1686, Angélique de Fabert, veuve de François de Harcourt, dame de la Mailleraie, renouveler ces prétentions et établir plusieurs bateaux de la Mailleraie à Caudebec.
15 janvier 1792 : le bac apporte à Caudebec 50 agriculteurs chargés de denrées. Quand il sombre. 18 sont ramenés à terre mais meurent tous dans les bras des médecins. Le passeur est mis en cause. Son navire était en mauvais état et il n'a pas hésité à le surcharger pour gagner plus...
1856 : bac à voile et à rame de 15m.
1868 : premier bac à moteur, L'Union coque en bois.
1890 : le bac est détruit par le mascaret. Mise en service de L'Union des Deux Rives, coque acier.
1925 : bac n°4 à hélice.
1935 : bac n°7, construit aux chantiers du Trait.
1940 : le bac est coulé.
1944 : le 25 août voit l'exode de l'armée allemande, le 2 septembre la noyade de 14 soldats du 2e bataillon des South Wales borders. Deux corps, dont celui d'un ecclésiastique, seront repêchés vers le bac piéton d'Heurteauville au Trait, non loin de la ferme d'Emile Seille qui les enterra. Ces tombes de fortunes furent régulièrement profanées par des jeunes de la rive droite croyant avoir affaire à des sépultures allemandes.
Coulé, le bac est remplacé par la Marmotte jusqu'en 1947. Réparé, le n°7 servira de bac de remplacement jusqu'en 1969.
1949 : bac n°9 lancé chez Dubigeon, Petit-Quevilly.
1960 : mise en service du bac n° 10, construit à Villeneuve-la-Garenne.
1977 : fermeture du passage. Le bac sert de remplaçant à celui de Duclair de 1977 à 1999 puis prend la direction du musée de Caudebec.
 Passage de Villequier
Passage de VillequierPassager en 1870 : Desmarest.
Cale rive gauche, appontement rive droite.
 Passage
de Courval
Passage
de Courval ou de Vieux-Port.
 Plus tard
ils cédèrent ce passage
à Cossé, comte de Brissac,
maréchal de France, auquel appartenait la seigneurie
d'Etelan. On voit par l'aveu de François d'Epinai S.-Luc,
petit fils du comte de Brissac, que le seigneur d'Etelan avait alors
pour le port de Corval, autrement
dit de Thuit, «
le droit de descente sur toutes les terres d'environ, tant d'un
côté que d'autre, quand il n'y avait sur sa terre
aucune
propre et convenable descente, et que tous les hommes de Norville
étaient francs audit passage, s’ils
n’étaient
marchands, en payant un tourteau et deux deniers à
Noël et
en août une gerbe de blé»
Plus tard
ils cédèrent ce passage
à Cossé, comte de Brissac,
maréchal de France, auquel appartenait la seigneurie
d'Etelan. On voit par l'aveu de François d'Epinai S.-Luc,
petit fils du comte de Brissac, que le seigneur d'Etelan avait alors
pour le port de Corval, autrement
dit de Thuit, «
le droit de descente sur toutes les terres d'environ, tant d'un
côté que d'autre, quand il n'y avait sur sa terre
aucune
propre et convenable descente, et que tous les hommes de Norville
étaient francs audit passage, s’ils
n’étaient
marchands, en payant un tourteau et deux deniers à
Noël et
en août une gerbe de blé»
A la fin du 18ème, le passage de Vieux-Port, dépendant de la terre d’Etelan appartenait au comte de Jonsac, lieutenant général des armées du Roi. Les droits y étaient ainsi de : 2 sous pour une personne à pied, 1 sou pour un homme et un cheval, 4 sous pour les chevaux de foire, 3 livres Pour une chaise avec les chevaux, 3 sous pour un colporteur qui a une balle sur le dos.
En 1755, le bac de Vieux-Port était affermé 500 livres par an. Il existait en outre un passage de Vieux Port à Caudebec-en-Caux ; il appartenait au Roi qui le fieffait à bail.
1774 : François Dubosc passager.
En 1803, surchargé, le bac de Saint-Maurice d'Etelan coule. Huit morts, trois chevaux disparus.
1813 : Lemarié passager.
1898 : le conseil général de l'Eure autorise la vente du petit bac pour 30 F.
1910 : ALexandre Lefieux.
Dans sa séance du 28 avril 1911, le département de la Seine-Inférieure adopte cette délibération : La subvention actuellement versée au fermier est de 1,050 francs, répartie par moi-tié entre l'Eure et la Seine-Inférieure. Pour la gratuité des piétons à ce passage, l'augmentation demandée était de 1,250 francs, soit en totalité une charge annuelle de 1,150 francs pour chacun des deux départements.
La Commission interdépartementale a estimé qu'il y avait lieu d'adopter ce chiffre et a décidé de proposer aux deux Assemblées départementales la gratuité du passage de Vieux-Port à ces conditions.
Conseil général de l'Eure, 26 septembre 1927, M. Le Mire : « Je vous avais demandé, il y a quelques années, de consacrer la reconstruction du bac à voitures de Vieux- Port, tombé en pourriture sur l'une des berges de la Seine, et qui avait été supprimé par extinction si l'on peut dire.
Je m'y étais rendu, il y a une quinzaine d'années,' et j'ai pu constater l'es faits. Ce bac était cependant très utile, comme je l'ai exposé, car il permettait aux cultivateurs et aux herbagers des deux rives, du côté de Saint-Maurice-d'Etelan et du côté de Sainte-Croix-sur-Aizier, d'avoir des communications faciles. Vous avez voté quinze mille francs pour que ce bac soit rétabli ; or, depuis un an, les ponts et chaussées, l'Etat, avec une participation très importante de la Chambre de commerce de Rouen, ont décidé de poursuivre l'exécution de travaux très importants sur les deux berges de la Seine, entre Vieux-Port et Aizier. La conséquence de ces travaux a été une modification du régime des eaux et des courants dans la basse Seine à cet endroit. Au moment de l'arrivée de la marée montante, le courant est tellement violent qu'un bac à rames risquerait d'être emporté. Le passage pourrait être très difficile, très pénible, il faudrait, tout au moins, avoir des hommes supplémentaires et, momentanément, quatre rameurs au lieu de deux. Si bien que le service des Ponts et Chaussées à envisagé l'emploi d'un moteur léger appelé motogodille, moteur qui peut être mis d'un côté ou de l'autre d'un bateau et servir, suivant son orientation, à faire avancer celui-ci ou à le faire « étaler son aire » comme l'on dit, c'est-à-dire s'arrêter. Ce serait moins coûteux qu'un canot automobile (ainsi que cela a été fait à la Bouille, à Yainville) et cela permettrait d'assurer la traversée du bac. Il ne s'agirait que d'une dépense de 10,200 francs et la Seine-Inférieure nous, a demandé, suivant les usages antérieurs, de prendre, à notre charge, la moitié de cette dépense.
1914 ; Depuis son remplacement par une pirogue, le grand bac de Vieux-Port est devenu sans utilité et la vente en a été décidée d'accord entre les deux services intéressés.
Malgré les diligences faites, une seule soumission a pu être recueillie. Elle émane de M. Larcier (Charles), demeurant à Vieux-Port, qui s'est engagé à acquérir ce bateau hors d'usage, moyennant la somme de 10 francs.
Mai 1935. Messieurs, vous êtes saisis du voeu suivant déposé par MM. Louis Leloup et Briquet :
En raison des nombreuses pétitions des usagers éventuels d'un bac à voitures à mettre en service au passage d'eau de Vieux-Port, dont ont été saisis les signataires du présent voeu, ceux-ci émettent le désir de voir l'étude du rétablissement dudit bac reprise au cours de la présente session. (question ajournée).
1938 : lle rétablissement du bac est ajourné. La dépense est démesurée rapportée au nombre de voitures concernées.
Entre Vieux-Port et Petitville. Piétons. Fermé en 1953. M. Quintric fût le dernier passeur.
Passage d'Aizier à Caudebec
Au 18ème siècle, le passage de Vieux-Port fut pendant quelques années concurrencé par le service d’Aizier à Caudebec appartenant à l’abbaye de Fécamp. Celle-ci l’avait donnée gratuitement peu avant 1786.
Louis Rachet, propriétaire du bâtiment le Saint-Louis, eu égard à ce qu’il avait eu les deux jambes coupées dans un combat sur les vaisseaux du Roi pendant la guerre d’Amérique. C’était la seule ressource que ce malheureux avait pour vivre. Avec ce bateau, Louis Rachet faisait le transport des marchandises d’Aizier à Caudebec et de Caudebec à Aizier.
Pendant plusieurs années, Rachet put pratiquer tranquillement son petit trafic. Saugrain, alors fermier du passage de Vieux-Port et environs à Caudebec, n’avait jamais cherché à lui susciter la moindre entrave. Mais le 20 octobre 1786, le passage de Vieux-Port à Caudebec est affermé moyennant 40 livres par an à Jean Saffrey. Celui-ci ne vit pas du même oeil la concurrence que pouvait faire à son entreprise le bateau de Rachet et le 13 octobre 1787, il s’opposait à Caudebec au chargement de blés que faisait Rachet, sur «le Saint-Louis», à destination d’Aizier. Rachet protesta par une clameur de haro et un procès fur engagé. Le propriétaire du passage d’Aizier exposa qu’il avait toujours conduit son bateau sous les passeports de l’amirauté de Quillebeuf sans jamais avoir été troublé par les prédécesseurs de Saffrey. Le passage d’Aizier à Caudebec ne pouvait d’ailleurs avoir rien de commun avec celui de Vieux-Port à Caudebec ; ces deux passages étaient distincts et indépendants l’un de l’autre et Rachet n’avait jamais rien entrepris pour troubler Saffrey ou ses prédécesseurs.Le propriétaire du passage d’Aizier soutenait en outre que le bail de Saffrey était illégal, n’ayant pas été fait «au plus offrant et dernier enchérisseur», ce qui au lieu de 40 livres, l’aurait fait monter à 150 et plus. Le domaine prit fait et cause pour Saffrey et produisit même un long mémoire pour appuyer ses conclusions, qui ne tendaient à rien moins qu’à la suppression du passage d’Aizier. Nous ne savons ce qu’il advint de ce procès
Passage de Quillebeuf.
Le sieur Froville s'est rendu adjudicataire du bac affecté à la traversée de la Seine, de Quilleboeuf à Lillebonne. — L'article 25 du cahier des charges porte qu'il pourra poursuivre, conformément aux art: 56, 57,. 58, 59, 60 et 61 L. 6 frim. an VII, à ses risques et périls,, toute personne qui se soustrairait au paiement des sommes portées au tarif, — « ou qui, sans autorisation préalable et dans les limites du port du bac, établirait un-bateau particuïer; ainsi que celle qui, après avoir obtenu une autorisation, se servirait de son bateau pour passer ; moyennant rétribution; des personnes éltangères à sa famille et à son exploitation. —A plusieurs kilomètres.de-Qnillebeuf
se trouve le bac de vieux port.
Eh 1853, Ozanne se servit du bateau que l'administration l'avait autorisé à avoir sur la Seine pour transporter de Quillebeuf à Vllliquier neuf personnes, au nombre. desquelles.se trouvaient six marins. —-Froville crut voir dans ce fait une atteinte à ses droits, et réclama le paiement de la somme de 5 fr. 40 c. à laquelle il fixait la rétribution que lui eût procurée le transport de ces neuf personnes. —Cette demande fut accueillie succèssivement par le juge de paix de'Quilïebeuf et par le lrib.civ. de Pbnt-Audemer-—Pourvoi en cassation. Résultat :
Attendu qu. le trib.. de Pont-Audemer, pour condamner Ozanne aux dommages etntérêts vis-à-vis de Froville, fermier du bac de Quillebeuf s'est uniquement fondé sur ce que le droit exclusif du locataire d'un bac n'avait pas d'autre limite, que celle résultant, dit droit du locataire du bac voisin, et sur ce que l'espace d'eau compris entre les. deux bacs devait être divisé par moitié entre chacun d'eux. —Attendu qu'aucune disposition d loi ne donne une pareille extension au privilège de l'adjudicataire d'un droit de bac ; qu'il résulte, au contraire, de l'art. 25 du cahier, des charges dressé dans l'espèce, en exécution de la lo idu 6 frim. an VII que le fermier ne peut, conformément aux art. 56, 57, 58, 60 et 61 de cette-loi poursuivre les contraventions à son droit qu'autant qu'elles auraient-été commises dans lès limites du port du bac, dont l'étendue, aux termes de l'art 12 du même cahier des charges, doit être déterminée par l'ingénieur en chef et indiquée par des bornes que l'adjudicataire doit faire placer à ses frais — Que le jugement attaqué ne constate aucune contravention commise par Ozanne dans l'étendue du port du bacde Quillebeuf; qu'il ne relève même aucun fait qui, en dehors de celte étendue, aurait pu présenter les caractères d'une concurrence frauduleuse ; d'où suit qu'en condamnant Ozanne à des dommages-intérêts envers Froville, ce jugement a fait une fausse application de l'art. 1382- C. N. et formellement violé les art. 56 et 57 de la loi du 6 frira, an VII ; — Casse.
1873 : premier bac motorisé à vapeur, roues à aubes.
1908 : l'Ampère, bac à électricité et moteurs à essence.
1930 : bac à vapeur et à hélice.
1959 : l'ouverture du pont de Tancarville suscite la création d'une association de défense du bac.
1970 : bac n° 13, quatre moteurs diésel entraînant quatre propulseurs Shottel. Marraine : Mme Michel Dubosc. Lancé aux chantiers de Normandie à Grand-Quevilly le 26 janvier.
1987 : projet de remplacement du bac par un passage pièton assuré par une vedette.
2011 : bac n° 23. Inauguration le 12 février à la cale de Port-Jérôme.
2017 : projet de nouveau bac entre Quillebeuf et Port-Jérôme financé à parts égales par les deux départements concernés.
2021 : Inauguration du bac n° 24 le 20 avril, lancé par Merré, de Nord-sur-Erdre, mis à l’eau le 14 décembre 2019 et baptisé le 3 juin 2020 à Saint-Nazaire. Marraine : Virginie Carolo-Lutrot, maire de Port-Jérôme.
Passage de Tancarville.
Concerne les commune de Larocque (Eure) et Tancarville.
 Le
comte de Tancarville avait «
droit de nef ou bac et passage d'une rive à l'autre de
ladite rivière et du havre de Tancarville à
Quillebeuf, de S.-Jacques du Val-Ullin à Grestain et
à la Rille et d'Oudale à Honfleur et S.-Sauveur,
pour porter et rapporter toutes personnes, marchandises et bestiaux, en
payant par chacune personne 2 s., pour chaque cheval ou vache 5 s.,
pour chaque porc 3 s., pour chaque mouton 2 s., pour chaque cent de
marchandises 3 s. » Les
comtes avaient donc trois bacs : un au
pied du
château, un à
Saint-Jean du
Val Hulin et le
troisième à
Oudale.
Le
comte de Tancarville avait «
droit de nef ou bac et passage d'une rive à l'autre de
ladite rivière et du havre de Tancarville à
Quillebeuf, de S.-Jacques du Val-Ullin à Grestain et
à la Rille et d'Oudale à Honfleur et S.-Sauveur,
pour porter et rapporter toutes personnes, marchandises et bestiaux, en
payant par chacune personne 2 s., pour chaque cheval ou vache 5 s.,
pour chaque porc 3 s., pour chaque mouton 2 s., pour chaque cent de
marchandises 3 s. » Les
comtes avaient donc trois bacs : un au
pied du
château, un à
Saint-Jean du
Val Hulin et le
troisième à
Oudale. Si quelqu'un contrevenait ou usurpait ledit passage, son bateau était confisqué au profit de la seigneurie, et les conducteurs étaient condamnés en amende arbitraire (1464). Ces droits furent confirmés par un arrêt du conseil d'État du 30 mars 1780.
Un bateau est attesté en 1816.
Le passage de Tancarville disparut avec l'endiguement réalisé entre 1859 et 1866. Mais la maison du passeur subsista tandis que s'éloignait d'elle le cours de la Seine.
Bac du Hode
 A
la fin des années 20, l'association des bacs de Basse-Seine
revendique la création d'un bac en aval de Tancarville,
entre le
Hode et
Berville-sur-Mer. Il sera en service en service de 1932 à 1944 et de 1949
à 1959.
En 1946, l'ancien bac fut renfloué pour être
remanié
aux Chantiers de Normandie. Un impressionnant pont
métallique
conduisait les véhicules de la rive droite au bac.
Condamné
par le pont de Tancarville. Cédé au Yacht
Touring-club de Rouen, le bac servira de ponton
plus de dix ans au pied du pont Boieldieu, quai rive gauche. La route
et l'abri piétons ont subsisté. En 2016, une
navette
relia Trouville au Havre.
A
la fin des années 20, l'association des bacs de Basse-Seine
revendique la création d'un bac en aval de Tancarville,
entre le
Hode et
Berville-sur-Mer. Il sera en service en service de 1932 à 1944 et de 1949
à 1959.
En 1946, l'ancien bac fut renfloué pour être
remanié
aux Chantiers de Normandie. Un impressionnant pont
métallique
conduisait les véhicules de la rive droite au bac.
Condamné
par le pont de Tancarville. Cédé au Yacht
Touring-club de Rouen, le bac servira de ponton
plus de dix ans au pied du pont Boieldieu, quai rive gauche. La route
et l'abri piétons ont subsisté. En 2016, une
navette
relia Trouville au Havre. Passage d'Harfleur à Honfleur
| La
voiture d’eau La voiture de Rouen à Duclair et à Caudebec servait surtout au transport des blés et des boissons. Elle appartenait, en 1670, à un nommé Pierre de Saint. Une sentence de Pierre Duval, Vicomte de l'Eau, fit défenses aux voituriers, mariniers, bateliers et marchands d'employer d'autres gribannes et bateaux que ceux de Pierre de Saint, et de procéder ailleurs qu'au siége de la Vicomté de l'Eau pour les affaires concernant ladite voiture. Vers la fin du XVIIIe siècle elle partait de Caudebec chaque samedi, pour arriver à Rouen le mercredi suivant, ou au plus tard le jeudi, conformément à un arrêt du parlement, du 12 mars 1694 |
(*) CROISSET ; DIEPPEDALLE ; GRAND-COURONNE ; LA BOUILLE ; CAUMONT ; VAL DES LEUX ; SAINT-GEORGES ; DUCLAIR ; LA ROCHE ; JUMIEGES ; LE TRAIT ; LA MAILLERAYE ; CAUDEBEC ; VILLEQUIER ; VIEUX-PORT ; QUILLEBEUF.
En 1875, le département de la Seine-Inférieure compte 28 passages d'eau :
1° Freneuse;
2° Fourneaux;
3° Tourville-la-Rivière ;
4° Port-Saint- Ouen;
5° Saint-Adrien;
6° Amfreville-la-Mivoie;
7° Eauplet;
8° Croisset;
9° Val-de-la-Haie ;
10° Petit-Couronne;
11° Sainte-Vaubourg;
12° La Bouille;
13° Saint-Georges;
i4° Villequier;
15° Dieppedalle;
16° Duclair et annexe de la Fontaine ;
17° La Roche et annexe d'Yville ;
48° Jumiéges;
19° Le Trait et annexe d'Yainville ;
20° La Mailleraye ;
21° Caudebec;
22° Vieux-Port et annexe d'Aizier ;
23° Quillebeuf et Port-Jérôme.
Les 14 premiers de ces passages appartiennent à l'Etat. Les sept suivants au département de la Seine-Inférieure; Les deux derniers sont communs aux départements de l'Eure et de la Seine-inférieure.
« Ces divers passages sont desservis par des bacs, ou bateaux dont plusieurs sont à vapeur, ce sont ceux de Duclair, Caudebec et Quillebeuf; partout le service est convenablement fait. Le besoin d'autres passages ne s'accuse point, totefois, M. l'ingénieur en chef de la troisième section fait connaître que le rétablissement du passage de Bédanne est demandé par le hameau de Bédanne et les communes de Tourville et d'Oissel, mais que ces localités ne sont pas d'accord sur l'emplacement à lui assigner, l'affaire est à l'instruction.
LISTE DES BACS EN SERVICE AU 1er janvier 2007
BAC n°13 : Quillebeuf - Port Jérôme depuis 1970 (28 places)
BAC n°14 : bac maritime de remplacement (28 places) (à Duclair de 1970 à 1999)
BAC n°15 : bac fluvial de remplacement (10 places) (à Petit Couronne avant 2006)
BAC n°16 : Yainville - Heurteauville (10 places)
BAC n°17 : Jumieges - Heurteauville (10 places)
BAC n°18 : Mesnil sous Jumieges - Yville sur Seine (10 places)
BAC n°19 : Dieppedalle - Le Grand Quevilly (10 places)
BAC n°20 : Sahurs - La Bouille depuis 1988 (12 places)
BAC n°21 : Duclair - Berville sur Seine depuis 1999 (35 places)
BAC n°22 : Val de la Haye - Petit Couronne depuis 2006 (12 places)
● Vernier, considérations sur les bacs dans le bulletin de la commission des Antiquités, 1er janvier 1915, p. 327. Lire
● Jean-Pierre Derouard, historien des bacs de Seine, toute sa production est recommandée..
● Le site des Usagers des bacs de Seine a malheureusement fermé. Jean Bernard Seille lui a substitué deux nouveaux blogs. http://seille.over-blog.com/ et http://chateaudhautot.over-blog.com/
● Les bacs de Vernon à Rouen :

● Nos photos de bacs

Délibérations des conseils généraux de la Seine-Inférieure et de l'Eure.
Journal de Rouen,
J'an-Pierre Derouard, œuvre intégrale.
Usagers des bacs de Seine (Jean-Bernard Seille).
Le Pilote de Caudebec
Le Journal de Rouen.
Vos réactions
Seeley : je recherche des renseignements sur le bac des fourneaux à Orival.





