Par Laurent Quevilly
Les
pièces comptables épargnées par la
tourmente
révolutionnaire nous renseignent sur la vie quotidienne de
l'abbaye jusqu'à sa dernière heuren, le lien qui
l'unissait avec la population. De Jumièges et d'ailleurs...
Le récit que nous nous proposons de mener ci-dessous est la compilation de deux sources principales.
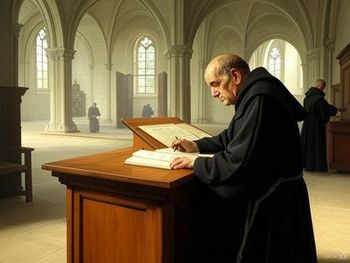 André Dubuc fit une communication lors du
congrès
de 1954
en s'appuyant sur le registre capitulaire conservé sous la
cote
9 H 33 aux archives départementales et sur des liasses des
séries série L (district de Caudebec-Yvetot et Q
(district de Caudebec).
André Dubuc fit une communication lors du
congrès
de 1954
en s'appuyant sur le registre capitulaire conservé sous la
cote
9 H 33 aux archives départementales et sur des liasses des
séries série L (district de Caudebec-Yvetot et Q
(district de Caudebec).René Bruneau fit une communication lors du congrès de Caudebec, en 1978, en précisant: "Les Archives départementales de la Seine-Maritime conservent sous les cotes 9 H 64 à 76 une partie des registres de comptabilité de l'abbaye de Jumièges, de 1783 à 1790."
Trois sortes de registres étaient tenus :
- le registre de cellerie (le cellérier était chargé des recettes) ;
- le registre de sous-cellerie, qui constitue une sorte de comptabilité-matières, et comporte l'inventaire en fin d'année ;
- le registre de dépositairerie (le frère dépositaire ayant à régler les dépenses - ou mises - de la communauté).
Pour mieux apprécier l'analyse de cette comptabilité tenue au jour le jour, vérifiée chaque trimestre par le père prieur et les frères senieurs, qui jouaient donc le rôle de commissaires aux comptes, il faut se souvenir qu'au début de 1789, la communauté ne comptait plus que 16 moines. L'abbé commendataire, neveu du cardinal Loménie de Brienne, venait d'être désigné par le roi. Ce clerc tonsuré, âgé de 15 à 16 ans, vint à Jumièges prendre possession de ses fonctions, et repartit aussitôt.
| Controverse | En 1965, l'Académie de Rouen contesta la venue de Loménie à Jumièges telle qu'elle fut rapportée par Emile Savalle. Elle prétend qu'il a alors 25 ans, n'est plus clerc tonsuré mais prêtre et qu'il séjourne depuis la fin de 1788 à Nice. |
Il est vrai que son prédecesseur, François-Camille de Lorraine, abbé nommé par le roi le 23 mars 1760, ne mit jamais les pieds dans son abbaye en 29 ans d'abbatiat !
Il se contentait d'encaisser les revenus de la mense abbatiale (80.000 livres, c'est à dire les 2/3 du total). Outre les moines, nous dit Savalle, l'abbaye abritait « toute une colonie de frères lais, des jardiniers, des menuisiers, des serruriers, tailleurs, infirmiers, et au dehors, on occupait encore, pour les travaux agricoles dans les fermes, des charretiers, vachers, batteurs en grange. Les enfants de chœur étaient élevés, entretenus, instruits dans la maison, et plus tard, s'ils paraissaient intelligents, ils devenaient, poussés par les moines et aux frais de ceux-ci, organistes ou prêtres. »
Enfin, l'abbaye avait à faire face à ses obligations charitables : « Tous les matins, vers 10 heures, la grande porte du monastère était ouverte à deux battants et une centaine de pauvres gens en guenilles entraient dans le préau : là, avait lieu, sur l'herbe, en plein air, devant les bâtiments conventuels, en présence du prieur, une distribution de soupe dans des écuelles de bois, puis une autre distribution de linge et d'habits provenant du vestiaire de la maison abondamment garni. Le dimanche, le prieur, suivant encore en cela la règle de la communauté, distribuait 12 sols à chaque pauvre. » (Deshayes, Histoire de l'abbaye royale de Jumièges).
LES REGISTRES DU CELLÉRIER
Pendant toutes ces années, le cellérier est Dom Saulty. Les religieux de Jumièges justifient la remarque ironique de Voltaire : « Les Bénédictins veulent qu'on leur donne du Dom ». Leur nom propre en est toujours précédé, comme leur signature, sauf en 1790, lorsqu'ils passeront sous le contrôle de la municipalité. Dom de Saulty semble avoir pris ses fonctions à la suite de difficultés concernant son prédécesseur, puisqu'il note : « Dom de Rouvray, ancien cellérier de l'abbaye de Jumièges, a emporté à son départ le journal de la cellerie, celui de la sous-cellerie et le cahier de dépôt. Son successeur, qui n'a pu rien statuer de positif sur les sommes qui ont été perçues précédemment, ne peut que rendre compte de la recette qu'il a faite depuis sa gestion qu'il a commencée le 18 d'octobre 1783, et se propose de rendre un compte général lorsqu'il plaira à dom de Rouvray de luy renvoyer les journaux dont il a besoin. »
Notons que le registre de cellerie tenu par Dom de Rouvray figure dans la liasse : il a donc été restitué. Dom de Saulty, lui aussi, interrompra brutalement ses fonctions en 1788. En effet, nous dit encore Deshayes, « de Saulty fut envoyé en disgrâce peu de temps avant la Révolution, à Saint-Etienne de Caen, pour avoir jeté les yeux sur une très belle fille du bourg, Mademoiselle D... » Du moins, arrêta-t-il soigneusement ses comptes avant son départ. Cependant, les signatures habituelles ne sont point apposées. On peut mettre à l'actif de Dom de Saulty un certain soin dans la tenue de ses registres et noter que les choses se dégradent avec son remplaçant. Les recettes sont comptabilisées par chapitres :
I. Aux recettes ordinaires, figurent essentiellement :
- les fermages provenant des biens situés à Jumièges, au Mesnil, à Heurteauville, au Torp, à Yainville ;
- les loyers d'une douzaine de maisons et de granges ;
- de nombreuses dîmes ;
- le revenu des moulins de Jumièges (l'ancien et le moulin de pierre) ;
- le revenu du passage d'eau, qui est affermé ;
- le produit des terres fieffées ;
- des rentes.
Ces recettes ordinaires varient, pour les années 1784 à 1788, de 39.546 livres à 41.623 livres, et représentent de 50 à 60 % des rentrées.
II. Les reprises sont les restes à recouvrer de l'année précédente et portent sur les mêmes bases.
| 76.969 livres | C'est, en janvier 1784, le montant des dettes de
l'abbaye envers divers particuliers et commerçants. En revanche, ses fermiers lui en doivent 4.696. Mais les moines ne furent jamais férioces envers leurs débiteurs et acceptaient – |
III. Les restats sont les restes à recouvrer des années antérieures. Il s'agit de faibles sommes (162 à 425 livres) où figure notamment une rente provenant du domaine de Caen et Bayeux.
IV. Au casuel, figurent les recettes inattendues, encore qu'assez substantielles. Elles plafonnent à 20.643 livres en 1785 (soit 25% des ressources) pour tomber à 6.807 livres en 1787 et à 5.652 livres en 1788 (8 %). On y trouve surtout des pots de vin sur les baux des fermes, terres, maisons, sur les fieffes (moulin de Jumièges ou d'Ouezy, hôtel de la Poterne à Rouen, passage de la Roche), sur les dîmes.
Chaque bail nouveau ou renouvelé donnait lieu en effet au versement par le preneur d'une somme parfois modeste, parfois rondelette (1.800 livres pour la ferme du manoir du Mesnil). On y trouve encore :
- le produit de ventes : 3 acres de terre, une vieille voiture, des coupes de bois, etc.
- le versement des treizièmes (droit s'élevant à la treizième partie de la valeur de certaines transactions) ;
- le gain de procès : c'est le frère procureur, chargé de représenter la communauté en justice, qui reverse ces sommes ;
- des rentes faites à l'abbaye ;
- les versements du directeur des Aides de Rouen « pour les droits que la maison perçoit sur la ferme pour l'entrée de nos vins de Longueville ».
Au chapitre V, figurent les espèces vendues : il s'agit essentiellement d'animaux,
- cédés au boucher : veaux, chevaux, porcs, et même « une vieille vache » ;
- ou vendus dans les foires ou à des particuliers.
Quelques prix :
- un taureau : 84 à 125 livres ;
- une jument : 150, 384, et même 450 livres (au cellérier du Bec) ;
- une vieille jument : 80 livres ;
- un cheval poussif : 72 livres.
L'aigle (le lutrin) est cédé pour 373 livres, mais l'acquéreur n'est pas désigné. 23 bouteilles de vin de Champagne sont cédées au cellérier du Bec pour 49 livres 9 deniers.
VI. Les emprunts. Faute de documents, il n'est pas possible de comparer les recettes et les dépenses d'une même année : il manque les registres de cellerie de 1789 et 1790, et ceux de dépositairerie des années précédentes. Mais il semble bien que la communauté vivait au-dessus de ses moyens.
Les inventaires figurant aux registres de sous-cellerie fin 1788 et fin 1789 montrent une cave bien garnie. Fin 1788, on y trouve :
- vin de Bordeaux : 14 pièces ;
- vin de Méricourt : 5 1/2 muids ;
- vin de Beaugency : 1 barrique ;
- vin de Graves blanc : 1 1/2 muid ;
- vin de Graves rouge : 1 barrique ;
- cidre gros et petit, y compris le poiré : 257 muids.
Tout cela semble avoir été consommé au cours de l'année 1789, année à la fin de laquelle on décompte :
- vin de Maçon : 6 barriques ;
- vin rouge : 380 bouteilles ;
- vin blanc : 140 bouteilles ;
- eau de vie : 70 bouteilles ;
- vin de liqueur ou muscat : 60 bouteilles ;
- vin de Madère : 30 bouteilles ;
- cidre petit : 130 muids ;
- cidre gros 30 muids ;
- poiré : 8 muids.
Il n'y a pas trace d'un inventaire lorsque l'abbaye passe sous le contrôle de la municipalité. Quoiqu'il en soit, les emprunts sont importants :
- en 1783 : 5.000 livres (à fonds perdus) « pour les besoins urgents de la maison » ;
- en 1784 : 1.000 livres (à fonds perdus) « pour des besoins urgents » ;
: 5.000 livres « restant de l'emprunt de 1783 ».
Les ressources provenant des prieurés sont comptabilisées à part : il s'agit toujours de fermages, baux, fieffes. Mais, seuls sont indiqués des versements en provenance des prieurés de N.-D. de Bû-la-Viéville (entre Houdan et Dreux), Saint-Martin de Bouafles (face à Meulan), Saint-Michel de Crouptes (à 3 km de Vimoutiers), Longueville (paroisses de Saint-Pierre 'Autils,
Saint-Just, Saint-Marcel, Saint-Etienne- sous-Bailleul formaient de la baronnie de Longueville ; le prieuré se trouvait à Saint-Pierre), Dame-Marie-du-Perche (à une lieue de Bellême). Rien, par contre, en provenance des prieurés de Saint-Fiacre du Mont-Louvet, Saint-Martin de Villaines, Ouézy (Mézidon). Bû-la-Viéville verse les sommes les plus importantes avec beaucoup de régularité.
L'ensemble rapporte, pour les cinq années étudiées, entre 8.000 et 14.771 livres, soit de 10 à 19 % des ressources totales.
Enfin, il existe un chapitre extraordinaire, celui de la Vente des plombs. Le chapitre avait en effet décidé de vendre les plombs qui protégeaient les toitures, notamment ceux du cloître et de la tour carrée.
On raconte que cette décision n'emporta pas l'adhésion de tous les religieux. Notamment de Dom Outin qui aurait fait graver sous les combles: "Dom Outin n'y a pas consenti". André Dubuc conteste cette légende en rappelant que le chapitre fut unanime à prendre cette décision. Que s'est-il passé. En 1785, plusieurs ouvriers travaillaient dans l'église et un feu resta couver. Qui endommagea la voûte. Une inspection des bâtiments fit apparaître que toutes les couvertures étaient à refaire. Sans parler des vitres de l'église ouvertes aux averses. On prit la sage décision de recouvrir en ardoises.
En revanche, en octobre 1789, Dom Outin déclara bien: "on a dévasté les plombs de l'église et du cloître !"
Je ne sais de quand date cette liste (incomplète) de frais de nourriture :
- un porc ;
- un pâté de Duclair et deux canards en pâté ;
- un mémoire de 44 livres au pâtissier de Duclair ;
- de la bière, du vin, une pièce d'eau de vie ;
- des fruits : cerises, guignes, framboises, prunes.
Pour les frais des malades, nous trouvons :
- des mémoires de médecins pour visites et médicaments ;
- un mémoire du médecin de Caudebec « pour avoir traité notre ancien jardinier » ;
- deux bandages payés au chirurgien de Duclair ;
- une somme payée à M. Martin, dentiste, « pour m'avoir nettoyé les dents » et « pour m'avoir fait arracher une dent ».
- le salaire de la garde-malade du comte de Saint-Germer « pour avoir gardé Dom Courbet » ;
- 24 livres sont allouées à Dom Bronquart, grand malade, «pour aller prendre les eaux à Rouen».
La santé de Dom Outin est moins exigeante, il se contente de six tablettes de chocolat de santé. Curieusement, on trouve aussi dans ce chapitre du charbon, des chandelles, et même des balais (en grande quantité !).
Au chapitre III, sont les frais communs, dont le total est peu important. On y trouve, dans le désordre pourrait-on dire : des ustensiles de cuisine ; le ramonage des cheminées ; du papier, des plumes, de la cire ; de la toile bleue et du ruban « pour faire des tabliers à la fillette de la basse-cour » ; un cercueil pour l'ancien jardinier ; la fosse et l'enterrement d'un enfant ; une livre de une livre de miel pour « faire un remède à une vache » ; l'encadrement et la glace du plan de la maison (1789) ; quatre grammaires grecques pour les écoliers ; divers frais de voyages (alors qu'il existe un chapitre spécial ) ; en mars 1789, 5 à 6 brochures sur la tenue des Etats généraux ; en mai 1789, différentes brochures relatives aux Etats généraux.
Le vestiaire
Le chapitre IV, consacré au vestiaire, représente 10 % des dépenses en 1789. Il comporte : des chemises (généralement 6 à la fois) ; des vestes, culottes, chapeaux, gants, éperons, mouchoirs (un en soie) ; des souliers en quantité ; « deux aunes d'indienne pour raccommoder ma robe de chambre » ; des mémoires de la couturière, du tailleur ; beaucoup de de « bouts de tabac » pour le prieur ; le « raccommodage de la montre du prieur » ; 80 livres « pour aller prendre les eaux à Saint-Germer » ; enfin presque tous les frères passaient de temps en temps se faire remettre le plus souvent 100 livres « pour fournir ses besoins ».
En regard de ces dépenses d'habillement, il faut bien convenir que les dépenses faites pour l'église, au chapitre V, sont bien modestes : 710 livres en 1789, 409 livres en 1790. Y figurent essentiellement les salaires de l'organiste, des sonneurs, des enfants de la sacristie qui reçoivent 6 livres tous les trois mois. Un nommé « La Suisse » reçoit 6 livres pour cinq mois d'école pour ces enfants de chœur, et 20 livres pour l'année de sa cloche. Sonner payait mieux qu'instruire ! On y trouve aussi le blanchissage de la sacristie, des feuilles de parchemin, des bonnets carrés pour les enfants de la sacristie.
VI, les aumônes représentent un chapitre important : 2.532 livres en 1789, 978 livres en 1790. Ces aumônes sont détaillées, par dimanche et par mois. Le texte de Deshayes est ainsi parfaitement confirmé.
Le chapitre VII : rentes, charges et gages, représentent 20 % des dépenses totales. Il est particulièrement intéressant, puisqu'il permet de savoir que l'abbaye employait à l'année, s'agissant de gages et non de mémoires : un boulanger, un cuisinier et deux aides de cuisine, un couvreur, un chaudronnier, un repasseur de couteaux, un barbier (qui est en même temps blanchisseur), un souffleur (pour l'orgue, sans doute), deux charretiers, une femme de basse-cour, une couturière, un garde-écluse.
Dans le même chapitre, on trouve le paiement de diverses rentes, de pensions (au vicaire d'Heurteauville, au curé du Trait), des portions congrues aux curés de Jumièges, du Trait, de Fontaine, de Bu ; l'escompte de billets, des décimes, 48 livres aux « héritiers de feu notre jardinier », le paiement du plan du prieuré de Dame-Marie à l'arpenteur royal, et puis en mai 1789 : « le discours de Monsieur Necker et autres brochures » ; en juin 1789 : une souscription à la feuille des Etats généraux ; en octobre : brochures concernant les affaires actuelles. Les moines ne vivaient donc pas hors du siècle, et suivaient de près l'évolution de la situation politique.
La fonte des cloches d'Yainville
Les réparations, au chapitre VIII, absorbent 4.515 livres en 1789, et 2.718 en 1790. Il s'agit de régler charpentiers, maçons et manœuvres, serruriers, terrassiers. On règle aussi : la confection d'un four à Coulonces, la fonte des cloches de Yainville, des pierres et moellons pour bâtir (et non réparer) la maison de la ferme, 1.000 tuiles et 1.000 briques, des travaux à la ferme du Mesnil, à celle du Bu, des fossés de la Harelle à Heurteauville.
Condamnés au Torp
Au chapitre IX, les dépenses de procès et affaires contentieuses sont peu importantes. Il s'agit de sommes versées « à notre procureur d'Alençon », à « notre avocat » pour des consultations, des frais d'actes et de registres. Notons, en 1790, une dépense de 20 livres « allouées à Monsieur Duval, du Torp, pour la moitié de l'amende à laquelle nous avons été condamnés conjointement pour avoir passé sous seing son marché de bois »
Les voyages de Dom Bride
L'administration de la communauté et des prieurés exige un certain nombre de voyages qui figurent au chapitre X. Le prieur doit se rendre souvent à Rouen. On le voit aussi partir pour Coulonces, Ouézy, Pont-de-l'Arche. Il se rend à une ordination à Evreux, à l'assemblée du baillage de Rouen, à Paris et à Chartres pour la faire la déclaration du changement de domicile du titulaire du prieuré de Bouafles. Le Céllerier doit également se rendre à Rouen, de même que le dépositaire qui va notamment à la foire de l'Ascension pour aheter des chevaux. Il va aussi à Vernon et Bouafles, s'alloue un crédit pour un voyage « que j'ai fait à Caen et pour ma récréation » ; il dépense 200 livres pour un voyage du 26 mai au 8 juillet « avec notre feudiste ». Il faut également payer pour ramener le cheval d'un moine de Saint-Evroult ou de Saint-Pierre-sur-Dives.
Le postillon de Duclair
Les dépenses du Chapitre XI pour les ports, lettres et commissions sont minimes. Il s'agit de sommes versées au postillon et au commissionnaire de Duclair pour les lettres et paquets, parmi lesquels 29 pots de beurre d'Isigny.
Le domaine agricole
Par dépenses faites sur les fonds (chapitre XIII), il faut entendre les frais d'entretien du domaine agricole. De 8.541 livres en 1789, elles chutent à 4.230 en 1790. L'abbaye fournissait du travail à quantité d'ouvriers payés à la semaine : batteurs (on battait tout au long de l'année, au fur et à mesure des besoins), faucheurs, bourreliers, botteleurs de foin, élagueurs, meuniers, hommes de peine pour l'entretien des allées, etc. On emploie aussi des femmes travaillant à la lessive, aux fèves, au sarclage, à la fenaison, à la cueillette des pommes, l'épluchage des prunes, l'« arrangement des groseilles pour la confiture ». Des fillettes sont rétribuées pour garder les vaches.
Maître Ponty
Selon la coutume, la moisson est confiée à un maître alloueux qui a la charge de recruter et nourrir les moissonneurs. C'est un nommé Ponty, ouvrier permanent à l'abbaye, qui a cette charge : il reçoit pour cela 150 livres en 1789.
On achète un taureau (113), deux cochons pour engraisser, des graines d'oignons, de choux-fleurs, de seigle, de vesce, fèves, du blé, de l'avoine. Les moines soignent leur pépinière, achètent des entes, des pépins (4.500 en 1789).
Savalle nous rappelle que Dom Fontaine, qui fut prieur de 1750 à 1769, est le créateur de cette pépinière : « Si la commune, si toute la contrée même est de nos jours si riche en fruits à couteau et de dessert, elle le doit à cet excellent prieur, qui vendait les plus gros et les plus beaux fruits de ses espaliers pour en en consacrer l'argent à l'achat, dans des pépinières des environs de Paris, d'entés et de greffes d'espèces aussi rares que variées ».
Messieurs Baptiste et Quevilly
Autour des quinze moines, grouille donc tout un ensemble de travailleurs que nous retrouvons au chapitre suivant (XIII), des gratifications, car ils reçoivent tous des étrennes. Il est amusant de constater une certaine hiérarchie : deux ont le droit d'être appelés Monsieur, Monsieur Baptiste et Monsieur Quevilly, qui semblent des hommes de confiance à qui l'on confie des missions administratives ; les autres sont sont appelés par leur patronyme (Ponty) ou désignés par leur fonction: le souffleur, l'organiste, le postillon. Les enfants de la sacristie ne sont pas oubliés, pas plus que "celui qui fait ma chambre", ni les religieux largement dotés d'étrennes : 600 livres au total en 1789. Les moines recevaient de droit un certain nombre de poissons (la première alose), mais celui qui l'apportait était toujours récompensé d'une gratification, comme ceux qui font don de gibier, de fruits (abricots), qui charroient du bois, et comme le domestique qui « m'a ramené de Caen, pour s'en retourner »
Les dernières dettes
Dernier chapitre, et non des moindres : celui des dettes acquittées. Il s'élève 15.724 livres (24 % des dépenses) en 1789, et fléchit à peine en 1790 : 14.996 livres. Il s'agit de mémoires impayés, d'anciens mémoires, d'anciennes dettes, d'acomptes « à notre pourvoyeur ».
On paie, en mai 1789, 195 livres « pour la provision de beurre faite au mois de septembre dernier par mon prédécesseur ». On paie aussi des sommes importantes qui semblent des arriérés :
- 491 livres à une marchande de serge ;
- 517 livres pour la provision de cire ;
- 900 livres de rentes, représentant trois années, au curé de Cideville ;
- 262 livres pour un quartier de portion congrue du curé et du vicaire de Bu ;
- 923 livres d'anciennes dettes, sans précision ;
- et toujours du vin : successivement 600 livres, 390 livres, 600 livres 1.008 livres, soit au total 2.598 livres pour du vin qui, apparemment, a été bu au cours des années précédentes.
La fin
En mai 1790, les registres sont clos et soumis cette fois au maire et aux officiers municipaux. De nouveaux registres sont ouverts ensuite pour terminer l'année. A la même date, les religieux sont appelés à déclarer s'ils entendent reprendre leur liberté (avec une pension) ou demeurer sous sous l'habit religieux. Ils ne seront plus que six : les responsables, prieur, cellérier et dépositaire, et trois moines âgés, pour clore les registres de 1790 à la date du 15 avril 1791. Une nouvelle communauté, formée de moines provenant de diverses abbayes, fonctionnera à Jumièges jusqu'en octobre 1792, et sera ensuite dispersée. La grande et puissante abbaye de Jumièges, qui a compté à son apogée environ 1.000 moines et 1.400 laïcs, est donc vide. La lente agonie des pierres va commencer...
Compilation :
Laurent QUEVILLY.
SOURCESLaurent QUEVILLY.
Les derniers registres de comptabilité de l'abbaye de Jumièges, René Bruneau.
Les difficultés financières de Jumièges à la fin de l'ancien régime, André Dubuc.
