 Qui
nous a représenté
à l'Assemblée nationale depuis sa
création ? Nos députés n'ont pas
toujours été élus au suffrage
universel et par circonscription. Les premiers étaient
souvent de Rouen, du Havre, de Dieppe... Ce n'est qu'à
partir de la IIIe république que nous pouvons
établir une solide chronologie jusqu'à nos jours.
Qui
nous a représenté
à l'Assemblée nationale depuis sa
création ? Nos députés n'ont pas
toujours été élus au suffrage
universel et par circonscription. Les premiers étaient
souvent de Rouen, du Havre, de Dieppe... Ce n'est qu'à
partir de la IIIe république que nous pouvons
établir une solide chronologie jusqu'à nos jours.
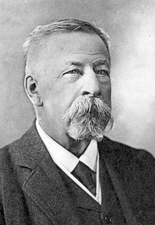 Né
le 22 mai 1838 à Rouen, Richard Waddington était
le fils de Thomas Waddington, manufacturier à
Saint-Rémy-sur-Avre (Eure-et-Loir), et Ann Chisholm. Il
était le frère de William Henry Waddington, qui
fut Président du Conseil en 1879, et cousin du philosophe
Charles Waddington.
Né
le 22 mai 1838 à Rouen, Richard Waddington était
le fils de Thomas Waddington, manufacturier à
Saint-Rémy-sur-Avre (Eure-et-Loir), et Ann Chisholm. Il
était le frère de William Henry Waddington, qui
fut Président du Conseil en 1879, et cousin du philosophe
Charles Waddington. En 1870-1871, il organisa comme capitaine l'artillerie des mobilisés de la Seine-Inférieure. Richard Waddington dirigea la manufacture paternelle. Industriel calviniste, Richard Waddington était un patron social et fut l'un des rapporteurs de la loi de 1892 sur le travail des femmes et des enfants.
Il fut élu député en 1876 et siégea au centre gauche. Il fut réélu en 1877, après la dissolution de la Chambre, puis en 1881, 1885 et 1889.
En 1891, il fut élu sénateur de la Seine-Inférieure, puis réélu le 28 janvier 1900 et le 3 janvier 1909. Il mourut le 26 juin 1913, au cours de son mandat. Il avait pris la parole sur les traités de commerce, sur les chemins de fer, sur les questions ouvrières, sur les tarifs douaniers applicables à l'Indo-Chine, a soutenu la politique opportuniste, s'est prononcé contre l'expulsion des princes, et, dans la dernière session, pour le rétablissement du scrutin d'arrondissement (11 février 1889), pour l'ajournement indéfini de la révision de la Constitution, pour les poursuites contre trois députés membres de la Ligue des patriotes, pour le projet de loi Lisbonne restrictif de la liberté de la presse, pour les poursuites contre le général Boulanger.
Richard Waddington écrivit d'importantes études historiques sur la diplomatie de Louis XV :
Louis XV et le renversement des alliances. Préliminaires de la Guerre de Sept ans (1754-56), Paris, Firmin-Didot, 1896.
La Guerre de Sept-Ans. Histoire diplomatique et militaire, 5 vol., Paris, 1899-1914.
Maurice Lebon (1891 - 1898)
 Né le 13 novembre 1849
à Paris, mort le 28 février 1906 à
Rouen. Député de la Seine-inférieure
de 1891 à 1898. Sous-secrétaire d'Etat aux
Colonies du 4 décembre 1893 au 20 mars 1894.
Né le 13 novembre 1849
à Paris, mort le 28 février 1906 à
Rouen. Député de la Seine-inférieure
de 1891 à 1898. Sous-secrétaire d'Etat aux
Colonies du 4 décembre 1893 au 20 mars 1894.Avocat à la Cour d'appel de Paris, puis secrétaire de la conférence des avocats, Maurice Lebon devint attaché au cabinet de Dufaure, alors ministre de la Justice, de 1871 à 1873, puis secrétaire particulier de cet homme d'Etat, de 1875 à 1876.
Nommé secrétaire général de la préfecture de la Mayenne en 1877, il occupa les mêmes fonctions en Seine-Inférieure de 1877 à 1880, puis s'inscrivit en 1881 comme avocat à la Cour d'appel de Rouen où il s'occupa surtout d'affaires de droit civil. Il plaida aussi devant le Conseil de préfecture.
Élu maire adjoint de Rouen en 1881, il devint maire de cette ville en 1886 et le resta jusqu'au 18 mai 1888.
Elu conseiller général dans notre canton en 1890, il fut réélu jusqu'en 1898 et ne se représenta pas.
Membre du conseil supérieur et du Comité permanent des habitations à bon marché et président de la section rouennaise de cette société, il fut, à l'Exposition de 1900, rapporteur du jury de la classe 106, consacrée aux habitations ouvrières.
Membre du conseil général de la ligue de l'enseignement et président de la section rouennaise de cette ligue, membre de l'alliance républicaine démocratique, il tint de nombreuses conférences pour ces associations.
Maurice Lebon soumet sa candidature pour la première fois aux élections législatives dans la 3e circonscription de Rouen, lors de l'élection partielle du 22 février 1891. Il est élu, en remplacement de Waddington, nommé sénateur, par 10.287 voix contre 5.368 à Montaignac, conservateur, et 1.031 voix à Cornillard, socialiste, ses principaux adversaires (24.555 inscrits, 16.798 votants).
Lors du renouvellement du 20 août 1893, il l'emporte de nouveau au premier tour, dans la 4e circonscription de Rouen, Elle comporte les cantons de Clères, Duclair, Pavilly et Maromme. Il totalise 8.530 voix contre 1.650 à Cornillard, socialiste (17.343 inscrits, 10.974 votants).
Dans le cabinet de Casimir-Perier, Maurice Lebon tiendra le poste de sous-secrétaire d'Etat aux Colonies, de 1893 à 1894. Son passage aux affaires fut marqué par le guet-apens de Tombouctou, qui fut occupée, et par la conclusion du traité franco-allemand du Cameroun, qui fut ratifié. Le sous-secrétariat aux Colonies dépendait alors du ministère du Commerce, de l'Industrie et des Colonies. Maurice Lebon démontrera au parlement l'inconvénient de cette subordination et demandera, en conséquence, la création d'un ministère autonome des Colonies étant donné l'importance croissante des possessions françaises dans les deux mondes. Le 20 mars 1894, il démissionne, son vœu ayant été accompli : Ernest Boulanger lui succède en qualité de ministre des Colonies.
A la Chambre, il siégea sur les bancs de la gauche progressiste. Il fut membre de la commission du budget, de 1894 à 1895 - il en devint le vice-président - et membre des commissions des douanes et des colonies. Il rapporta le budget de la Justice et du service pénitentiaire ainsi que le projet de loi pour le renouvellement du privilège de la Banque de France.
A la tribune parlementaire, Maurice Lebon intervint dans diverses discussions et refusa, à plusieurs reprises, les portefeuilles du Commerce, des Colonies et de la Justice, qui lui furent successivement offerts.
Lors de la demande en révision du procès Dreyfus il fut en désaccord avec la plupart de ses amis politiques parce qu'il considérait cette mesure utile aux intérêts du pays. Il porta sa conviction à la connaissance du public le 6 mars 1898 par une lettre adressée aux électeurs rouennais et dans laquelle il annonçait sa détermination de ne pas se représenter au renouvellement législatif de 1898.
Il échoue en 1902, dans la 2e circonscription de Rouen, n'obtenant que 3.480 voix contre 10.637 à l'élu, le comte de Pomereu, conservateur et 4.449 voix à Renaudet, socialiste, et se retire dès lors des luttes politiques.
Maurice Lebon décéda à Rouen le 28 février 1906, à l'âge de 57 ans. Plusieurs de ses publications, dont l'une s'intitulait Les républicains progressistes et l'alliance républicaine démocratique, furent très remarquées. Il était officier d'Académie.
Gustave Quilbeuf (1898 - 1910)
Le républicain Gustave Quilbeuf se présenta aux élections législatives de 1898. Membre du comice agricole et de la société centrale d'agriculture du département, il affirmait dans sa profession de foi son opposition à l'impôt global et progressif sur le revenu. Il fut élu au premier tour de scrutin, par 6.894 voix sur 17.459 inscrits, 13.485 votants, contre 3.367 à Laurent et 2.733 à Cornillard, candidats malheureux. Il remplaça à la Chambre Maurice Lebon, député républicain.
De 1898 à 1901, Gustave Quilbeuf fut membre de la commission de la comptabilité. Il prit part à la discussion de la proposition de loi tendant à modifier la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail ; il devait affirmer à ses électeurs, en 1902, qu'il fut « l'initiateur de la loi du 30 juin 1899 » qui résulta de ces discussions. Lors de cette même élection, il déclara aussi qu'il réussit « malgré l'opposition du rapporteur de la commission du budget et du ministre des Finances» à faire attribuer aux communes, pour leurs sapeurs-pompiers, la totalité de la taxe spéciale de 1 million 200.000 francs. Ces problèmes, en effet, le préoccupèrent pendant toute la durée de la législation.
Gustave Quilbeuf se représenta. dans la même circonscription lors des élections de 1902. Dans son programme, il déclarait qu'il refusait toute alliance avec les socialistes collectivistes. Sur 17.945 inscrits, 13.722 votants, Quilbeuf, maire de Houlme, député sortant, obtint 7.912 suffrages contre 5.337 à Cornillard et fut élu au premier tour de scrutin. En 1902, il fut élu président de la commission chargée de procéder à une enquête sur les opérations électorales de l'arrondissement de Montreuil (Pas-de-Calais).
En novembre 1905, Quilbeuf fut victime d'un accident peu banal. Près du Palais-Bourbon, le député était dans les rayons d'un marchand d'articles pour billards quand passant près de lui avec un revolver chargé à la main, un garçon du magasin laissa tomber l'arme. Du coup, une balle transperça le mollet de Quilbeuf. Soigné, le député regagna son domicile de la rue d'Amsterdam puis prit le train pour Le Houlme.
Quilbeuf déposa une proposition de loi tendant à modifier l'article 27 de la loi du 1er juillet 1905 relative à l'assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables privés de ressources ; les problèmes des bouilleurs de cru, les questions sociales et agricoles furent les thèmes majeurs de ses interventions au cours de cette législature.
Aux élections de 1906, devenu conseiller général, ce « républicain progressiste et libéral qui réprouvait les théories subversives des collectivistes», comme il le disait dans son engagement électoral, fut élu de nouveau au premier tour de scrutin, par 8.352 voix sur 18.694 inscrits et 15.557 votants contre 6.546 à Jouvin, son principal adversaire.
A la Chambre, il fut élu président de plusieurs bureaux ; il fut aussi membre de la commission d'examen des projets de reconstruction d'une salle de séances au Palais Bourbon et de la commission des usines hydrauliques. Il déposa une proposition de loi tendant à reporter à la prochaine législature la majoration prévue pour l'indemnité parlementaire. Ses activités portèrent sur les mêmes thèmes que ceux qu'il avait abordés précédemment : questions sociales, situation des vieillards, des infirmes, problèmes des sapeurs-pompiers. Ses interventions, en outre, furent nombreuses lors de la discussion du projet et des propositions de loi concernant l'impôt sur le revenu ; il compara notamment la situation des agriculteurs et des travailleurs de l'industrie au point de vue de l'incidence de l'impôt, il désirait en particulier que l'on fît une remise d'impôts à certaines veuves chargées de famille.
Ce parlementaire, inscrit au groupe progressiste, se représenta aux élections de 1910 ; sur 18.749 inscrits, 15.206 votants et 3.543 abstentions, il obtint 8.577 suffrages contre 5.929 à Jouvin et 458 à Bazin.
Membre de la commission des pétitions et de la commission de l'agriculture, son activité fut, au cours de la législature, fort brève ; il mourut le 17 décembre 1910, à Hénouville. Il était âgé de 56 ans.
Adalbert de Bagneux (1910 - 1923)
 Né à Canappeville (Eure), le
26 juillet 1845,
mort à Paris, le 4 avril 1923.
Né à Canappeville (Eure), le
26 juillet 1845,
mort à Paris, le 4 avril 1923.Député de la Seine-Inférieure de 1911 à 1923.
Fils d'un député en 1871, Pierre de Bagneux prit part, en 1870, à la défense de Paris, comme capitaine au 50e régiment de mobiles et sa conduite à Champigny et à Buzenval lui valut la Croix de la Légion d'honneur.
Le 10 juin 1872, il épousa Isabelle de Polignac, fille du marquis Jules Malchior de Polignac et de Clotilde Marie de Choiseul-Polignac. Devenu propriétaire du château de Limisy en Seine-Inférieure, il fut bientôt élu maire de cette commune et conseiller d'arrondissement en 1884, avant de recevoir, en 1885, le mandat de conseiller général du canton de Pavilly, qu'il détint jusqu'en 1922. Membre de la Société des agriculteurs de France, il brigua sans succès, le 28 janvier 1900, le mandat sénatorial ; mais le 12 mars 1911, il fut élu député de la 4e circonscription de Rouen, à une élection partielle, au premier tour de scrutin, en remplacement de M. Quilbeuf, décédé. Il fut réélu le 26 avril 1914, au premier tour de scrutin par la même circonscription et, le 16 novembre 1919, par le département de la Seine-Inférieure sur la liste d'Union nationale républicaine. Son activité parlementaire s'exerça moins à la tribune qu'au sein des diverses commissions dont il fit partie successivement, Commissions de l'agriculture, d'assurance et de prévoyance sociales, des postes et télégraphes, des comptes définitifs. Il appartenait au groupe de l'Entente républicaine démocratique. Pendant la guerre de 1914-1918, il fut délégué du Ministre de la Guerre près de la Croix-Rouge dans les départements de la Seine-Inférieure, de l'Eure et du Calvados.
Décédé en cours de mandat, son éloge funèbre fut prononcé à la séance de la Chambre des Députés du 8 mai 1923, par le Président. Raoul Péret.
René Coty (1923 - 1924)
Les législatives partielles après la mort de De Bagneux donnèrent la victoire à René Coty, alors conseiller général du Havre et Croix de guerre.
Louis Dubreuil (1924 - 1928)
 Né le 30 décembre
1873 et mort le 27 novembre
1943 à Canteleu.
Né le 30 décembre
1873 et mort le 27 novembre
1943 à Canteleu.Établi courtier à Rouen, Louis Dubreuil débuta dans la politique comme conseiller municipal de Rouen, puis conseiller général de la Seine-Inférieure, enfin comme maire de Rouen.
Il fit acte de candidature aux élections générales législatives du 11 mai 1924, qui se déroulèrent au scrutin de liste. Inscrit sur la liste d'Union républicaine, il fut élu député par 67.177 voix sur 178.613 votants. Inscrit au groupe de l'Union républicaine démocratique, il siégea à la Commission d'administration générale départementale et communale et à celle de l'hygiène. Il s'intéressa tout spécialement aux travaux budgétaires de l'Assemblée et rédigea, en 1926, le rapport sur la proposition de loi déposée par le futur président de la République, René Coty, tendant à modifier la loi du 29 mars 1918 concernant la police des débits de boissons.
Aux élections générales des 22 et 29 avril 1928, qui marquèrent le retour au scrutin uninominal par arrondissement, il se présenta dans la quatrième circonscription de Rouen. Il obtint, au premier tour de scrutin, 7.012 voix contre 7.918 à M. André Marie et 1.944 à M. Wentzo. Il se retira de la compétition avant le deuxième tour et donna sa démission de maire de Rouen. En février, il avait pourtant visité toutes les communes du canton, appuyé par Denis, conseiller général, et Malartic, conseiller d'arrondissement.
Retiré définitivement de la politique, il reprit la direction de ses affaires et s'en fut mourir dans son pays natal, le 27 novembre 1943, à l'âge de 70 ans.
André Marie

André Marie, éminent homme politique normand, fut président du Conseil en 1948 et occupa plusieurs postes de ministre sous la IVe République.
Localement il est également connu comme député de la Seine-Maritime et comme maire de Barentin, poste qu’il occupa de 1945 à 1974 ; c’est lui qui amena les statues à Barentin créant ainsi le musée dans la rue.
André Marie était né à Honfleur le 3 décembre 1897 où il fit ses études primaires puis secondaires au collège. Ses parents s’installant à Rouen en 1908, il poursuit ses études au lycée Corneille.
En 1922, il devient avocat au barreau de Rouen.
Les biographies le concernant situent le début de sa carrière politique en 1928, année où il est élu député de la Seine-Inférieure ; il sera réélu à neuf reprises jusqu’en 1962.
Mais sa carrière politique commença dès 1923. Félix Leleu, conseiller d’arrondissement de Rouen et président du Conseil d’arrondissement de Rouen, décède le 17 décembre 1922. Des élections partielles sont organisées dans ce canton le 11 février 1923. Plusieurs candidats s’affrontent et il y a ballottage au 1er tour. Le second tour se déroule le dimanche suivant 18 février 1923 ; il oppose deux candidats : André Marie et Maurice Dohet. André Marie est élu avec 771 voix contre 547 à son adversaire.
André Marie sera réélu conseiller d’arrondissement du 4e canton de Rouen en juillet 1925.
Le 14 octobre 1928, il est élu conseiller général du canton de Pavilly et doit abandonner, pour incompatibilité, ses fonctions de conseiller d’arrondissement. Il sera réélu conseiller général en 1934. En 1928 il était également conseiller municipal de Barentin.
Jean-Pierre HERVIEUX.
Assemblée Nationale constituante 1945 1946
Élections législatives de la IVe République
Les députés de l'assemblée Nationale sont élus à la proportionnelle avec le système des apparentements dès 1951 (un groupe de listes recueillant plus de 50 % des voix dans un département obtenait tous les sièges) pour une durée de 5 ans, ils sont au nombres de 627, l'assemblée Nationale possède le pouvoir législatif, elle investie le président du conseil, le président de la république peut dissoudre l'assemblée.Élections législatives de la Ve République
De 1958 à 1986 le canton de Duclair est inclus dans la 4e circonscription de la Seine-Maritime. Furent élus :
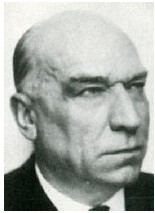 |
André Marie 9 décembre 1958 – 9 octobre 1962 Né le 03.12.1897 à Honfleur (Calvados). Député n'appartenant à aucun groupe ou formation administrative. |
 |
André Chérasse 6 décembre 1962 – 2 avril 1967 Né le 23.01.1906 au Montet (Allier). Officier général. Union pour la nouvelle République-UDT Fils
d'un chef d'escadron, André Chérasse,
engagé dans la Résistance pendant le Seconde
Guerre mondiale, fait l'essentiel de sa carrière dans la
Gendarmerie. A partir de 1960, il commande la Gendarmerie du
Corps d'armée de la région de Constantine, en
Algérie. Lors du putsch des généraux,
il respecte la légitimité
républicaine. Sollicité par le
général de Gaulle pour se présenter
à Marseille ou à Rouen, il choisit la
Seine-Maritime où il est élu
député UNR en 1962 dans la 4ème
circonscription. Il siège au Palais-Bourbon jusqu'en 1967.
Auteur de nombreux articles sur la protection civile, la
sécurité routière ou le maintien de
l'ordre, le général Jean Chérasse
publie aux éditions Pygmalion, en 1983 : La
Hurle / La Nuit sanglante de Clichy, 16 et 17 mars
1937. André
Chérasse, père du
réalisateur Jean Chérasse, s'éteint le
10 février 1997, à l'âge de 91 ans.
|
|
|
Colette Privat 3 avril 1967 – 30 mai 1968 Agrégée
d'université, communiste, née le 14 novembre 1925
à Paris. |
 |
Olivier de Sarnez 11 juillet 1968 – 1er avril 1973 Né le
21.02.1927 à Paris, Ingénieur en
organisation, Union des démocrates pour la
République. De 1943 à 1944, il participe
à divers mouvements et actions armées de la
Résistance. De 1961 à 1967, il est chef de
cabinet de Roger Frey au ministère de
l'Intérieur. |
 |
André
Martin 2 avril 1973 – 2 avril 1978 Instituteur, Réformateurs
démocrates sociaux. Né à Vichy
(Allier) le 1er février 1926. Maire de Montville de 1959
à sa mort (1993). Conseiller Général
du canton de Clères de 1982 à 1993. |
 |
Colette Privat 3 avril 1978 – 22 mai 1981 |
Du 2 avril 1986 au 14
mai
1988 la Seine Maritime a été
représentée par 12 députés
élus à la proportionnelle. Depuis le 23 juin 1988
le canton de Duclair est dans la 5e circonscription.

Né le 26 mai 1939 à Mont-Saint-Aignan, professeur, Jean-Claude Bateux a effectué quatre mandats. C'est Laurent Fabius qui le pousse à se présenter aux législatives après l'avènement de François Mitterrand. Il fut élu avec 60% des voix. Il a été maire de Pavilly, conseiller général et régional.
 Christophe
Bouillon 20 juin 2007 - 17 juin 2020.
Christophe
Bouillon 20 juin 2007 - 17 juin 2020.-
- Né le 4 mars 1969 à Rouen. Fonctionnaire de catégorie A
 Après
les municipales de 2020, Christophe Bouillon démissionna de
son
poste de député pour se consacrer à
son mandat de
maire de Barentin. Son suppléant, Bastien Coriton, ne lui
succéda que quelques heures pour opter lui aussi pour sa
mairie,
celle de Rives-en-Seine, nom artificiel regroupant Caudebec-en-Caux,
Saint-Wandrille-Rançon et Villequier.
Après
les municipales de 2020, Christophe Bouillon démissionna de
son
poste de député pour se consacrer à
son mandat de
maire de Barentin. Son suppléant, Bastien Coriton, ne lui
succéda que quelques heures pour opter lui aussi pour sa
mairie,
celle de Rives-en-Seine, nom artificiel regroupant Caudebec-en-Caux,
Saint-Wandrille-Rançon et Villequier.
Ce fut Gérard Le Seul qui reporta la partielle du 20
septembre 2020. Les candidats :
Maxime Da Silva. Conseiller municipal à Pavilly, La France insoumise en binôme avec, Marie-Odile Lecourtois (PCF), conseillère municipale à Notre-Dame-de-Gravenchon et suppléante du député PCF Jean-Paul Lecoq de 2007 à 2012.
Patricia Lhoir, LREM, retraitée et son suppléant Paul Bonmartel, conseiller municipal du Trait, se présentent sous l’étiquette Majorité Présidentielle.
Jean-Christophe Loutre/Amélie Marquer (UPR),
Auban Al Jiboury/Enora Chopard (EELV),
Valérie Foissey/Frédéric Podguszer (LO),
Jean-Cyril Montier/Anaïs Thomas (RN),
Michel Allais/Corinne Buquet (LR).
Aux législatives de juin 2022, Gérard Le Seul fut le seul candidat socialiste investi par la Nupes de Jean-Luc Mélenchon. Il arrive en tête dans la cinquième circonscription de Barentin-Pavilly-Duclair avec 33,68 % des voix (15 440) et retrouve au second tour Jean-Cyril Montier, du Rassemblement nationa qui progresse de 10 points et devance de peu (1 033 voix) le maire de Duclair, Jean Delalandre, se présentant cette fois sous les couleurs du parti d'Edouard Philippe, Horizons.
- A.D.S.M. 3 M 531
- 3 M 542
- Robert Eude Le Conseil Général de la Seine-Inférieure.
- Militaires en République 1870-1962, les officiers, le pouvoir et la vie publique en France. Sous la direction de Olivier FORCADE, Eric DUHAMEL et Philippe VIAL. Publications de la Sorbonne, 1999, p. 365
- Dictionnaire des parlementaires français de 1889 à 1940, J.Joly.
CONTACT
Didier
: Pour la petite histoire, Olivier de
Sarnez qui fut élu député en 68, est
le père de Marielle de Sarnez.

