Par Laurent QUEVILLY.
Entre Duclair et Saint-Paër, Varengeville fut une parenthèse pour les Quevilly. Voici la suite de leur saga qui nous mène droit jusqu'à moi. Tout en brossant l'histoire de tous les Saint-Paërois...
VIII. Henri Quevilly (1868-1949)
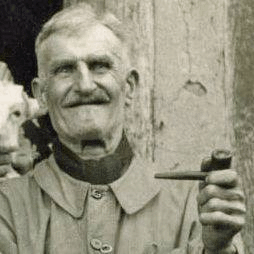 Né
le 3 juin 1868 à 7h du matin avec les prénoms
d'Henri
Emmanuel, les témoins de sa naissance sont Eugène
Blard,
51 ans, menuisier et Alfred Lefebvre, 23 ans, journalier en
présence de Florentin Cavé, maire de
St-Paër. Henri
est d'une fratrie d'au moins trois filles et deux garçons.
Je
n'ai aucune indication sur son frère. Si ce n'est qu'il est
mort
durant la guerre de 14.
Né
le 3 juin 1868 à 7h du matin avec les prénoms
d'Henri
Emmanuel, les témoins de sa naissance sont Eugène
Blard,
51 ans, menuisier et Alfred Lefebvre, 23 ans, journalier en
présence de Florentin Cavé, maire de
St-Paër. Henri
est d'une fratrie d'au moins trois filles et deux garçons.
Je
n'ai aucune indication sur son frère. Si ce n'est qu'il est
mort
durant la guerre de 14.
Henri a deux ans au moment où le pays connaît de
graves désordres. Les Prussiens occupent Saint-Paër
cinq mois. L'enfance d'Henri se passe ux champs.
Le mardi, la famille se rend au marché de Duclair distant de
4km. Il faut imaginer ces scènes de marché. Les
hommes portent tous le chapeau ou d'imposantes casquettes qui
évoquent celles des marins. Beaucoup arborent une blouse.
Les femmes du peuple ont de vastes foulards sur la tête,
voire une coiffe blanche. Le marché se mue en foire deux
fois par an. A Pâques, le jour du mardi saint. C'est le
marché fleuri. Et puis à la Saint Denis,
début octobre. On y voit parfois des montreurs de
bêtes sauvages, des marchands d'amadou...
A Duclair où, alors qu'Henri a 9 ans, circule une histoire
de sorcellerie. L'eau tombe en pluie sur le berceau de deux enfants.
Mais leur garde, une petite bonne de 14 ans, finit par avouer
être l'auteur de ces aspersions. Nous sommes en 1877.
A 18 ans, en 1886, Henri vit s'élever
l'école des garçons. Puis celle des filles en
1892. A l'époque, un tiers de la population ne sait ni lire
ni écrire. Mlles Leblanc et Avril seront institutrices, MM
Arson et Guyot instituteurs.
L'armée
 Henri
avait tiré le n° 21 au conseil de
révision de
Duclair. C'est un grand gaillard d'un mètre 73, les yeux
bleux,
les cheveux châtains. Sa fiche matricule le dit agriculteur
et
exercé en matière d'instruction militaire.
Henri
avait tiré le n° 21 au conseil de
révision de
Duclair. C'est un grand gaillard d'un mètre 73, les yeux
bleux,
les cheveux châtains. Sa fiche matricule le dit agriculteur
et
exercé en matière d'instruction militaire.
Il est incorporé le 13 novembre 1889 au 11e Régiment
d'artillerie, sous les ordres du colonel Jules Brunet, à
Versailles. Il a 21 ans. Son régiment a
été créé en 1831 suite
à la dissolution du Régiment
d’Artillerie de la Garde Royale. Ainsi le 11e aura
participé à diverses campagnes, notamment en
Algérie, Crimée, Italie, Mexique... Son commandant fut de cette
dernière expédition.
Le 25 mars
1892, Henri passe au 31e d'artillerie, commandé par le
colonel Caro. C'est un régiment qui s'est
formé au Mans en 1873. De là, on l'envoie en
congé
le 24 septembre avec un certificat de bonne conduite. Le 1er novembre,
il passe dans la réserve de l'armée
active.
Henri accomplit une première période d'exercice du 30 septembre au 27 octobre 1895 au sein du 22e d'artillerie, formé en 1870 et basé à Versailles.
L'amour
Henri
se maria avec le 21 novembre 1896 avec
Joséphine
Chéron. Le couple allait s'établir aux Vieux dans
la
partie rattachée à Varengeville.
Le 7 avril, un garçon vint au monde et on le prénomma comme son père. Hélas, il ne vécut que quatre mois.
Henri effectua une seconde période du 7
mars au 2 avril
1898. Henri est alors domicilié à Varengeville.
Cette
année là, le Dr Léonide Maillard,
rédacteur
au Journal de Duclair,
est le conseiller général du canton. Il le
restera jusqu'en 1910.
Le 8 ocobre 1898 naquit un premier enfant qui sera ma marraine : Henriette Quevilly.
En 1901, Henri travaille chez Delaporte avec sa femme. Il est recensé sur Varengeville. Une nouvelle fille nait en décembre. Et c'est encore un malheur. Elle décède un mois plus tard. On se consolera en accueillant un garçon, Marcel, en 1903.
Henri
eut une vie difficile. Cet homme de belle taille, se louait comme
journalier dans les fermes. A la saison, il fauchait le blé
dès 4h du matin puis commençait sa
journée
à l'usine à 7h. En 1900, il travaille
à la
filature d'Edouard Delaporte qui possède
également une
usine à Barentin.
Henri s'occupait de la fraîche. Pour se rendre à
l'usine, il accomplissait
de nombreux kilomètres à pied. A 7h du soir,
après
12 heures de travail, mon grand-père finissait la
journée. Il rentrait alors à Saint-Paër
en remontant
de l'eau puisée à la source, près du
carrefour et
qu'il traînait dans une petite carriole.
En 1900, Edouard Delaporte avait fait don du terrain à la
commune et réalisé les travaux
nécessaires pour
rendre ce point d'eau accessible à tous. Les habitants
n'étaient pas encore raccordés à l'eau
courante.
Rentré chez lui, Henri trouvait encore le temps d'entretenir
un
magnifique jardin et je pense une basse cour. Puis il se coiffait
après la soupe, les derniers travaux, d'un magnifique bonnet
de
nuit.
A quoi ressemble le Saint-Paër des années 1900 ? C'est l'une des communes de Seine-Maritime qui comporte le plus de hameaux: 29. Sur la place, à partir de 1909, la famille d'Adolphe Hautot tient le café-épicerie. Il a succédé aux Boulfort. Là, derrière, le boucher de Fréville passe régulièrement pour s'installer dans un baraquement. Le boucher de Duclair, le même jour, prend position quant à lui devant l'église. Il y a la boulangerie d'Albert Généreux Guérillon à qui succède Louis Chouquet qui sillonne la campagne en voiture à cheval. Le facteur, c'est Monsieur Tellier. Saint-Paër compte deux bourreliers. L'un au bourg entre le café et la boulangerie. C'est Eugène Hitte. L'autre, Lefèvre, au hameau du Bas-Mouchel. Il y avait aussi le café-épicerie de la mairie tenu d'abord par Douyère puis par Gaston Grenier qui sont aussi forgerons. Gohon est cordonnier, Paul Etienne et M. Boulanger sont menuisiers, Georges Capelle et M. Cordier sont charrons. Deux meunier: Pigache au moulin du Paulu, Ernest Duclos au moulin du Bas-Aulnay. C'est lui le maire de 1904 à 1912. Le dimanche après-midi se disputent des parties de boule tandis qu'un portique avec balançoire, trapèze et échelle accueille les enfants. Tout cela se termine par une bonne collation au café.
Février 1905. Un nommé Auguste Calais, âgé de trente-cinq-ans, demeurant à Saint-Paer, s'est introduit, la nuit dernière, chez son père, cultivateur à Villers-Ecalles, pour le voler. Au moment où il traversait la cour, le chien aboya, et un domestique, se levant, tira un coup de fusil dans la direction de Calais, qui fut atteint peu grièvement. Calais, qui s'était armé d'un fusil pour son expédition, tira à son tour, mais sans atteindre le domestique. Il s'enfuit alors et alla se constituer prisonnier à la gendarmerie de Duclair. Il a déclaré que, s'il avait été sûr que ce fût son père, qui tirait Sur lui, il lui aurait envoyé ses deux coups de fusil et se serait fait justice ensuite.
L'armée rappelle encore Henri du 14 au 27 août 1905 au 22e. Cette fois, il habite Saint-Paër.
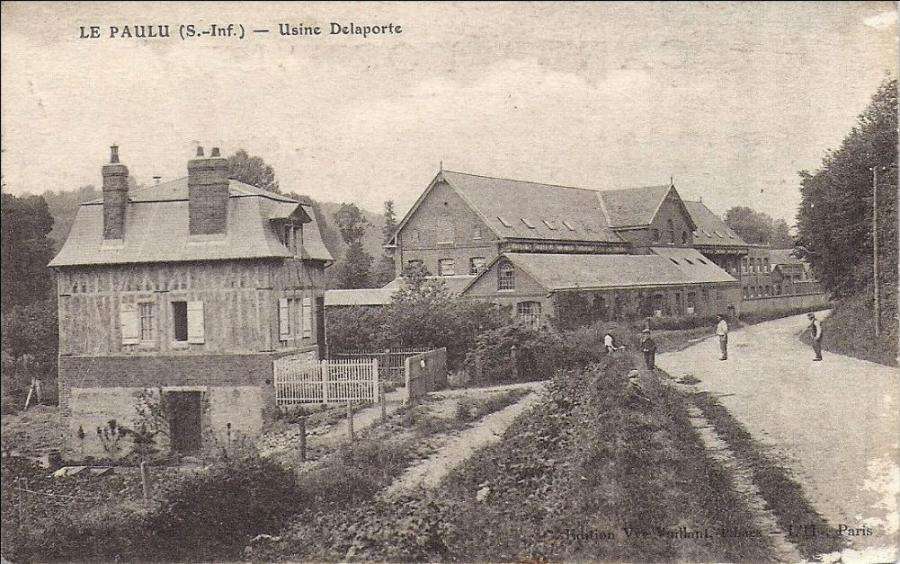
En 1906, Henri est recensé au hameau de Maison-Blanche avec son épouse sous le prénom d'Augustine. Ils sont ouvriers de filature chez Delaporte. Sous leur toit vit leur fille aînée Henriette, ma marraine, née en 1898. Son frère Marcel, âgé de 3 ans, est alors en nourrice chez Jules Langlois, ouvrier lui aussi chez Delaporte et père de quatre garçons. Sous le toit d'Henri, il y a aussi Gabrielle Chéron, sœur d'Augustine, ouvrière de filature chez Cabrol. Bientôt, elle trouvera un époux... Chez Cabrol, tous ces gens retrouvent Edouard Quevilly et sa femme, Charlotte Lemoine. Edouard est menuisier. Ce sera une victime de la Grande guerre. Le 6 octobre, la famille accueille un nouveau garçon : Raphaël, mon père.
Au Haut-mouchel, mon arrière-grand-père, Auguste Chéron, vit seul avec sa fille Marie, restée célibataire et sans emploi au moment du recensement. Elle travaille cependant en filaturet et trouvera la mort la mort dans deux ans.
Les martyrs d'ElondetteL'affaire
bouleverse tout le canton. Un scandale qui éclabousse la
famille. Au hameau
d'Elondettes, le sieur Lerebours, veuf depuis peu, avait
épousé Julia Quevilly, la sœur d'Henry.
Le couple
réservait le plus
mauvais traitement aux trois enfants nés d'un premier lit
tandis que
celui du second, une petite fille, avait tous les égards.
Les
gamins
étaient privés de soins, de nourriture et
dormaient sur
la paille avec
de vieux sacs pour couvertures. Le juge Becquet et le conseiller
Chéron
se rendirent sur place et l'on entendit de nombreux témoins
avant de
saisir le Procureur.
L'enquête se poursuit en février concernant la
maltraitance des enfants d'Elondettes, confiés à
l'Assistance publique. Un juge d'instruction, les gendarmes,
complètent les investigations du juge de Paix. L'enfant du
second lit, Suzanne Lerebours, est confiée à son
grand-père maternel, Théodule Quevilly.
L'affaire d'Elondette arrive en correctionnelle en février
avec
la comparution de Julia Quevilly, présentée comme
indigente et alcoolique. Les trois enfants,
révèlent
l'enquête, étaient vêtus de haillons,
dénutris, couchés sur la paille, parmi leurs
excrément et portant des traces de coups. Les voisins
entendaient parfois leurs cris et s'étaient émus
de leur
sort. A 5h du matin, la marâtre les envoyait nus pieds dans
la
gelée chercher du maquer à lapins. Son propre
enfant, une
petite fille âgée de 2 ans, était en
revanche
choyée. Au procès, on entendit le Dr Allard, qui
examina
les enfants et les époux Hémard,
préoccupés
de leur sort. Alphonse Hémard était un gros
agriculteur
ayant plusieurs domestiques, dont Victor Quevilly 77 ans. Les Roger,
grands-parents maternels des trois petits martyrs, ont
déjà à leur charge cinq orphelins. Ils
ne
demandent pas mieux que d'accuillir ces trois enfants, encore faut-il
les aider. A voir entre l'Assistance et les Roger. Julia Quevilly, la
mauvaise femme, écoppa de quatre mois de prison. Pas son
mari
qui n'eut nulle condamnation et que l'on retrouvera mobilisé
en
14. Il finira par divorcer en février 1916. Chacun se
remariera
de son côté. La fille du second lit, Suzanne, est
décédée le 16 mars 1968 à
Grugny, commune
connue pour son asile départemental.
Le 1er octobre 1908, Henri Quevilly passe dans la réserve de l'armée territoriale du 22e. Il vient d'avoir une fille : Solange.
Mars 1909 : aux Vieux, section du Paulu, dans un herbage appartenant au sieur Quevilly, cultivateur, le corps de Louis Délu, ouvier de filature de 19 ans, est trouvé mort. Le Dr Allard diagnostique une congestion par le froid.
Juillet 1909. Avec deux camarades, le petit Pierre Lhoir, 6
ans, fils du chef de gare du Paulu, entre
dans un poulailler où son père avait
disposé un
petit canon pour se protéger des voleurs. Le coup part et
l'enfant a la tète fracassée. Les
razzias
étaient alors fréquentes. Lhoir retirait son
canon tous
les matins. Sauf ce jour où étant de repos il se
rendit
au Trait. Quand à cinq heures de l'après-midi...
On fit
venir de Caudebec le médecin de la Compagnie de chemin de
fer.
Qui ne put que constater le décès. Les gendarmes
de
Duclair ouvrirent une enquête. Lhoir est très
apprécié jusqu'au chef-lieu. L'émotion
est grande
dans le canton.
En décembre, naissance d'Agnès Quevilly.
En
1910, c'est l'hôtelier Henri Denise, maire de Duclair, qui
sera
élu conseiller général. En avril, un
incendie se
déclare dans la ferme de Joseph Godallier, aux Vieux.
Le 10 juillet, sur le
chemin qui mène Henri à son travail, on inaugure
une
curieuse entreprise. C'est le labo de spéléologie
expérimentale.
En 1911, alors que son
père,
assisté, est à l'agonie, Henri doit 6 F
à la
commune. Somme jugée irrecouvrable par le receveur. En
novembre,
devenues veuves, les épouses de Narcisse et
Théodule
Quevilly sollicitent l'assistance aux vieillards. La
première
aura 3 F, la seconde 12. Alors, la veuve de Narcisse fera appel pour
obtenir plus. En vain...
Le
18 août 1911, un incendie ravagea l'épicerie
Choitel, les
pompiers de Duclair vinrent sur place avant de réclamer des
indemnités.
Quand Henri se rend à Duclair, il croise une figure: la mère Lamour. Coiffée d'un canotier, Marie-Louis Jouen vend des journaux. Dont L'Amour qui lui vaut son surnom. Elle vend aussi Le Parisien, Le Matin, Le Petit journal, Jean qui rit et Jean qui pleure. Dans son coffre à trois roues, on peut aussi trouver des fichus, des châles, des chapeaux, des parapluies...
Mai
1912 : Max de Joigny est élu maire par 6 voix contre 5 pour
Ernest Duclos. Il aura Tranquille Vattier pour adjoint, élu
au
bénéfice de l'âge.
Juin 1912. Sous ce titre "Une scène scandaleuse", le Journal de Rouen
raconte que les habitants de la commune de Saint-Paër ont
été fort émus par une scène
des plus regrettables qui s'est déroulée
lundi pendant une inhumation. Non content de pousser des cris qui
n'avaient rien de liturgique, un chantre — très
ému, c'était la première communion la
veille — est tombé en se rendant au
cimetière, entraînant la chute du prêtre
qu'il avait violemment heurté. Au cimetière, le
fossoyeur — non moins ému sans doute —
avait oublié d'ouvrir la porte de la nécropole et
de creuser la tombe. Cette pénible opération a
dû être faite par plusieurs membres de la famille.
21 septembre : naissance de ma tante Bernadette.
Aux
élections de 1913, Henri est inscrit sur les listes
électorales de Saint-Paër avec le prénom
d'Emmanuel.
Ils ne sont plus que deux Quevilly. L'autre, c'est Victor, ouvrier
agricole, plus jeune de quatre ans et vivant au Haut-Mouchel.
En
septembre 1913 mourut l'abbé Mauger,
âgé de 63 ans.
Il était là depuis 1894 et avait
réalisé
d'importants travaux à l'église. Tous les
curés du
canton étaient là et de Joigny
prononça un
remarquable discours.
Le
1er octobre 1914, alors que la guerre est
déclarée, Henri
est libéré du service militaire et ne sera pas
rappelé. Le 30 novembre 1918, la guerre, finie, et on le
considère comme libéré
définitivement de
toute obligation militaire.
Durant la guerre de 14, mon père accompagnait Henri aux
champs. Le gamin avait 8 ans et on le ramena de force à
l'école. Pourtant, on était habitué
à l'absence des enfants. Celle de mon père avait
dû se prolonger.
En
février 1915, Clémentine Sébire, veuve
de
Théodule Quevilly, sollicita l'augmentation de sa pension
mensuelle. Max de Joigny fit la sourde oreille. Un an plus tard, il fut
donné droit à la demande des deux
belle-sœurs. La
pension de la veuve de Narcisse passa de 3 à 8 F. Celle de
Clémentine de 12 à 15, maximum communal. Comment
se
répartit cette somme ? 2 F pour le logement, 10 pour la
nourriture, 3 pour entretien.
Les Quevilly sont parmi les plus indigents de la commune. En mai 1916,
au titre de l'assistance aux familles nombreuses, c'est Henri qui
reçoit une aide en nature sous forme de pain d'une valeur de
5 F
par mois. Il vient d'accueillir une dernière fille, la
ravisée, Argentine...
1916
est aussi l'année où fut prononcé le
divorce entre
Julia Quevilly, tante d'Henri, et Louis-Augustin Lerebours.
Mais qu'en était-il du
beau-père d'Henri Quevilly,
Auguste Chéron. Journalier en février en 1917, il
fit une
demande d'assistance aux vieillards. Les conseil
délibéra
: "
considérant que le sieur
Chéron Auguste n'est pas sans ressources, qu'il touche
l'allocation journalière de 1,25 F (soutien de famille) et
est
titulaire d'une pension de cent francs au titre des retraites
ouvrières, est d'avais qu'il y a lieu d'ajourner sa
décision jusqu'à la cessation des
hostilités."
En mai 1918, Emélie Quevilly, sœur d'Henri,
handicapée mentale vivant avec sa mère fut admise
à l'assistance aux incurables.
" Cette personne ne disposant d'aucunes ressources, il lui sera
alloué une pension mensuelle de quinze francs à
partir du
1er juillet courant. "
A cette époque, l'abbé Prunié occupait
le vieux
presbytère qui menaçait ruines et que l'on avait
vainement tenté d'alliéner. En mauvais
état
était aussi le pont des Vieux, passage obligé. On
décida de le restaurer.
Raphaël avait 12 ans quand, cette fois, il travailla un an et demi à la filature Delaporte.
A partir de 1918, la société des filatures Saint-Sever, de Rouen, devient maître des lieux. C'est une filiale des établissements Frémaux dont le siège social est au 27 de la rue du Vieux-Faubourg, à Lille. Elle est déclarée au registre du commerce de Rouen sous le n° B 1009. M. et Mme Frémaux possèdent la propriété de la Beuvrière, dans la côte du Paulu, équipée d'une piscine.
En 1919, Pierre Jean Polydore Van Den Bosch vint relancer la filature du Paulu. Belge, il avait dirigé la filature Pouillier-Linghaye en 1895 à Lille, puis fondé, en 1902, celle de Wambrechies et Lomme lez Lille. Son fils était mort en 1917 en compagnie du comte Henri de la Vaulx. Pierre Eugène Jean Van Den Bosch était en effet lieutenant pilote du dirigeable Pilatre-de-Rozier qui s'écrasa à Voellerdigen avec tout son équipage. Mon grand-père servait de barbier à Van Den Bosch qui possédait un château à Saint-Martin-de-Boscherville.

Au
Paulu, malgré les efforts des pompiers, un incendie
détruit un grand bâtiment du tissage Leurent,
anciennement
Cabrol. Dégâts : 800,000
F et surtout 170 ouvriers au chômage. Le maire de
Varengeville,
René Dieusy, organise un comité de secours. On
espère que les filateurs voisins absorberont pour quelques
mois
la main-d'œuvre privée d'emploi.
Le
20 octobre 1919, Henri marie sa sœur Angèle
à Henri
Herment. Ce dernier était né de père
inconnu chez
un oncle. Sa mère, Clémence Alphonsine,
était
ouvrière de filature. Elle aussi,
décidément, était
née de père
inconnu. Anasthasie Herment avait accouché chez son
père
Jean en 1850. Ce dernier était journalier.
Jeune homme, Henri Herment fut un pied nickelé. Un mois de
prison pour filouterie d'aliments avec bris de clôture en
1894, six mois en 1895 pour vol. Il fut incorporé en 1896 et
conduit en Algérie. Deux ans plus tard, on le collait chez
les Zouaves. Réformé temporaire pour
pleurésie chronique, il fut rayé en 1899 et on
lui refusa le certificat de bonne conduite. On le
réintègre en 1900 mais le voilà
condamné à onze mois de prison pour coups et
blessures
Dès le 4 août 1914, Herment va se racheter. Il est
mobilisé au sein du 21e RIT. le 27 août 1915, il
passe au 20e, le 3 septembre au 18e, le 3 octobre au 19e enfin le 29
décembre 1917 au 232e. Bref, il mènera campagne
contre l'Allemagne jusqu'en mai 1919. A sa démobilisation,
il épousa donc ma grand-tante en octobre 1919...
En
décembre 1919, de Joigny fut mis en minorité au
sein de
son conseil au profit d'Alphonse Hémard. Tranquille Vallier
reste adjoint.
Février 1920. Tandis que de Joigny supervise le projet de monument aux morts, Auguste Chéron est admis à l'assistance aux vieillards. Il percevra 1,67 F compte-tenu des 100 F de sa retraite ouvrière et des 5 F en nature que lui alloue son fils tous les mois.
En 1921, il vit avec sa femme, sa
belle-mère, Clémentine Sébire et sa
belle-sœur, Emélie. Il est alors ouvrier agricole
chez Victor Chandelier et habite le village de Saint-Paër. En
1921 fut inauguré le monument aux morts sculpté
par
Maurice Ringot, établi au Trait. Henri et ses deux fils,
Raphaël et Marcel Quevilly, sont ouvriers de filature chez
Frémeaux
et Vandenbosch. A côté de là, Clovis
Chéron
est cantonnier au service vicinal tandis que son père est
journalier. En septembre, un incendie se déclare dans la
remise
de la maison d'habitation des époux Hautot et de Mme veuve
Etancelin. Le feu gagne la toiture en chaume. Appelés
à
la rescousse, les ouvriers de l'usine
Van Den Bosch arrivent avec la pompe de la filature. Malgré
leurs efforts, 110 quintaux de foin appartenant à M.
Tocqueville
et les meulbes des Hautot partent en fumée.
Novembre 1923 : Max de Joigny retrouve son siège. Il confirme en mai 1925 avec Paul Maurice pour adjoint.
En 1925, âgé de 59 ans, Henri reçut une montre Lip en plaqué or pour 25 ans de bons et loyaux service aux filatures Frémeaux.
Restons
en 1925 pour voir comment mon grand-père pouvait se
réjouir lors de manifestations collectives. Les 6 et 7 juin
eurent lieu les fêtes communales, place de la mairie, sous la
présidence du maire, Max de Joigny. Henri et
Raphaël, j'ose
le supposer, y assistaient. Du moins vécurent-ils de
semblables
réjouissances. Tout commença le samedi
à 19h par
des salves d'artillerie et la sonnerie des cloches. Ce qui fut
réitéré le lendemain matin
dès 6h. Le
Rappel de Duclair donna un concert de 15h à 19h. Cette
fanfare a
un an. Elle a succédé à la clique des
sapeurs
pompiers. Le Rappel est en concurrence avec la fanfare de Duclair,
fondée quant à elle en 1893. A 15 h 15, il y eut
une
course cycliste. 13 km. Je sais que mon père a
gagné de
telles épreuves. Les enfants de moins de 13 ans, eux,
disputèrent une course à pied à 15h20.
A 16h eut
lieu un concours dont j'ignore le sens: le dîner de l'ogre.
16h:
nouvelle course cyclise de 6km. 17h: jeux de ciseaux pour les filles de
moins de 13 ans. 17h30 : jeu des chercheurs d'or. Max de Joigny
procéda à la distribution des prix à
18h.
Après quoi eut lieu un bal à grand orchestre. A
20h,
Saint-Paër s'illumina avec l'embrasement de la
mairie.
Hautot, le
tenancier du café de la place, présidait le
comité
des fêtes créé depuis un an. C'est
auprès
de lui qu'il avait fallu s'inscrire. Un membre du comité
avait
fait du porte à porte pour solliciter des dons.
Le 9 juin, il y
eut le pèlerinage à Saint Onuphre. On allait lui
réciter des prières au hameau du Mesnil-Varin
où
sa statue habitait la chapelle de la Sainte-Trinité. J'ai du
mal
à y voir mes Quevilly.
Le 14 juillet, ce fut la fête
nationale. Ce jour-là, dès 8h du matin, les
indigents
reçurent une part de viande. L'après-midi, il y
eut des
concours de tirs gratuits pour les adultes, de pots cassés
pour
les enfants et une course à l'oeuf. Puis des courses
d'ânes, des courses en sac et chacun était
prié
d'amener sa pouque. Et encore la remise des prix, le bal, les
illuminations.
Pour fêter la moisson, il existait aussi une procession.
1926 : Henri et son fils Raphaël sont recensés comme ouvriers d'usine chez Frémeaux. Solange, Agnès, Bernadette et Argentine sont toujours à la maison. Les voisins sont Auguste Chéron et son fils Clovis, aide-agricole. Le 12 octobre 1926, le décès de Clémentine Sébire est déclaré à l'état civil de Rouen. En novembre, le conseil municipal ratifie l'hospitalisation de "Mme Veuve Quevilly, née Sébire, en vertu de la loi du 14 juillet 1905." Mais elle n'est plus de ce monde.
Le 16 février 1928 mourut Max de Joigny, chevalier de la
couronne de Belgique, président de la
société des régates de Duclair. Le
dimanche suivant, au chateau du Launay, son épouse le suivit
dans la tombe. Mon arrière-grand-père, Auguste
Chéron, avait été bûcheron
chez eux.
Dès lors, ce fut Paul Maurice, le maire. Pour dix ans. Max
de Joigny était le fils de Louis Auguste Beaudouin de
Joigny, propriétaire du château des Vieux qui, le
27 août 1848 avait élu conseiller
général du canton de Duclair. Maurice eut d'abord
Louis Ferment pour adjoint. Ils seront confirmés en mai 29.
En mai 28, les 5 F que devait Chéron fils au titre de la taxe sur les chiens sont admis en non valeur. Il a été poursuivi sans résultat.
18 juillet 1928, Le temps. Les
six enfants de M. Genet, facteur des postes à Duclair,
demeurant à Saint-Paër
(Seine-Inférieure), jouaient dimanche, à 19
heures, dans un bâtiment servant de grange. Soudain, Mme
Genet s'aperçut que la grange était en flammes;
elle y courut, affolée, et, à l'aide d'une
pioche, défonça le mur en torchis.
Elle délivra ainsi ses six enfants,
âgés de 6 à 2 ans, gravement
brûlés, ils ont été conduits
d'urgence à l'hospice général de
Rouen, où cinq d'entre eux ont succombé; le
«sixième est dans un état
désespéré. 19 juillet : Le petit
René Genet, âgé de deux ans, la
sixième victime de l'incendie que nous avons
relaté hier, a succombé...
Hier
matin, au milieu d'une très grande affluence, ont eu lieu
les obsèques des six petits enfants Genêt qui
trouvèrent une si horrible mort dans l'incendie d'une grange
à Saint-Paer. Les six cercueils avaient
été déposés à
l'entrée du choeur de la petite église de
Saint-Paer et disparaissaient sous les fleurs et les couronnes.
Au cours de la cérémonie religieuse, M. le
chanoine Haquet, curé-doyen du canton de Duclair,
représentant Mgr Du Bois de la Villerabelle,
archevêque de Rouen, prononça une touchante
allocution.
Le 14 octobre 1928, Charles de Heyn, agent d'assurance, maire de Duclair, bat Henri Denise aux cantonales.
1929, 28 janvier. M. Henri Manoury, de Saint-Paër, rentrant chez lui après une absence de quelques jours, a trouvé sa femme, âgée de 54 ans, tombée près du poêle et entièrement carbonisée. On suppose qu'une étincelle a mis le feu à ses vêtements.
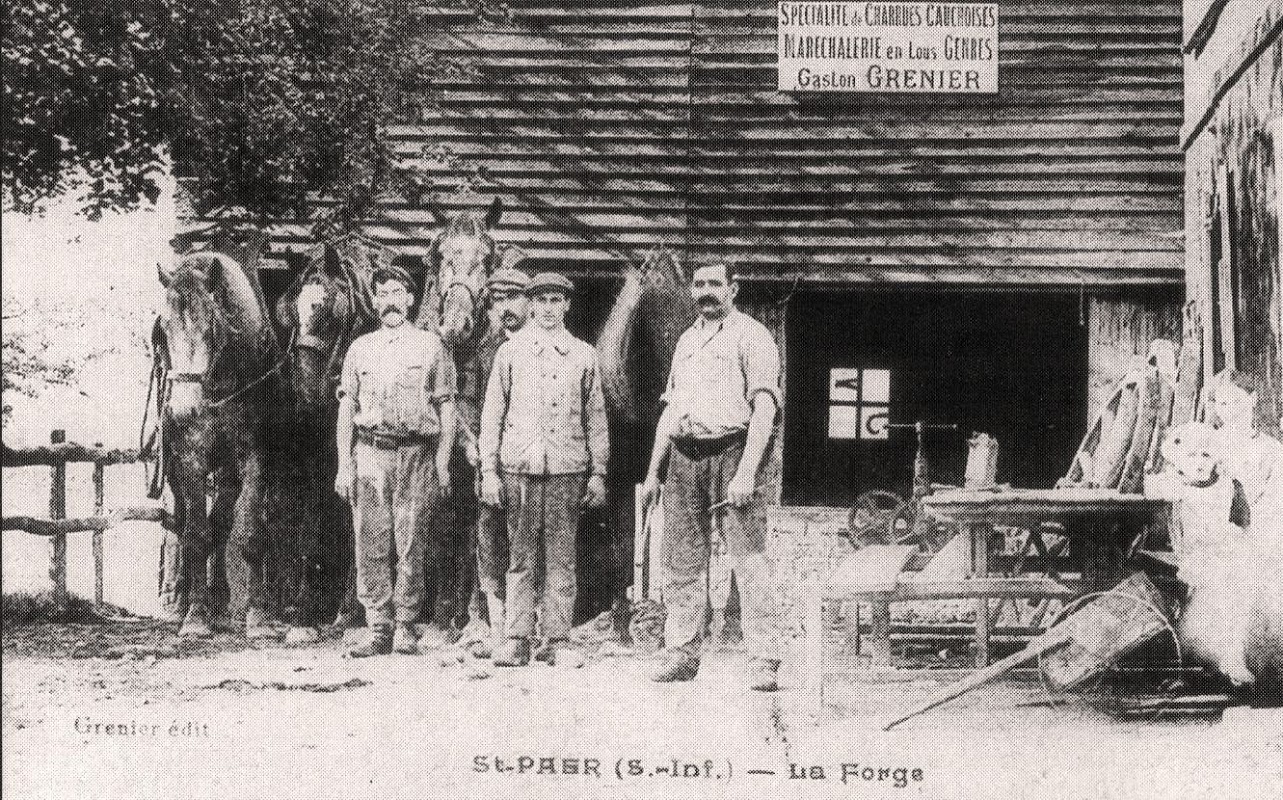
Le
12 janvier 1930, une tempête occasionna de gros
dégâts/ En 1930, Gaston Grenier, le
cafetier-épicier-forgeron, rendit son tablier. Il ouvrait
son
atelier dès 6h du matin pour arrêter ses
activités
à 19h. Entre temps, ils vous ferrait une trentaine de
sabots. Il
fabriquait lui même les fers de même que les roues
de
charrette et divers outils. Viret lui succède mais c'est
l'heure
de la machine agricole. Un concessionnaire lui fera concurrence. Viret
passera rapidement la main à Monsieur Marc.
Dans sa séance du 5 août 1932, le conseil radia Julia Quevilly, femme Lerebours, de la liste des bénéficiaires de l'assistance aux vieillards.
Février 1933 : malade, l'abbé Prunier est
contraint de quitter la paroisse. On lui doit beaucoup : la salle
paroissiale, près du presbytère, les bancs dans
la nef et la chapelle sud de l'église. L'abbé
Caniel lui succède.
Le 7 octobre 1934, Armand, comte de Maures de Malartic,
châtelain
et maire d'Yville est élu conseiller
général.

Les Quevilly occupèrent successivement deux maisons. La première appartenait à un certain Dané, paysan d'Hérouville. La seconde à Mme Etienne, l'épicière morte à 102 ans et qui avait adopté Madeleine Trouvé. En famille, les dimanches étaient, dit-on, bien arrosés.
Début
1935, les syndicats patronaux du textile mènenent une
nouvelle
offensive contre les salaires déjà bas depuis
cinq ans de
leurs quelque 15.000 ouvriers.
"Les plus misérables prolétaires de France", lance
l'Humanité.
"Le pays est magnifique des forêts vertes, de grasses
prairies,
des pommiers, des vaches, ça et là, des
châteaux
tourelles. Tout est luxe, abondance, richesse. Et cependant, au milieu
de cette nature qui crève de santé, les hommes
crèvent de faim." C'est que la soixantaine
d'usines est
détenue par une demi-douzaine de rapaces qui se marient
entre
eux, observent Communistes comme Socialistes ou Radicaux... Badin est
montré du doigt, lui qui loge ses ouvriers, les fait
s'approvisionner à sa coopérative pour empocher
loyers et
dépenses. On l'accuser aussi de pousser ses
employés dans
les bras des Croix de Feu.
Alors, à Barentin, à Pavilly, des
réunions
drainent leur monde, des municipalités, des
commerçants
soutiennent le mouvement, un comité populaire contre la
misère sera créé. C'est dans ce
contexte que, le
24 mars 1935, l'achevêque de Rouen, Mgr Ville-Rabelle, vient
baptiser le troisième cloche de l'église de
Saint-Paër. Portiques de verdure, armoiries, drapeau
pontifical
sont agencés à l'entrée de
l'église. Ici,
pas de manif, mais une procession dans les rues du village. C'est
l'heure de gloire de l'abbé Caniel. Le 14 mai suivant, on
apprrendra la mort de son prédécesseur. Quatre
jours plus
tard, Marcel Bersoult est élu maire de Saint-Paër.
En 1936, Henri est recensé avec son épouse à Maison-Blanche avec sa fille Argentine, ouvrière chez Leurens.
Le 18 juin 1936, Henri fut témoin d'une catastrophe, près de son usine alors dirigée par Monsieur Trépagny. Une explosion a secoué au petit matin le moulin du Paulu. Le feu menace les habitations voisines. Les pompes des sapeurs de Varengeville, renforcés par ceux de Duclair, sont en action. on fait la chaîne pour amener des sceaux de la rivière. En une heure, des tonnes d'orge sont grillées.
1936 toujours :
Un mort, deux blessés gisaient dans la voiture
H qui était en état d'ivresse, circulait à vive allure. Tout à coup, il jeta sa voiture contre un pylône. L'auto fit plusieurs tours sur elle-même, projetant ses occupants sur la route. A D fut tué sur le coup. Mme D et un de ses enfants furent grièvement blessés.
Sans se préoccuper du sort des victimes, J H regagna à pied son domicile distant de trois kilomètres et se coucha. C'est là que les gendarmes vinrent l'arrêter, deux heures plus tard, malgré une vive résistance.
 Au
centre de la photo est Monsieur Fiot, le bouilleur de cru, qui connut
une
fin tragique à Jumièges. la femme qui tient un
agneau
s'appelle Blanche.
Au
centre de la photo est Monsieur Fiot, le bouilleur de cru, qui connut
une
fin tragique à Jumièges. la femme qui tient un
agneau
s'appelle Blanche.
En
septembre 36, le bras de fer reste tendu entre syndicats ouvriers et
patronaux. Les premiers accusent les seconds de provoquer
eux-mêmes des grèves pour faire capoter les
contrats
collectifs.
En novembre 36, à Saint-Paër, un incendie ravage la
ferme de Daniel Carpentier.
En 1937, le 14 février, on bénit le vitrail
Notre-Dame de
Lourdes à l'occasion des vêpres. Un calvaire est
mis en
chantier. Les Quevilly apprirent que leur fils Raphaël se
mariait. Apprirent, car ils ne furent pas invités
à Saint-Mandé, dans la banlieue de Paris. C'est
par hasard, sur le marché de Duclair, que
Joséphine Chéron vit un jour venir à
elle une jolie blonde, André Mainberte. Sa belle-fille....

En attendant, la colère monte au bord de l'Austreberthe. L'union des syndicats des deux vallées organise une tournée de protestation pour le respect des 40 heures et des lois sociales. Elle réunit au passage 700 ouvriers à Pavilly, 200 à Duclair. A Barentin a lieu une grande manifestation.
Le 23 avril 1939, 1.500 ouvriers de la vallée de l'Austreberthe manifestèrent encore à Barentin à l'appel de l'union départementale de la fédération du textile.
Henri a pris sa retraite à 74 ans.
C'était en 1940. Tous les trois mois, chez le percepteur de
Duclair, Henri ira chercher ses 3,50 F. Mais pour l'heure, c'est la
guerre. En juin, deux Anglais sont abattus au calvaire par les
Allemands qui entrent dans Saint-Paër.
Chez les Quevilly vivait Angèle, affublée d'une
jambe de bois.
Augustine se plaignait souvent du côté.
Peut-être
mourut-elle d'un cancer. L'abbé Caniel l'enterra en octobre
1943. Elle n'a pas connu la Paix. A la mort de sa mère,
Angèle ayant également disparu, Amélie
Quevilly
vint vivre un temps avec mon grand-père.

Après six ans de veuvage, Henri Quevilly disparut le mardi 25 janvier 1949 en sa petite demeure du hameau de Maison-Blanche. A 81 ans, il n'avait plus de dents. La tradition familiale veut que les chevaux du corbillard improvisé eurent mille peine à le conduire au cimetière de Saint-Paër. La neige et le verglas régnaient alors en cette saison. Il fallut couper à travers champs. La fosse creusée pour recevoir son cercueil s'avéra trop petite. Si bien qu'aux coup de talons durent succéder les coups de pioche pour que la terre gelée digère enfin son catafalque.
Laurent QUEVILLY.
Pour suivre : Raphaël Quevilly 
Sources
Journal de Rouen.
Saint-Paër,
Pierre Molkhou.
Archives Raphaël Quevilly.
Philippe Montigny, époux d'une descendante de Xavier Heuchel.
