|
La largeur
de la Seine s'interpose : il n'est pas toujours facile de
la traverser mais c'est souvent utile ou nécessaire. Un
passage
n'a jamais vraiment été établi en
fonction des facilités
de traversée mais plutôt pour contenter une
clientèle.
Un passage devenu difficile, voire dangereux, n'est jamais
supprimé.
La première qualité d'un passage est
d'être proche
pour éviter un long détour par terre. De nombreux
riverains
eurent aussi longtemps leurs propres barques leur évitant
les inconvénients
des passages officiels.
1
- DEVOIR TRAVERSER :
DES CONTRAINTES
LE
PRIX DU PASSAGE :
- Les passeurs prélèvent un droit
sur l'usager pour son salaire
et l'amortissement de son matériel. Les tarif anciens
prévoient
aussi bien le panier que la voiture attelée de quatre
chevaux. Les
habitués des passages s'arrangent souvent avec le passeur
pour un
paiement à l'amiable, souvent en nature. Normal à
l'époque
des bacs à vapeur privés ; le prix pour
passer apparaît
injuste aux riverains dès que les passages sont
financés
par le Département et qu'ils paient leurs impôts
locaux tout
comme ceux qui empruntent une route départementale. Ce n'est
que
progressivement qu'ils obtiendront la gratuité.
L'ATTENTE :
 Cloche
du Passage de Yainville Cloche
du Passage de Yainville
|
 Maison
pour le gardien de nuit construite
en 1929 Passage de La Mailleraye, cale rive droite Maison
pour le gardien de nuit construite
en 1929 Passage de La Mailleraye, cale rive droite |
- L'attente est l'inconvénient le plus mal
vécu par les usagers.
Au temps des bachots et bacs
à rames, l'embarcation ne se trouve pas
toujours sur la bonne
rive. Il faut alors appeler
le passeur
en
hissant un drapeau ou en sonnant la cloche mais le plus souvent en
criant
à tue-tête.
- La motorisation des bacs permet
l'établissement d'horaires normalement
plus réguliers. Mais se pose très vite le
problème
d'une harmonisation avec l'ouverture des usines ou le passage du train
sur l'autre rive.
- L'interruption du passage pendant la nuit est
générale.
Gare à celui qui a raté le dernier bac!!!...
Avant 1959
et l'ouverture du pont de Tancarville, cela signifiait un
détour
par les ponts de Rouen.... déplacement impossible avant
l'automobile.
Un matelot de garde pouvant faire passer en cas d'urgence est, dans
l'entre-deux-guerres, l'une des grandes revendications des riverains. - L'attente
des usagers explique la formation, sur la
rive opposée
au bourg, d'un petit quartier comprenant au moins un café
traditionnellement
dit café
du bac ou du passage
et avant l'automobile un hôtel avec écurie : celui
de Bliquetuit,
face à Caudebec, peut en 1926 accueillir 70 chevaux.
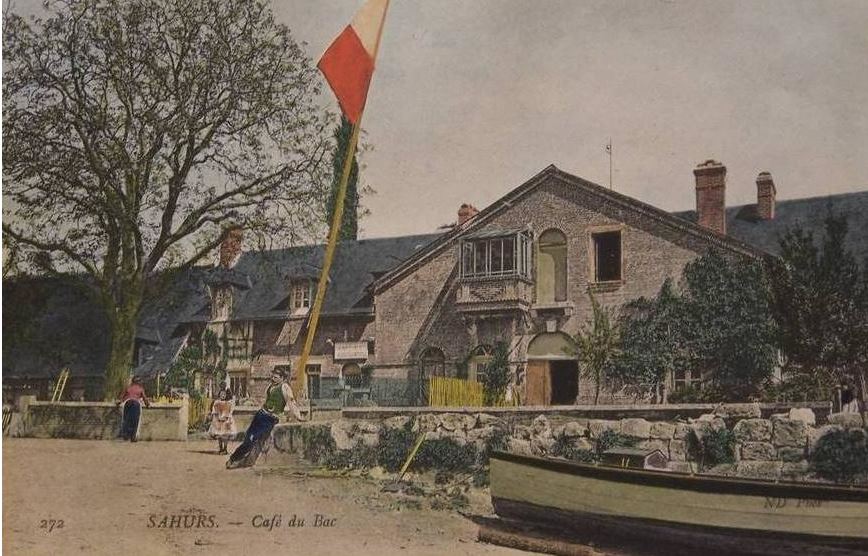
 LES
CONTRAINTES CLIMATIQUES : LES
CONTRAINTES CLIMATIQUES :
- Brumes, glaces, vents, hautes eaux, courants, mascarets
: autant de causes autorisant les passeurs à interrompre
leur service.
A eux d'en apprécier l'intensité et le danger....
Le père Aubé, passeur de La Mailleraye avant la
vapeur,
est célèbre pour "traverser par
n'importe quel temps,
même brumeux." Mais Tourant,
fermier du passage de La
Bouille, se voit en 1891 reprocher d'avoir "interrompu plus
volontiers
son service par temps de glace" que les passagers de Croisset
et Petit-Couronne. - De nos jours, seule la brume arrête
les bacs : celui de Duclair resta ainsi quatre jours en panne en
février
1981.
 |
 |
| Bac de Caudebec-en-Caux face au mascaret
(1958) photo Alain
HUON |
Bac de Duclair pris
dans les glaces (1987)
photo Gilbert FROMAGER |
LES ACCIDENTS :
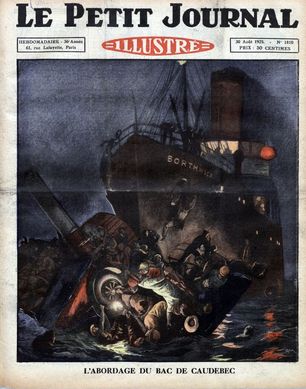
"L'ILLUSTRATION" collection
Musée de la Marine de Seine-Caudebec-en-Caux
Abordage du
bac de Caudebec-en-Caux par le charbonnier anglais
- Avec la vapeur, le grand danger est l'abordage par un
navire : le 16 août
1925, le charbonnier anglais Borthwick percute le bac de Caudebec,
faisant
quatre victimes.
- Les accidents ne peuvent être
considérés comme fréquents
mais provoquent toujours l'émotion. Le bétail est
délicat
à faire traverser : son affolement à
l'arrivée provoque
le 24 décembre 1776 le naufrage de la flette de
Jumièges...
Le 24 janvier 1792, le bac de Caudebec prend eau à
proximité
de la cale rive gauche.
UN CERTAIN LAISSER-ALLER :
Les
passagers semblent ne pas avoir toujours apporté le soin
nécessaire à leur service.
Jean
Allais, de Caudebec, est en 1774 accusé de laisser le public
attendre pendant des heures. Le même a en ce 24 janvier 1792
laissé
surcharger son bac.
Les
premières inspections des passages, à la
révolution,
trouvent de nombreuses embarcations "au tiers, à
demi ou entièrement
ruinées"....
Roger, à
Saint-Georges, en 1863, laisse son passage à un "vieux
pêcheur
valétudinaire" ...
et Riché,
à Jumièges en 1881, fait lui, "passer par un enfant".
Le
patron Leverge, ce soir du 16 août 1925, n'avait pas
allumé
les trois feux réglementaires sur son bac de Caudebec. Il
est de
plus constaté qu'il était en
"état d'ébriété".
Les
employés des passages, séjournant volontiers
au café
tout proche entre deux traversées, ont longtemps eu une
solide réputation
d'intempérance.
Le
règlement du premier bac à vapeur de Caudebec, en
1868, stipule ainsi que les "passagers auront le
droit de requérir
le remplacement immédiat d'un marin qui se trouverait en
état
d'ivresse".
2
- DES DÉPLACEMENTS
INCESSANTS
- Les plus nombreux à passer sont
les exploitants agricoles.
Le premier tarif départemental aux passages, indique
l'intention
de "favoriser l'agriculture". Le bétail -de l'oie
à la vache-
acquitte ainsi moins dès qu'il va ou vient du
pâturage ; "les
voitures et les chevaux occupés aux transports de la ferme
aux champs
et des champs à la ferme" ne doivent que la
moitié des
droits.
Julien Guillemart se souvient de son enfance à Vieux-Port
des
travailleurs d'usines de Lillebonne et Bolbec passant en août
pour
moissonner dans l'Eure. C'est le foin produit rive gauche sur les
nouvelles
prairies endiguées, vendu dans tout le pays de Caux, qui
motivera
en 1868 la modernisation du bac de Caudebec.
- Ce sont
ensuite les
marchés et les foires
qui suscitent les mouvements les plus nombreux. Déplacements
hebdomadaires
pour les marchés de chefs-lieux de canton situés
au sommet
d'un méandres : les habitants des boucles passent le bac.
 Le bac
à Duclair, jour de marché
Le bac
à Duclair, jour de marché
Le 24 janvier 1792,
Allais a laissé
surchargé son bac parce que c'était l'affluence
du jour de
marché.
Mais on vient de bien plus
loin : en 1798, pour
fixer le jour de son marché, Caudebec demande qu'on tienne
compte
de ceux de Bourg-Achard, Routot, Bourneville, Pont-Audemer, Corneville
et même Lisieux. Routot, Bourg-Achard et Le Neubourg sont
foires
aux bestiaux. On traverse à tous les passages pour s'y
rendre depuis
une grande partie du Pays de Caux et le bétail repasse,
surtout
à Jumièges et La Mailleraye, pour être
vendu.
=> La Seine ne recoupe
pas la zone d'influence
des bourgs tenant marché ou foire importants.
- Dès
leur création, les routes départementales
ont un numéro et une dénomination se poursuivant
sur les
deux rives de la Seine.
3 - L'AUTRE CÔTE
DE L'EAU...
- Dans le système des méandres,
les bourgs se sont développés
sur la rive concave.
Les grandes routes
reliant ces bourgs recoupent le pédoncule des
méandres et
pénètrent peu les boucles : celles-ci
dépendent totalement
des bourgs de la rive concave pour les démarches
administratives
et beaucoup de services. A la fin du XIXème
siècle, le chemin
de fer suit un tracé parallèle à la
route. Puis l'industrie,
au début du XXème siècle, s'implante
à proximité
de la voie ferrée. Les boucles y trouvent une nouvelle
dépendance
: celle de l'emploi.
- Chaque boucle reste donc comme rurale et
isolée. L'isolement
est plus fortement ressenti dans les presqu'îles de la rive
gauche,
rive dite de l'autre
côté de l'eau par
opposition à la rive droite où se situent les
centres de
décision : "Il est impossible de vivre
dans cette région
déshéritée sans passer la Seine
très souvent.
Toutes les administrations : chemin de fer, poste, perception,
marché
se trouvent sur la rive droite" disent en 1941 les maires de
la boucle
d'Anneville.
- Les paroisses de la boucle d'Anneville
sont dites en 1717 "closes
par le contour de la rivière de Seine et fermées
du côté
des terres par les bois et forêts de Mauny" et celles
de la
presqu'île de Brotonne en 1779 "séparées
du reste du monde et enclavées entre la Seine et la
forêt."
=> L'isolement des boucles de la rive gauche ne vient
donc pas uniquement
de la Seine mais également de la forêt.

La
Boucle de Brotonne en 1719
extrait : Gouvernement Général de
Normandie par B.
Jaillot
Les paroisses de la boucle de Brotonne dépendaient
à
l'origine de l'élection de Pont-Audemer et c'est ce
marché
que fréquentaient les habitants. En 1696, les dangers de la
forêt
de Brotonne, repaire de brigands, les firent rattacher à
l'élection
de Caudebec et les habitants prirent très vite l'habitude de
fréquenter
ce bourg. La traversée de la Seine est
préférée
à celle de la forêt.
Même phénomène
à Heurteauville : avant la
bénédiction de leur chapelle en 1732,
les habitants
préfèrent passer la Seine et aller à
la messe à
Jumièges plutôt que de traverser une partie de la
forêt
de Brotonne pour assister à l'office de la chapelle du Torp.
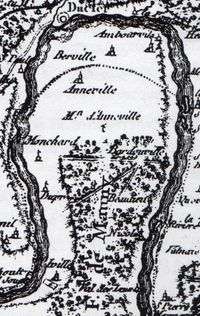 Et
toujours en 1955 : "les habitants de
la presqu'île
d'Anneville n'ont aucune relation avec le département de
l'Eure
dont ils sont séparés par une forêt
importante".
Boucle
d'Anneville en 1762.
L'idée
de Thomas Lindet, député à
l'Assemblée
Constituante, de donner au nouveau département de la Seine-
Inférieure
la rivière Seine comme limite naturelle ne
saura se réaliser
: les boucles de Brotonne et d'Anneville sont
intégrées à
des cantons de la rive droite et aucune de leurs communes ne reniera
cette
appartenance. Mais traverser reste une contrainte et
les riverains se dispensent
bien de le faire si cela est possible. Les habitants d'Heurteauville
sont
en 1732 soulagés qu'une chapelle, qu'ils ont
financée, leur
évite de traverser chaque dimanche. Les communes de la
boucle de
Brotonne exigent dès décembre 1790 d'avoir leur
propre juge
de paix : l'acceptation du Département en fait presque un
canton
avec La Mailleraye pour chef-lieu. Beaucoup d'actifs
préfèrent
ne pas habiter rive gauche pour ne pas être
dépendants dans
les horaires des bacs.
Seul le
pont de Brotonne, ouvert la nuit,
a véritablement désenclavé la
presqu'île.
Il n'y a
plus de passages pour piétons. L'ouverture du pont
de Tancarville, en 1959, a
condamné le bac du Hode mais les
habitants de Quillebeuf
ont
su garder leur bac pour éviter
un détour quand ils vont au travail dans les raffineries de
la rive
droite. Ce bac, le seul à être
interdépartemental,
pose cependant des problèmes de financement entre l'Eure et
la Seine-Maritime
et la question de son maintien revient périodiquement.
Le pont de Brotonne, en 1977, a
provoqué
la fermeture des bacs de Caudebec-en-Caux et La Mailleraye que
regrettent,
sauf nostalgie, bien peu de gens. Le passage de Jumièges est
très
souvent interrompu parce que son bac sert de remplaçant aux
autres
passages quand leur bac est en révision.
|
|
 |
|
Le
bac de Caudebec-en-Caux et les adieux aux équipages de
La Mailleraye et Caudebec. La veille de
l'inauguration du pont de Brotonne.
Photo : Alain HUON
|
 Le
tout nouveau, tout beau bac de Duclair laisse espérer qu'un franchissement
ne viendra pas défigurer le site de La Fontaine. Le
tout nouveau, tout beau bac de Duclair laisse espérer qu'un franchissement
ne viendra pas défigurer le site de La Fontaine.
....De
nombreux riverains vivent encore au rythme des
bacs.
|

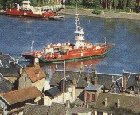 LES
RELATIONS
LES
RELATIONS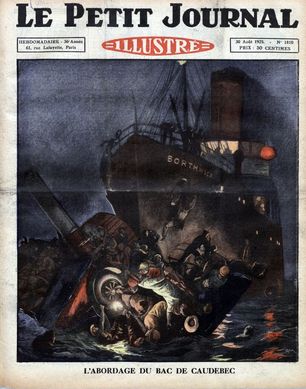


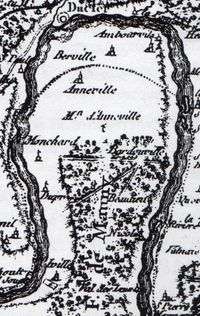 Et
toujours en 1955 : "les habitants de
la presqu'île
d'Anneville n'ont aucune relation avec le département de
l'Eure
dont ils sont séparés par une forêt
importante".
Et
toujours en 1955 : "les habitants de
la presqu'île
d'Anneville n'ont aucune relation avec le département de
l'Eure
dont ils sont séparés par une forêt
importante".  Le
tout nouveau, tout beau bac de Duclair laisse espérer qu'un franchissement
ne viendra pas défigurer le site de La Fontaine.
Le
tout nouveau, tout beau bac de Duclair laisse espérer qu'un franchissement
ne viendra pas défigurer le site de La Fontaine.
 Texte Jean-Pierre
DEROUARD
Texte Jean-Pierre
DEROUARD 


 Cloche
du Passage de Yainville
Cloche
du Passage de Yainville




