Par Laurent Quevilly
Précurseur de la révolution romantique, Ulric Guttinguer ne manquait pas une occasion de faire visiter Jumièges à ses amis. En 1839, il publia un recueil en prose et en vers sur ses ruines. L'ouvrage fit alors grand bruit. Il est aujourd'hui oublié...
Le plaisir aime les voyages,
Amis, parents, accourez tous.
Jeunes et vieux, folles et sages,
Embarquez-vous !
Amis, parents, accourez tous.
Jeunes et vieux, folles et sages,
Embarquez-vous !
 Qui, dans la rue, se
souvient de
vos
vers, Monsieur Guttinguer? Vous que l'on surnommait Le Cauchois, vous
qu'Adèle Hugo appelait l'Oncle
de Normandie...
Qui, dans la rue, se
souvient de
vos
vers, Monsieur Guttinguer? Vous que l'on surnommait Le Cauchois, vous
qu'Adèle Hugo appelait l'Oncle
de Normandie...Vous avez vu le jour à Rouen, le 31 janvier 1787.
Votre père, Jean-Ulric, y était né lui aussi. En 1742. C'était un négociant d'origine suisse...
En 1798, le voilà élu pour un an député de la Seine-Inférieure. Puis membre du conseil des Anciens. A Paris, son rôle est inexistant. Mais son adhésion au coup d'état du 18 Brumaire le propulse au Tribunat. Il y restera jusqu'à sa suppression, en 1807.
Retour à Rouen...
La fille du boucher de Duclair
Vous habitez au 35 de la rue Fontenelle. Près de chez vous, au 32, réside le procureur des finances, Jacques-André Gueudry. Ancien boucher à Duclair, il a fait fortune dans les fournitures de l'armée. Mais ça, c'est la légende.
 Sa fille en tout cas est fort
jolie. Elle
s'appelle Virginie.
Sa fille en tout cas est fort
jolie. Elle
s'appelle Virginie.Veuf, le vieux Gueudry meurt. Vous êtes bon danseur. Le tuteur de la belle
 orpheline,
M. Endeline, tenta bien de s'y opposer. Mais
vous avez
fini par l'épouser,
la riche héritière de 18 ans. C'était
le 21 février
1811. Elle vous apportait une dote de quinze millions de francs.
Protestant, vous vous engagiez à respecter sa religion. Et
permettre aux enfants qui vous viendraient de grandir dans le
catholicisme.
orpheline,
M. Endeline, tenta bien de s'y opposer. Mais
vous avez
fini par l'épouser,
la riche héritière de 18 ans. C'était
le 21 février
1811. Elle vous apportait une dote de quinze millions de francs.
Protestant, vous vous engagiez à respecter sa religion. Et
permettre aux enfants qui vous viendraient de grandir dans le
catholicisme.Vous faites de Virginie une femme. Votre femme. Et vous-vous installez à la Mi-Voie, propriété qu'elle possède près de Rouen. Belle demeure de style Louis XVI. Ignorez-vous que cette propriété plonge ses fondations dans la traite des noirs ? Mais Virginie a aussi hérité de la plupart des bois qui couvrent Saint-Gratien, près d'Honfleur.
Avec elle, vous auriez entrepris, face à la mer, la construction d'un chalet. Un chalet inspiré de ceux de la Suisse, le pays de vos racines. Je dis vous auriez car cela est faux.
Virginie mourut en 1819, vous laissant deux filles. La légende, encore la légende veut qu'une nuit, un orage sur le chalet lui occasionna une telle frayeur qu'elle développa dès lors la maladie qui allait la conduire au tombeau.
Virginie ! Vous tenterez de vous en consoler par l'écriture en fumant des cigarettes de tabac turc. Par le libertinage aussi. Avec Alexandrine Bouquet, Octavie, Rosalie... Alexandrine que vous finirez par épouser et qui vous donnera un fils. Alexandrine avec qui, loin de la légende, vous avez construit en réalité votre chalet, dix ans après la mort de Virginie. Mais il y avait là une source que l'on appelait Rouge-Fontaine. Vous avez écrit sur une ardoise, suspendue à un hêtre, "Fontaine-Virginie".
La Mi-Voie
 En 1820, vous
habitez le
château de Mi-Voie, à Amfreville. La Muse Française
de l'automne 1823 vous offre la consécration en vous
accordant
une large place. Près de votre signature, vous tenez
à
vous revendiquer Normand. Durant la saison 1824-1825, vous
voilà
président de l'Académie de Rouen et vous lancez :
"Être
romantique en littérature c'est chanter son pays..."
En 1820, vous
habitez le
château de Mi-Voie, à Amfreville. La Muse Française
de l'automne 1823 vous offre la consécration en vous
accordant
une large place. Près de votre signature, vous tenez
à
vous revendiquer Normand. Durant la saison 1824-1825, vous
voilà
président de l'Académie de Rouen et vous lancez :
"Être
romantique en littérature c'est chanter son pays..."
Vous quittez Amfreville en 1829 quand Musset vous publie dans ses Premières poésies. Votre inspiration vous vient, dira-t-on, d'une peine de cœur qui, alors que vous aviez plus de 40 ans, a traversé comme l'éclair toute une vie de plaisir.
 Dès
lors, vous vivrez dans votre chalet de Saint-Gatien. Recevant Hugo,
Dumas, Sand, Sainte-Beuve, Chopin, Gautier, Flaubert... Les chefs de
file du
romantisme vous hissent dans leur nacelle. Charles Nodier, Alfred de
Vigny
tiennent votre poésie en haute estime. Vous collaborez
à La
revue
du Corsaire.
Dès
lors, vous vivrez dans votre chalet de Saint-Gatien. Recevant Hugo,
Dumas, Sand, Sainte-Beuve, Chopin, Gautier, Flaubert... Les chefs de
file du
romantisme vous hissent dans leur nacelle. Charles Nodier, Alfred de
Vigny
tiennent votre poésie en haute estime. Vous collaborez
à La
revue
du Corsaire. En 1826, vous aviez déjà publié dans les Annales romantiques un poème intitulé Charles VII à Jumièges. En 1835, La Revue de Rouen reproduisait Une nuit à Jumièges. Vous vous apprétiez alors à quitter la Normandie. Jumièges avait été l'une de vos premières sources d'inscipiration. Un recueil va suivre...
Jumièges
Souvent,
cher
Casimir, je pense à vos ruines
Qu'entourent au printemps les blanches aubépines
Qu'entourent au printemps les blanches aubépines
En 1839, Nicétias Périaux, l'éditeur de Rouen, publie le Jumièges d'Ulrich Guttinguer. Voilà déjà dix ans que Charles-Antoine Deshayes a signé chez Baudry sa fameuse Histoire de l'abbaye royale. Si l'on exclut le Voyage pittoresque de Taylor et Nodier, on peut donc considérer l'ouvrage de Guttinguer comme le second consacré exclusivement à Jumièges. A cette époque, des vapeurs déversent déjà des flots de visiteurs à travers les ruines. Guttinguer se dit parmi les premiers à avoir arpenté de longue date Jumièges. Il y est revenu régulièrement depuis l'enfance. Écrivant au fil du temps plusieurs poèmes qu'il se propose de rassembler, d'agrémenter dans un recueil. Certains sont ainsi datés : "Jumièges, 25 août 1833". Cet été-là, un couple d'érudits anglais, les Foloppe, visitèrent l'abbaye. Et ne purent éviter Deshayes qui, à l'auberge Savalle, vendait son ouvrage à l'aide d'une affiche.
Guttinguer aurait écrit un jour sur les murs du chapitre de l'abbaye :
Du
besoin du passé
notre âme est poursuivie
Et sur les pas du temps l'homme aime à revenir
Il faut au jour présent de la plus belle vie
L'Espérance et le Souvenir
Et sur les pas du temps l'homme aime à revenir
Il faut au jour présent de la plus belle vie
L'Espérance et le Souvenir
J'ai ici entre les mains l'édition originale de Jumièges. 216 pages de taille inégale, roussies par le temps.
 De quoi se
compose cet objet
rare ?
De quoi se
compose cet objet
rare ?1 D'abord d'une évocation en prose de Jumièges, divisée en huit chapitres.
2 Suit une dissertation sur la légende des Énervés.
3 Viennent ensuite sept poésies sur Jumièges.
4 Le tout s'achève par des poèmes divers.
Des lithographies de Nicolas Périaux illustrent ces pages. Feuilletons-les...
"Qu'on nous permettre cette opinion peut-être présomptueuse : l'histoire de l'abbaye de Jumièges peut avoir été écrite, soit dans des ouvrages consciencieux et estimables, soit dans des articles agréables et spirituels ; mais la véritable impression de ces lieux n'a point été rendue..."
Telles sont les premières lignes qui justifient toutes celles qui vont suivre. Pour Guttinguer, aucun écrit n'a encore restitué la poésie du lieu. "Châteaubriand ! Voilà l'historien, le poète que nous implorons pour Jumièges, car le génie du christianisme est là aussi..." Guttinguer recommande cependant la lecture du Voyage pittoresque. Mais aucune allusion à Deshayes dont le livre est pourtant en vente sur place. Deshayes à qui Taylor et Nodier doivent leur chapitre sur Jumièges.
Maintes fois Guttinguer aura parcouru les ruines de Jumièges. Seul ou en compagnie de Caumont avec qui il partageait, non seulement l'amour des pierres mais aussi celui du libéralisme. Souvent, il aura conduit du monde à Jumièges et voici ses conseils :
Savant, voyageur, pélerin, homme de sentiment ou du monde, vous n'avez que l'embarras du choix et du beau pour arriver à Jumièges, quand vous avez quitté Paris.
Les bateaux à vapeur vous prendront à Saint-Germain-en-Laye, si cette voie vous tente, et vous berceront pendant cinquante lieues, dans leurs frais et jolis paysages ; ils vous remettront à d'autres bateaux à Rouen, qui auront les mêmes tableaux à vous offrir, mais plus grands, plus vastes, plus imposants, et animés par toutes ces voiles venues des hautes mers et vous faisant pressentir l'Océan et ses grands spectacles.
On vous laissera, à la hauteur des tours de Jumièges, sous des ormes touffus, entre des collines qui resserrent étroitement le fleuve en cet endroit, et le rendent calme et limpide comme un des gracieux lacs de la Savoie.
Une fois débarqués, vous n 'avez plus que quelque pas à faire pour frapper à la porte de l'antique monastère, qui s'ouvrira aussitôt, n 'en doutez pas.
Pourtant, je ne vous conseille point cette voie, par une raison que je vous prie de me pardonner, c'est que je ne l'ai point suivie.
La vapeur m'est antipathique, comme les voyages en commun, et ce mot me sert à merveille. Nul bonheur, nulle paix, nulle rêverie possible dans ce bruit du balancier monotone, de ces roues et de ces chaudières, au milieu de mille curieux, fâcheux, indiscrets, qui mangent, boivent et parlent (qui pis est), mêlant
tous les besoins et toutes les industries à la belle nature, dont le calme, l'accord et les parfums sont ainsi troublés et rompus.
La route de terre, avec ses collines boisées, ses forêts que vous traversez et où s'ouvrent de ravissantes clairières sur d'immenses et délicieux horizons, me paraît en tous points préférable, surtout si vous pouvez la parcourir en calèche découverte et traînée par nos bons et vigoureux chevaux normands.
Vous sortez de Rouen par une splendide avenue d'ormes qui vous conduit au charmant village de Bapaume, berceau du grand Corneille.
Vous grimpez la rapide et tournoyante montagne de Canteleu, qui vaut bien qu'on s'y arrête quelques heures pour voir les merveilles de nature et d'art qu'y accumule, avec une patience et un goût persévérants, un des premiers artistes de jardins de France, M. Elie Lefebvre.
Le chemin devient ferme et onduleux, facile et orné comme une route anglaise.
La Seine, que vous venez de quitter, vous apparaît bientôt de nouveau du haut des coteaux de Saint-Georges-de-Bocherville, et vous la côtoyez au milieu des oseraies et des pommiers, jusqu'au bourg de Duclair, où vous relayez sur les bords du fleuve, au milieu des rames et des voiles qui se croisent sans cesse à ce passage, ou jettent l'ancre pour attendre le flux, à l'abri des belles îles qui font de la Seine un lac enchanté. Les chevaux attelés, vous irez à Jumièges. En sortant de Duclair, le postillon se jette subitement à main gauche dans une traverse assez triste, mais aussi bonne qu'une traverse peut l'être.
— Sommes-nous loin de Jumièges, postillon... ?
— A deux pas.
L'impatience vous prend, car vous ne savez pas peut-être ce que c'est que les deux pas d'un paysan normand : on dirait qu'il les fait avec des bottes de sept lieues.
Jumièges ! Jumièges !... Où donc est Jumièges ?
Des terres maigres, quoique cultivées, des champs, de courtes forêts se succèdent sans que vos regards qui interrogent l'horizon, découvrent autre chose que des blés ou des avoines.
Jumièges, au fond d'un bourg et d'un pli du terrain, ne vous apparaîtra que lorsque vous pourrez, pour ainsi dire, le toucher de la main."
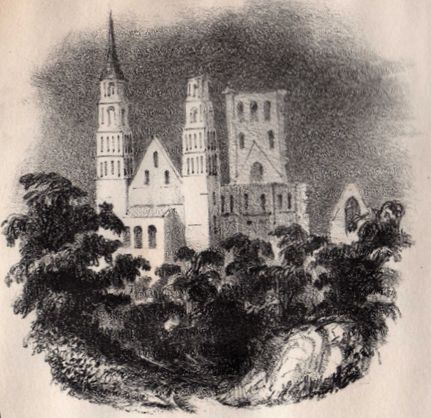
L'une des illustrations contenues dans le livre de Guttinguer. Ici, l'abbaye coiffée d'un seul clocher. Le premier est tombé en 1829.
Guttinguer a manifestement pris la route de Yainville pour parvenir, "à la fin d'un beau jour d'été, à l'entrée du bourg de Jumièges".
Et de brosser, à son arrivée aux ruines, l'historique sommaire qui, selon lui, manque au visiteur. Dans cet exercice, Guttinguer se montre meilleur poète qu'historien. Il situe en 1777 le saccage du tombeau d'Agnès Sorel par les Calvinistes et attribue aux Révolutionnaires de 93 sa dispersion.
La nuit tombe. Nous allons visiter le vieux moutier à la lueur des torches. Guttinguer va se servir d'un personnage pour brosser avec lyrisme l'épopée de l'abbaye. "Un voyageur suivait ces flambeaux, et, m'avançant vers lui, je reconnus pour un ami, peintre et antiquaire distingué que je n'avais pas vu depuis longues années." Il venait, nous dit-il, contempler l'abbaye encore une fois. Depuis longtemps, il visitait chaque année ce lieu où ses crayons et sa plume trouvaient sans cesse un nouvel aliment." On pense à Langlois. Et Langlois se livre à un long descriptif des murs. "En 1820, vous eussiez vu encore, au sommet de ces murailles, les quatre évangélistes et un ange adorateur d'une admirable exécution. Tout cela, et les chapiteaux des colonnes, a été conquis par l'Angleterre en pleine paix, et on ne saurait dire comment." C'est là un des thèmes récurrents de l'époque : les Anglais ont pillé l'abbaye, emporté pierre par pierre le cloître...
Au fil des pages, Guttinguer nous fait visiter les chapelles, les souterrains d'où fuient des nuées de chauve-souris. Ce soir-là, Guttinguer dormit dans la Chambre des Dames.
Le lendemain fut pour le manoir d'Agnès, au Mesnil : "Éveillés de bonne heure par le beau temps et par notre désir, nous prîmes, dans la rosée, le sentier du jardin qui conduit à la porte d'Agnès. Elle ouvre sur le chemin rural qui porte le même nom. La route est fort agreste ; et parée seulement de ces galants églantiers si fleuris au mois où nous la parcourions. Ce sont ces buissons que les Anglais nomment si bien sweet briard, douce bruyère.
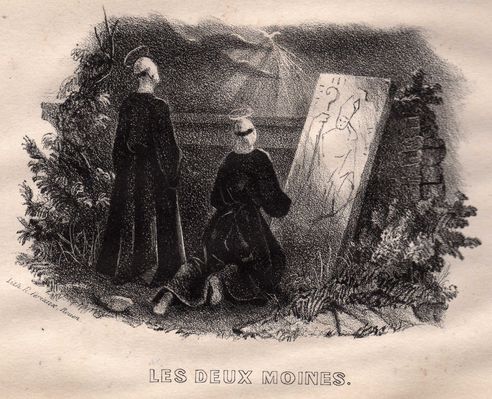
L'un des thèmes du livre : les deux moines retrouvant dans les ruines de l'abbaye l'effigie de Philibert.
Les chemins et les champs répandus à l'entour, portent des noms bien faits pour éveiller les douces réflexions et les souvenirs poétiques. Ce sont : la rue Main-Berthe (sic), le Val-Rouge, le Hamel, le Druglan, le Cols de la Ruine, les Fonds du Roi, les Quatre-Camps, le Tombeau des Sarazins, les Anneaux, le Camps des Vieux, etc. Chacun d'eux est comme le titre d'une chronique."
La manoir déçoit Guttinguer. Tout à disparu. Si ce n'est de grandes fenêtres, quelques bancs de pierre. "Enfin, vis-à-vis de ces fenêtres, une salle où l'œil découvre, avec quelque peine, près du plafonds, une ligne d'écussons effacés par la haine et l'envie révolutionnaire plus que par la main du temps.
De tous ces bâtiments, on a composé un corps de ferme très sombre, qui donne peu d'émotions..."
Guttinguer et ses amis passèrent encore quelques nuits à Jumièges. Ce séjour n'est malheureusement pas daté. Puis un post-scriptum (chapitre VIII de la première partie) fait état d'un nouveau voyage. "Le relais de Duclair se faisait attendre (espérer, comme on dit en Normandie); on vint nous avertir que nous n'aurions de chevaux que dans la vesprée (soirée)". Nouvelle description des ruines. Mais cette fois, on se met en tête de reconnaître l'endroit où débarquèrent les Énervés. "Un bateau de pêcheurs, au moment où nous arrivions, arrêté sur l'onde molle et soulevée, à cette heure, du flux que les marins appellent étale, ravivait en nous ce lointain et triste souvenir..."

Illustration de la quatrième de couverture.
Aux chapitres en prose succède justement une dissertation sur la légende des Énervés. Guttinguer y croit. L'affaire est alors en débat. Viennent alors sept poèmes. Le premier dédié à Charles Nodier. Le second, Méditation, va à Mme la Comtesse d'A... et parle encore d'Agnès Sorel. Le troisième, voué à Casimir Caumont, reprend le thèmes des deux moines, Gaudouin et Gandoin, qui relevèrent les ruines. Le quatrième s'intitule Charles VII à Jumièges. Il est daté du 25 août 1833. Une note de bas de page laisse entendre que Guttinguer a eu entre les mains le manuscrit sur l'histoire de Jumièges. Un cinquième, Gemitus ou Gemma, s'interroge sur l'éthymologie de Jumièges. Le dernier, Minuit, date de juillet 1838.
L'ouvrage se termine par des poésies diverses sans rapport avec le sujet principal.
La critique
Aussitôt sa publication, la critique est favorable. Voici ce qu'en dit la Revue de Rouen et de Normandie.
 Jumiéges ! Voici un nom bien populaire dans notre belle
province, un nom poétique et rêveur entre tous
ceux qui
consacrent
le sol de la Normandie , un de ces noms qui réveillent le
mal du
pays quand on les entend prononcer sur la terre
étrangère. N'y a-t-il pas, en effet, des lieux
qui
semblent caractériser la patrie dans tous ses attributs, et
la
peindre avec tous ses enchantemens ? Et, pour nous du moins,
Jumiéges est un de ces lieux idéalisés
: nous y
retrouvons la Normandie tout entière ; sa poésie
d'abord
dans ces ruines grandioses qui témoignent d'une foi
maintenant
à demi éteinte ; son génie
matérialiste et
puissant, dans ce beau fleuve qui en paraît
l'emblème ou
plutôt le Dieu protecteur ; enlin la magnificence de sa
richesse
et de sa beauté , dans ces horizons immenses où
resplendissent et s'accumulent toutes les productions de la nature. Que
notre antique Jumiéges ait donc chaque jour ses visiteurs et
ses
pèlerins , il a de quoi justifier cet empressement.
Toutefois,
et même en mettant à part les
étrangers, combien,
parmi ces curieux qui, fidèles à
l'activité
normande, s'en vont à l'échappée
visiter la pieuse
abbave, combien, dis-je, l'ont vue sans la connaître, ou, qui
pis
est encore, sans l'apprécier ! Et cela seulement faute d'un
poète ou d'un historien qui leur servît de guide
et de
compagnon. Aussi est-ce comme possédant toutes les
qualités que réclament ces bienveillantes
fonctions, que
nous signalons aujourd'hui à nos compatriotes le livre de M.
Ulric Guttinguer.
Jumiéges ! Voici un nom bien populaire dans notre belle
province, un nom poétique et rêveur entre tous
ceux qui
consacrent
le sol de la Normandie , un de ces noms qui réveillent le
mal du
pays quand on les entend prononcer sur la terre
étrangère. N'y a-t-il pas, en effet, des lieux
qui
semblent caractériser la patrie dans tous ses attributs, et
la
peindre avec tous ses enchantemens ? Et, pour nous du moins,
Jumiéges est un de ces lieux idéalisés
: nous y
retrouvons la Normandie tout entière ; sa poésie
d'abord
dans ces ruines grandioses qui témoignent d'une foi
maintenant
à demi éteinte ; son génie
matérialiste et
puissant, dans ce beau fleuve qui en paraît
l'emblème ou
plutôt le Dieu protecteur ; enlin la magnificence de sa
richesse
et de sa beauté , dans ces horizons immenses où
resplendissent et s'accumulent toutes les productions de la nature. Que
notre antique Jumiéges ait donc chaque jour ses visiteurs et
ses
pèlerins , il a de quoi justifier cet empressement.
Toutefois,
et même en mettant à part les
étrangers, combien,
parmi ces curieux qui, fidèles à
l'activité
normande, s'en vont à l'échappée
visiter la pieuse
abbave, combien, dis-je, l'ont vue sans la connaître, ou, qui
pis
est encore, sans l'apprécier ! Et cela seulement faute d'un
poète ou d'un historien qui leur servît de guide
et de
compagnon. Aussi est-ce comme possédant toutes les
qualités que réclament ces bienveillantes
fonctions, que
nous signalons aujourd'hui à nos compatriotes le livre de M.
Ulric Guttinguer.  La mission d'historien y est suffisamment remplie à l'aide
de
quelques notes succinctes sur les principaux
événements
dont Jumiéges a été le
théâtre et le
témoin, et sur tous les faits relatifs à
l'abbaye ou
à ses chefs spirituels. L'auteur n'a point
ménagé
avec une attention moins scrupuleuse la place que réclamait
la
tradition locale : dans une critique spécieuse et
entraînante en faveur de la légende des
Enervés, M.
Guttinguer nous donne quelques extraits du poème de Sainte
Bautheuch. Nous le félicitons d'autant plus de ce soin,
qu'il en
a complété l'effet en accompagnant ces citations
d'une
traduction en vers qui révélera aux lecteurs peu
érudits les beautés de cette poésie
naïve et
originale , trésors brillans enfouis sous des mots obscurs ,
beautés attrayantes déguisées par les
tours
surannés du vieux langage. Puis encore, à chaque
pas de
son pèlerinage, M. Guttinguer retraçant
à nos
regards les images vivantes du passé, harmonise la
scène
avec les événemens, les paysages avec les
souvenirs, dans
des tableaux pittoresques et animés dont la succession
produit
une sorte d'enivrement poétique qui doit exalter les
imaginations les plus froides.
La mission d'historien y est suffisamment remplie à l'aide
de
quelques notes succinctes sur les principaux
événements
dont Jumiéges a été le
théâtre et le
témoin, et sur tous les faits relatifs à
l'abbaye ou
à ses chefs spirituels. L'auteur n'a point
ménagé
avec une attention moins scrupuleuse la place que réclamait
la
tradition locale : dans une critique spécieuse et
entraînante en faveur de la légende des
Enervés, M.
Guttinguer nous donne quelques extraits du poème de Sainte
Bautheuch. Nous le félicitons d'autant plus de ce soin,
qu'il en
a complété l'effet en accompagnant ces citations
d'une
traduction en vers qui révélera aux lecteurs peu
érudits les beautés de cette poésie
naïve et
originale , trésors brillans enfouis sous des mots obscurs ,
beautés attrayantes déguisées par les
tours
surannés du vieux langage. Puis encore, à chaque
pas de
son pèlerinage, M. Guttinguer retraçant
à nos
regards les images vivantes du passé, harmonise la
scène
avec les événemens, les paysages avec les
souvenirs, dans
des tableaux pittoresques et animés dont la succession
produit
une sorte d'enivrement poétique qui doit exalter les
imaginations les plus froides. Toutefois, notre conscience de critique nous contraint à
rejeter
l'une de ces fantaisies. Nous voulons parler de la scène
nocturne où Jeanne d'Arc nous est montrée sous
les traits
d'un ange contemplant tristement le supplice éternel
infligé à ses bourreaux et à ses
détracteurs. Au nombre de ces derniers, l'auteur n'a pu
manquer
de placer Voltaire en première ligne. (...)
Toutefois, notre conscience de critique nous contraint à
rejeter
l'une de ces fantaisies. Nous voulons parler de la scène
nocturne où Jeanne d'Arc nous est montrée sous
les traits
d'un ange contemplant tristement le supplice éternel
infligé à ses bourreaux et à ses
détracteurs. Au nombre de ces derniers, l'auteur n'a pu
manquer
de placer Voltaire en première ligne. (...)
Lisez
encore l'épilogue, que nous voudrions reproduire en entier,
pièce pleine de chaleur et d'entraînement, et qui,
au
milieu de l'expression du plus vif enthousiasme pour la patrie, trahit,
par quelques accents d'une tristesse déchirante, les regrets
navrans des souvenirs éteints.
Aussi le poète s'écrie-t-il :
Aussi le poète s'écrie-t-il :
Heureux, vous qui venez sur cette belle rive,
Sans avoir dans le sein cette note plaintive :
Le souvenir amer d'un passé sans retour ;
Oh ! vous ne verrez pas mon pays sans amour !
En lui tout doit parler à vos ames éprises ;
Les arbres et les tours, les tombes, les églises,
L'océan où le fleuve, en ses détours fleuris,
Vous conduit et se perd devant vos yeux surpris.
La Suisse et ses chalets, les Alpes dentelées,
N'ont rien de plus riant que nos fraîches vallées ;
Ses glaciers et ses lacs n'ont point d'aspects plus beaux
Que nos golfes d'azur sillonnés de vaisseaux.
Les donjons féodaux des Hautes-Pyrénées
Ne parlerons pas mieux aux âmes étonnées,
D'armes, de chevaliers, de nains, de négromans,
Que les murs écroulés de nos vieux chefs normands.
Puis,
en regard de ces
poésies touchantes, voyez ce spirituel sonnet sur
l'étymologie de Jumièges.
D'où vient ton nom, Jumiéges ? Ils ne sauraient le dire ;
O vanité de l'homme et surtout du savant !
Gemitus ou Gemma : « douleur » ou « diamant » :
Il faut vous décider, mes confrères, sans rire.
Cela vaut l'in-quarto : mettez-vous à l'écrire.
L'auteur, de l'Institut sera correspondant ;
Si le monde moqueur rit du livre pédant,
A lui seul reviendra le plaisir de le lire ;
C'est quelque chose encore. En attendant, je veux
Sur un sujet si grave émettre un avis sage ;
Ce n'est ni l'un ni l'autre, ou bien c'est tout les deux,
Choisissez : tous les deux me plairait davantage ;
L'histoire de ce cloître et de ces monuments
Montre autant de trésors que de gémissements.
Nous
ajouterons seulement à cela que tous ceux qui
feront le
pèlerinage de Jumiéges par un temps propice et en
compagnie aussi bonne que le livre de M. Ulric Guttinguer, trouveront
assurément que la terre gemétique est
plutôt la
terre des trésors que celle des gémissements.
A.
B.
Lorsque Casimir Caumont, propriétaire des ruines, vient à mourir, Guttinguer publie une notice nécrologique dans le Corsaire du 28 avril 1852 :
Il y avait un nom uni aux ruines de Jumièges, la sainte et grande abbaye normande, celui de Casimir Caumont qui en était à la fois le propriétaire et le conservateur (Ces ruines sont debout et le resteront longtemps encore). Mais celui qui, il y a déjà près de trente ans, les environna de jardins charmants, déblaya les cours de l'antique manoir de Jumièges et cela avec le goût, le discernement et l'enthousiasme d'une âme élevée, Monsieur Casimir Caumont, n'est plus. La mort vient de le saisir au milieu de ces mêmes ruines où il conviait souvent avec un si juste orgueil amis, savants, poètes et artistes.
Guttinguer était de ceux-là et, voici dix jours, son vieil et fidèle ami l'avait encore invité "à venir revoir ces ruines que le premier j'ai chantées dans des poèmes bien au-dessous de la splendeur d'un tel sujet."
Que vont devenir maintenant les ruines de Jumièges ? Guttinguer comme beaucoup espère qu'elles échapperont aux barbares.
Mais notre plus grande préoccupation n 'est point là, elle estdans la douleur dont notre cœur est brisé en pensant au sincère ami que, pendant cinquante années, nous avons connu si affectueux, si aimable, si dévoué, et que nos regrets, comme nos éloges, suivront dans une tombe qui va s'élever, sans doute, au milieu de tous les grands souvenirs et des beautés naturelles qui appellent à Jumièges les nombreux amis de notre Normandie et le pèlerinage des cœurs sympathiques.
Son œuvre
 Qu'avez vous
encore écrit, Monsieur Guttinguer? Mélanges
poétiques, Arthur,
des fables dédiées
au duc de Montpensier, une tyrolienne à la gloire de la
princesse Louise, la fille du roi...
Qu'avez vous
encore écrit, Monsieur Guttinguer? Mélanges
poétiques, Arthur,
des fables dédiées
au duc de Montpensier, une tyrolienne à la gloire de la
princesse Louise, la fille du roi...Mais qui se souvient de vos vers, Monsieur Guttinguer?
Un temps, on polémiquera sur l'orthographe de votre nom. Vous appeliez-vous Guttinguer ou Guttinger? La Revue anecdotique de 1862 assure que le vrai nom de notre poète est Guttinger ; "mais il faut faire observer qu'Ulric signait comme son père, tribun sous le Consulat, lequel, Allemand d'origine, avait jugé opportun de franciser son nom." Votre père, Jean-Ulric, tenait en réalité ses origines de Wilfenden, en Suisse, où il naquit de Daniel Guttinguer et d'Elizabeth Notzby. En avril 1785, à Rouen, Jean-Ulric, alors marchand, épouse Marie-Rose Filleul, demeurant Saint-André-de-la-Ville. Elle est la fille de Nicolas Marchand, lui même marchand à Journy-en-Vexin et de feue Marie-Catherine Catel.
Bref, la notoriété s'attachait encore à vous qui êtes mort le 21 septembre 1866. Vous habitiez alors au 6 de la rue Frochot, à Paris, depuis 1836. Vos héritiers avaient déjà vendu la Mi-Voie à l'industriel Édouard Rondeaux, le grand-père maternel de Gide. Le chalet près d'Honfleur fut cédé à un certain Dubourg.
Annoncée tardivement, la mort de Guttinguer ne fit guère d'effet en Normandie. Il avait abandonné de longue date la poésie pour le journalisme à Paris. Mais l'Académie de Rouen se souvint de lui...
L'hommage de l'Académie de Rouen
 Un
des plus
anciens membres de l'Académie, M. Ulric
Guttinguer, est
également décédé,
à Paris, depuis la clôture de nos
séances, à l 'âge de quatre-vingt-trois
ans.
Un
des plus
anciens membres de l'Académie, M. Ulric
Guttinguer, est
également décédé,
à Paris, depuis la clôture de nos
séances, à l 'âge de quatre-vingt-trois
ans.
Né
à Rouen, et fils d'un ancien député de
l'Empire , il se livra, dès sa jeunesse, à la
littérature. Il débutait, en 1812, par un
poème, ayant pour titre : Godfin, ou les Mineurs
sauvés. Associé plus tard au mouvement
romantique, il devint un des collaborateurs du journal La
Muse française. Ses Mélanges
poétiques, qui ont eu plusieurs
éditions, reproduisent les nombreuses et remarquables
pièces qu'il avait publiées dans ce Recueil
littéraire.
On lui doit encore : Charles VII à Jumièges et Edith, poèmes ; un Recueil d'Elégies ; des Fables et des Méditations ; Les deux Ages du poète ; Un dernier Amour, ouvrage en vers et en prose ; des romans, des lettres critiques, et des articles extraits de divers journaux et particulièrement du Corsaire, dont il fut longtemps un des rédacteurs.
On lui doit encore : Charles VII à Jumièges et Edith, poèmes ; un Recueil d'Elégies ; des Fables et des Méditations ; Les deux Ages du poète ; Un dernier Amour, ouvrage en vers et en prose ; des romans, des lettres critiques, et des articles extraits de divers journaux et particulièrement du Corsaire, dont il fut longtemps un des rédacteurs.
M.
Guttinguer avait été élu membre
résidant de l'Académie, en 1813; la
présidence lui fut conférée en 1825.
En 1829, il passa dans la classe des correspondants.
L'Académie a publié dans ses Précis annuels, plusieurs de ses compositions. La lecture de ses fables, dont il lui réservait habituellement les prémices, était toujours accueillie par elle avec une faveur méritée. Homme du monde, en même temps que littérateur, il se faisait remarquer par la distinction et par l'urbanité de ses manières. Son discours de réception à l'Académie présentait le développement de cette pensée: que le plus doux emploi que l'homme du monde puisse faire de ses loisirs, est de les consacrer à la culture des lettres. Il fut lui-même, pendant toute sa vie, fidèle à ce précepte. Vétéran des lettres françaises, il écrivait encore, dans ses dernières années, des œuvres qui avaient conservé toute la chaleur du jeune âge.
L'Académie a publié dans ses Précis annuels, plusieurs de ses compositions. La lecture de ses fables, dont il lui réservait habituellement les prémices, était toujours accueillie par elle avec une faveur méritée. Homme du monde, en même temps que littérateur, il se faisait remarquer par la distinction et par l'urbanité de ses manières. Son discours de réception à l'Académie présentait le développement de cette pensée: que le plus doux emploi que l'homme du monde puisse faire de ses loisirs, est de les consacrer à la culture des lettres. Il fut lui-même, pendant toute sa vie, fidèle à ce précepte. Vétéran des lettres françaises, il écrivait encore, dans ses dernières années, des œuvres qui avaient conservé toute la chaleur du jeune âge.
Dans les anthologies
 Guttinguer
[Ulric], fils d'Ulric Guttinguer,
député, tribun,
puis
directeur de la banque de Rouen, est né dans cette ville en
1785. Adonné avec ardeur, depuis l'âge de
vingt-cinq ans,
à la culture des lettres, M. Ulric Guttinguer a
soupiré
des vers charmants, pleins de grâce, de fraîcheur
et
d'abandon. Président de l'Académie de Rouen,
lié
d'amitié avec les chefs hardis de la croisade romantique, il
a
brillé parmi eux par l'élégance
rêveuse de
sa poésie. La
Muse française, recueil
publié sous
les auspices de MM. V. Hugo, A. de Vigny et Ém. Deschamps,
et
qui fut comme le miroir de ce temps de passion littéraire,
accueillit ses confidences élégiaques. En 1821,
il
réunit ces pièces dans ses Mélanges
poétiques, et publia successivement le roman
religieux
d'Arthur,
un recueil d'Élégies, des Fables, des Nouvelles,
les Deux
âges du poète, les Pensées et
impressions d'un
campagnard, et beaucoup de morceaux
détachés qui
révèlent tous un homme d'esprit, de talent et de
cœur. [Voyez un article de M. Sainte-Beuve dans la Revue des
Deux-Mondes, 1836, t. VIII, reproduit dans les Critiques et portraits,
t. IVj et la France
littér., t. III, p. 552.]
Guttinguer
[Ulric], fils d'Ulric Guttinguer,
député, tribun,
puis
directeur de la banque de Rouen, est né dans cette ville en
1785. Adonné avec ardeur, depuis l'âge de
vingt-cinq ans,
à la culture des lettres, M. Ulric Guttinguer a
soupiré
des vers charmants, pleins de grâce, de fraîcheur
et
d'abandon. Président de l'Académie de Rouen,
lié
d'amitié avec les chefs hardis de la croisade romantique, il
a
brillé parmi eux par l'élégance
rêveuse de
sa poésie. La
Muse française, recueil
publié sous
les auspices de MM. V. Hugo, A. de Vigny et Ém. Deschamps,
et
qui fut comme le miroir de ce temps de passion littéraire,
accueillit ses confidences élégiaques. En 1821,
il
réunit ces pièces dans ses Mélanges
poétiques, et publia successivement le roman
religieux
d'Arthur,
un recueil d'Élégies, des Fables, des Nouvelles,
les Deux
âges du poète, les Pensées et
impressions d'un
campagnard, et beaucoup de morceaux
détachés qui
révèlent tous un homme d'esprit, de talent et de
cœur. [Voyez un article de M. Sainte-Beuve dans la Revue des
Deux-Mondes, 1836, t. VIII, reproduit dans les Critiques et portraits,
t. IVj et la France
littér., t. III, p. 552.]1. — Recueil d'élégies, sans titre, imprimé chez Foumier, 1829, in-8,gr. papier. Distribué par l'auteur et non mis en vente.
2. — Arthur, roman. Paris, Renduel, 1836, 1 vol. in-8.
3. — Fables et méditations. Paris, Joubert, 1837, in-8 [3 fr.].
4. — Jumiéges. Rouen, Périaux, 1839, in-18 de 216 pag., avec 1 lith.et t frontispice. Vers et prose. Suivi de poésies diverses.
5. — Les Lilas de Courcelles, poésies. Saint-Germain, imp. de Beau, 1842, in-8 de 88 pages.
6. — Les Deux âges du poète. Paris, Charpentier, Fontaine et Dauvin, 1844, in-12 [3 fr. 50 c.].
7.
—
Pensées et
impressions d'un campagnard. Paris, Dauvin et Fontaine,
1847, in-12.
C'est un recueil fort spirituellement écrit d'articles
publiés dans divers journaux, et, entre autres, dans le
«
Corsaire.»
On doit encore
à M. Ulric
Guttinguer : La Source
divine. A S. A. R. Mgr le duc de Montpensier, le
jour de sa première communion 22 mai 1837 [en vers, 1837,
in-81;
— Le Pont de
Neuilly [en vers, 1837, in-8] ;
— Méditations
sur le saint temps de
carême
[poésies, 1838, in-12]; — Pallida Mors. A M.
Victor Hugo
[en vers, 1844, in-s] ; — Les Funérailles de
Charles
Nodier ; 29 janvier 1844 [en vers, 1844, in-8] .
Plusieurs pièces de vers de M. Guttinguer ont été mises en musique. L'une d'elles, La Suissesse au bord du lac, eut jadis un très grand succès.
Plusieurs pièces de vers de M. Guttinguer ont été mises en musique. L'une d'elles, La Suissesse au bord du lac, eut jadis un très grand succès.
Laurent QUEVILLY.
Sources
Un ami de Victor
Hugo, le poète romantique Ulric
Guttinguer (1787-1866) et
la Normandie, par le frère Jean-Pierre Ribaut
(Académie
de Rouen, séance du 24 Février 1990)
▲
Haut de page
