L'affaire du Homme ? Un long combat des Jumiégeois pour défendre leurs droits contre leur puissante abbaye puissante. Négociations, ventes, violences, recours juridiques, les villageois finirton-ils par obtenir gain de cause ? Tout commence en forêt de Jumièges, propriété de l'abbaye, outils capital de l'économie monacale. Nos ancêtres étaient les vassaux des moines et tenaient d'eux leur masure de bail en bail. En contrepartie, certains se faisaient domestiques à l'abbaye. Les uns à la cuisine, les autres la buanderie, d'autres encore gardaient la porterie. Il s'en trouvait encore qui soignaient les chevaux des Bénédictins, gardaient leurs cochons... Au rang de leurs privilèges, les religieux bénéficiaent d'un "droit de mortuaire" sur leurs vilains. Quand un habitant de Jumièges ou du Mesnil venait à décéder, nos cénobites s'attribuaient le tiers de ses biens et de ses meubles. D'ailleurs, nul ne pouvait signer un testament sans leur permission. Un droit confirmé par diverses sentances et encore un aveu rendu au roi en 1526 par l'abbé François de Fontenay.
 Admettant
le poids de
ces soumissions, les religieux consentirent à quelques
bontés
pour alléger leur domination sur leurs tenanciers. C'est ainsi
qu'ils leur accordèrent des
terres
communes pour servir de pâture. A
charge
toutefois pour eux de payer un sol par feu. A chaque automne, la saison
du panage, les moines
leur permirent de mener leurs porcs à la glandée,
Autrement dit de nourrir leurs cochons des glands tombés des
chênes de la forêt. Mais à condition que ce
soit "hors taillis". Seuls les bois de haute futaie de plus de dix ans
d'âge étaient en effet ouverts à cette tradition
rurale. Lorsque des arbres étaient abattus dans un triège
donné, on en interdisait l'accès durant une
décennie.
Admettant
le poids de
ces soumissions, les religieux consentirent à quelques
bontés
pour alléger leur domination sur leurs tenanciers. C'est ainsi
qu'ils leur accordèrent des
terres
communes pour servir de pâture. A
charge
toutefois pour eux de payer un sol par feu. A chaque automne, la saison
du panage, les moines
leur permirent de mener leurs porcs à la glandée,
Autrement dit de nourrir leurs cochons des glands tombés des
chênes de la forêt. Mais à condition que ce
soit "hors taillis". Seuls les bois de haute futaie de plus de dix ans
d'âge étaient en effet ouverts à cette tradition
rurale. Lorsque des arbres étaient abattus dans un triège
donné, on en interdisait l'accès durant une
décennie.
Or, il advint que l'on rasa d'un coup une majeure partie de la forêt. Alors, on ouvrit aux habitant les bois du Homme et de Braquetuit qui jusque là leur étaient défendus, le temps que la forêt repousse. Et il en faut du temps. Les années passant, tandis que la forêt retrouvait toute sa verdeur, les habitants finirent par considérer comme un droit définitif l'usage du Homme et du Braquetuit. Ce que contesta l'abbé de Jumièges, personnellement propriétaire de la forêt et bien décidé à revenir à l'usage antérieur...
La résistance s'organiseNous sommes le dimanche 6 novembre 1575. les trois cloches de Saint-Valentin sonnent à toute volée la fin de la grand messe. Le cimetière bruisse des murmures et bientôt des éclats de voix des paroissiens réunis. Il n'est question aujourd'hui que de défense des droits acquis. De tous les droits acquis. Et ceux du Homme et du Braquetuit en font partie.
Voici quelques mois qu'un nouvel abbé règne sur Jumièges. C'est Charles de Bourbon, l'archevêque de Rouen. Et il va voir de quel bois se chauffent les Jumiégeois. Les tabellions de la sergenterie royale de Saint-Joire vont prendre note à la volée des revendications. Ce sont Pierre Dufour et Pierre Douyère, son adjoint juré. Quant aux témoins désignés, Maître Nicolas Dupuis et Guillaume Lucas, prêtres de Jumièges, en feront office. Le clergé séculier prend donc le parti de ses ouailles contre la toute puissante abbaye. Il en sera souvent ainsi.
Les protestataires, au nombre desquels je me réjouis de reconnaître plusieurs membres de ma famille, vont nommer leurs procureurs, Jean Clérel du bourg, Gabriel Pinchard, Robert de Conihoult dit du Flac, Nicolas Boutart et Jean Busquet.
Ces cinq hommes sont mandatés pour défendre en toutes circonstances les droits des villageois: pâture, panage, bois, moute dans les moulins de la baronnie de Jumièges comme de Duclair…
Il s’agit aussi d'organiser la collecte des redevances liées à ces droits pour les remettre aux moines les frais de justice éventuels. On réunira ces sommes à l’issue des grands messes à venir.
Dufour et Douyère filent ensuite au Mesnil où ils trouvent des hommes tout aussi déterminés. Là, les témoins sont aussi les curés du cru : Maistres Bénard Bernardin et Robert Auber.
Jacques Tropinel versa deux écus sols pour ces actes qui préfigurent un peu les cahiers de doléance de la Révolution. Qui témoignent en tout cas d’une belle mobilisation, d’un exercice de démocratie locale.
Frès de Justice, les mots étaient lâchés. Cependant, on préféra manifestement éviter une procédure interminable. Un accord amiable fut plutôt recherché.
Première victoire
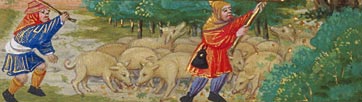
La forêt de Jumièges était jusque là le
domaine direct de l'abbé. Or, en 1579, elle passa entre
les mains des religieux. C'est avec eux que les villageois vont traiter
pour obtenir ce que l'abbé leur refusait.
Le vendredi 3 avril
1579, à l’abbaye, le chapitre des religieux se
réunit au son de la cloche sous l’autorité du
prieur, Toussaint de Marcelles. Menée par leurs procureurs,
malgré quelques absents, les délégations de
Jumièges et du Mesnil négocient avec les moines sous
l'œil du curé du Mesnil et de Noël Desmaret, de
Duclair. Et un accord est trouvé qui redonne aux habitants
le droit d’user des parcelles litigieuses du Homme et du
Braquetuit qui ont été bornées et dont ils ont
été évincés par l'abbé. Bien
entendu, il faudra s’acquitter de la rente foncière
seigneuriale. Douze deniers tournois par an et par feu payables
à Noël à la recette ordinaire de la baronnie. Ne
sont pas concernés par cette transaction les habitants
d’Heurteauville et de Port-Jumièges qui traitent à
part.
Les villageois, précise l’accord, pourront aussi conduire
leurs bêtes dans la grande forêt. Pour le chauffage, le
bois mort est sans amende. Sinon, pour chaque pied de hêtre,
petit ou grand, c’est cinq sols tournois. Interdit de toucher aux
chênes ! En 1519, le bailli de Rouen avait lourdement
condamné quelques paysans pour la chose.
Le droit de panage est lui aussi confirmé. Enfin, on
s’entend pour cesser tout procès. Maintenant, si un accod
est trouvé, les tensions vont demeurer. Aux yeux des moines, les
Jumiégeois vont usurper des droits, ce qui sera longtemps
toléré, jusqu'au jour où intervient une
réforme monastique. Mais donnons plutôt la parole
à un scribe de l’abbaye :
« Les habitans trouvant leur compte en cette
transaction, ils déclarèrent
que les religieux pouvoient user de leur forêt, ainsi
qu’ils avoient usé par le
passé.
« Ensuite
de cela, ils employèrent en la
plupart de leurs adveux leurs prétendues droictures de la
forest et ils y
adjoustèrent, par usurpation et innovation, des franchises
aux marchez de
Duler.
« Cela
leur fut toléré pendant quelque
temps, soit qu’une partie des anciens religieux fussent de
leurs parents, soit
pace que les recepveurs de la paroisse de Jumièges estoient
du nombre des
parroissiens, lesquels mesmes en diminuèrent les rentes.
« Mais la réforme de la congrégation de Saint-Maur ayant esté introduite en ce monastère, on blasma, dans la suite des temps, plus de 150 de leurs adveux par sentence du séneschal, ensuite de quoy beaucoup souscrivirent à leurs blasmes, et presque tous les autres les ont depuis reformez, ce qui suffit pour blasmer tous les autres. »
La première venteL'Affaire s’envenime en 1640. En juillet et encore en août, les services du roi Louis XIII, qui sont fort bien tenus, réclament des droits sur les pâtures du Homme et de Braquetuit. 2.500 livres pour Jumièges, 660 et les 2 sols pour livre pour le Mesnil. Les paysans ne peuvent payer. Ils supportent, arguent-ils, de lourdes charges depuis des années et n’en sont pas encore quittes. Se tournèrent-ils alors, comme le prétendent les religieux, vers les bourgeois de Rouen ? « Personne, ajoutent les moines, ne voulait avoir affaire à ces habitants que tout le monde connaissait pour les plus chicaneurs et les plus malicieux de la province. »
Alors,
nos malicieux, ils s’en vont
voir le procureur de l’abbaye. Tiens donc, celui-ci accepte
sans sourciller de
payer les redevances à leur place. Ce n’est pas
semble-t-il la première fois
que la grande maison dispense une aide financière aux
autochtones. En
compensation, le Bénédictin exige une partie des
terres communes qui
reviendront du coup à l’abbaye. L’équivalent
de 98 hectares, 6 ares
et 40 centiares précisément. Le
Homme est manifestement dans le lot. Bref, le 28 janvier 1641, on passe
un
premier contrat devant le tabellion royal de la sergenterie de
Saint-Joire, un
certain Dusaussay assisté de Jean Capelle. Le même
jour, les habitants
d’Heurteauville font la même démarche
pour céder quant à eux 122 hectares et 58
ares.
L’abbaye
commença à débourser plus de 2.000
livres pour cerner de fossés sa nouvelle acquisition,
honorer les 2.500 livres
de taxes réclamées, dédommager les
habitants d’arriérés.
Il
y
eut une nouvelle réunion des villageois
avec les tabellions le 8 décembre 1641 à laquelle
participaient Jacques Nepveu,
Noël Beaufils, Nicolas Cauvin pour Jumièges,
Estienne Duparc, Thomas Merre fils
Louis, les frères Simon et Pierre de Conihoult et Abraham
Thuillier pour le
Mesnil.
J’en note encore une autre qui, dix mois plus tard, le 19 octobre 1642, rassemble Jehan Dauzemont, Marin-François-Robert Alleaume, Richard Godallyer, Pierre Duparc, Pierre Marescot, Pierre Dumoustier, Valentin Marescot, Marin de Conihoult, Valentin Auger, Clément Boutard, Sandrin de Conihoult, tous du Mesnil. On ne sait quelle fut la nature de ces débats.
Les religieux cassent le contratUne
chose est sûre, réunie en chapitre, la
communauté bénédictine refusa de
ratifier le contrat passé par son procureur.
Pire, les religieux décident d’attaquer,
d’annuler les ventes. Au motif que les
sommes dues par les Jumiégeois sont plus fortes que
prévu. Ils on fait en
quelque sorte une fausse déclaration fiscale en minorant
l’étendue réelle de
leurs terres communes au moment de la vente. Et là,
près d’un an après, on en
demande 19.808 livres ! Ce que se refusent à payer
les moines. Alors, aux
habitants de s’en débrouiller ! Aux
moines, répondent ces derniers. Dialogue
de sourds. Les religieux demandent
aux paysans à être remboursés des fonds
engagés. Par la contrainte s’il le
faut. Non, répond encore la paroisse, les contrats ont
été passés dans les
règles. Il n’y a pas lieu de les annuler. Et puis
de toute façon, on n’a pas
d’argent…
Et voilà que le 20 octobre 1642, une sentence des requêtes à Rouen casse effectivement la vente. Cette fois, on réclame aux Jumiégeois de régler leurs dettes. Violences, débordements. Plusieurs mutins sont jetés en prison. Etat de crise dans la communauté villageoise qui fait d’abord appel, puis retire son recours. Et revient frapper aux portes du monastère...
Seconde venteCoup
de théâtre ! Neuf jours se sont
écoulés depuis le jugement de Rouen.
L’après-midi du mercredi 29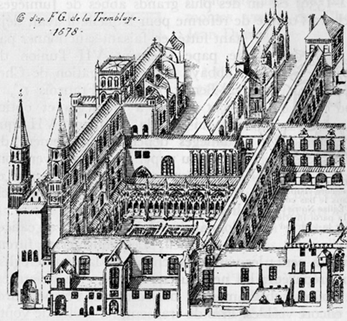 octobre
1642, son de
cloche à l’abbaye. Dussaussay
et Capelle viennent faire signer aux protagonistes…
exactement la même
transaction que celle de janvier 1641. Coup de
théâtre effectivement car les
religieux acceptent cette fois d’acquitter les sommes dues
par les cédants. Et
à quelque taux que ce soit !
L’explication de ce revirement ? La
communauté
bénédictine veut visiblement mettre terme au
conflit. Ses vassaux ont des
devoirs envers elle. Les accompliront-ils encore dans un tel
climat ? Les
habitants sont quant à eux prêts à
céder plus de terrain s’il le faut.
octobre
1642, son de
cloche à l’abbaye. Dussaussay
et Capelle viennent faire signer aux protagonistes…
exactement la même
transaction que celle de janvier 1641. Coup de
théâtre effectivement car les
religieux acceptent cette fois d’acquitter les sommes dues
par les cédants. Et
à quelque taux que ce soit !
L’explication de ce revirement ? La
communauté
bénédictine veut visiblement mettre terme au
conflit. Ses vassaux ont des
devoirs envers elle. Les accompliront-ils encore dans un tel
climat ? Les
habitants sont quant à eux prêts à
céder plus de terrain s’il le faut.
Alors
on s’accorde. Le village vend « six
vingt acres des pastures et communes ».
Cette étendue s’adosse aux
fossés de la forêt abbatiale. Elle est
bordée sur les deux côtés par les
pâtures communales. Enfin l’autre bout se heurte
aux fossés des prairies du
Conihout. Là, balisé par des bornes
posées le jour même, un chemin sera
aménagé
entre les deux par les religieux. Libre d’accès.
Pour
la deuxième fois, Thomas Défossé, le
bien
nommé, vint arpenter le terrain. Avec bien peu
d’exactitude si l’on en juge par
la suite de l’histoire.
L’aménagement
d’un autre chemin est également
prévu, de Jumièges au Mesnil,
vis-à-vis de la grande rue du Quesney. Il passera
à proximité du manoir
d’Agnès Sorel que desservira une sente pour la
commodité des habitants.
Les
moines se contentèrent de ce terrain quoi
qu’il fut estimé inférieur aux
« six vingt acres »
stipulés. En tout
cas, pas question d’en retrancher quoi que ce soit
s’il s’avère plus étendu.
Les paroissiens n’auront aucun droit là-dessus.
Sur les pâtures communes qui
leur restent, il leur faudra continuer à verser les
redevances habituelles.
Interdiction de les vendre, de les hypothéquer…
Ni d’y apporter quelque
changement sans le consentement des moines.
Alors,
c’est entendu, l’abbaye épongera les
taxes imposées, les reliquats antérieurs au
contrat et même les frais de
justice qui pourraient être réclamés
contre les habitants après toutes ces
péripéties. Aux moines de renégocier
maintenant la dette. Soit en leur nom.
Soit sous celui des habitants qui, dans ce cas, donneront procuration.
En
retour, on leur fournira copie des pièces comptables.
Mais
quels que soit les allégements obtenus,
pas question encore une fois de toucher à la parcelle. Si
jamais ils y
mettaient les pieds, alors, il leur faudrait rembourser en un seul
paiement
taxes, aménagements…. Les habitants, au nom aussi
de leurs descendants, doivent
encore garantir la parcelle « de tous
troubles et empêchements envers
et contre toutes personnes… »
Les témoins de cette réconciliation sont
Martin Dumelin, de Sainte-Marguerite-sur-Duclair et Jehan Fortin,
maîstre
plombier en la ville d’Evreux. Chez les villageois :
Jacques Lévesque,
Pierre Fécaut, André d’Anneville,
Noël Herpin, Gabriel Lévesque, Valentin
Porgueroult, Ysaac Boutard, Pierre Vastey fils Adrian, Jehan Appril,
autre
Valentin Vastey et Robert Amand, tous de Jumièges.
Le
jour de ce second contrat, assure la
chronique de l’abbaye, le procureur des religieux prit
immédiatement le chemin
de Paris pour obtenir réduction de la dette. Elle aurait
été ramenée à 1.200
livres. Les frais s’élevant quant à eux
à 3.150 et 15 sols. Le procureur s’en
acquitte sur le champ. « Pour faire
libérer les prisonniers. Ces
cœurs inflexibles et fermés à la
reconnaissance furent sensibles dans cette
occasion. On les vit tous humiliés devant leurs
bienfaiteurs, faire leur éloge
et publier que jamais vassaux n’avoient eu de si bons
seigneurs. Mais leur
gratitude dura peu… »
Le
18
décembre 1642, au Louvre, la chambre
royale valide ce nouveau contrat sous la signature d’un
certain Pottier. Il
précise : « Les
acquéreurs demeureront en paisible possession et
jouissance des choses à eux vendues, deffendant à
tous personnes de les y
troubler à peyne de tous deppens, dommaiges et
intérêts… »
Pierre
Pidou, receveur du roi à Paris, confesse
deux jours plus tard « avoir
reçu comptant des habitants des paroisses de Saint-Valentin
de Jumièges et de
Saint-Phillebert
de-Mesnil-soubs-Jumièges » la somme… de
6.300 livres !
Contradictoire avec les chiffres avancés un peu plus haut
par les chroniqueurs.
Mais bon, ils se trompent aussi sur la superficie exacte de la parcelle
vendue…
Un mois plus tard, le dimanche 25 janvier 1643, les paroissiens s’assemblent à nouveau sous l’if du cimetière, à l’issue de la grand messe. On compte là Jean Pellerin, Charles Bertin et d’autres dont le nom n’est pas précisé. Les témoins sont Vandrille Daust, Maîstre Jean Mauger, prêtre vicaire de Jumièges, Michel Nicolle, Louis Lamy et Robert Jullian, tous trois de Yainville. Sergent royal, Jacques Lhuillier leur lit les derniers développements de l’affaire à la requête des religieux. Le 2 février suivant, le même sergent recopie en l’écritoire de Saint-Joire des documents originaux à la requête de François d’Anneville, Jean Apvril, Jacques Lévesque, trésoriers de l’église de Jumièges. Après quoi, ces originaux furent rendus à l’abbaye.
Un procès, un crime !La
paix
semble donc signée. Mais bientôt, les
paroissiens assurent que les moines se sont emparés de plus
de terres que
convenu. S’ouvre cette fois le long procès tant
redouté. Il va durer trente
ans.
En
1645, les villageois poussent le seigneur
de la Mailleraye à faire valoir des droits sur
l’une des pâtures gardées par
les religieux. Le 22 décembre 1649, l’aristocrate
est condamné. En revanche les
moines sont autorisés à clore de
fossés leur terre. Tiens, on le croyait
déjà
fermé ! Mais bon. Le terrassement, toujours selon
la chronique, s’étale
sur six mois. Il ne faut pas une semaine pour que les habitants les
abattent.
On tente bien de reconstruire. Mais les Jumiégeois
détruisent la nuit ce qui se
fait le jour. Un soir, un moine attend de pied ferme les contestataires
nocturnes. On retrouva son corps au matin, sauvagement
mutilé. Dans les marais
se voit toujours la pierre de l’Homme
où il fut tué. On dit parfois
qu’il était flanqué ce
soir-là de soldats. Sans que leur nombre, leur
rôle ne
soit précisé. On ne découvrit jamais
les assassins. Ici, on sait se montrer
taiseux. « Tels étoient les
habitants de Jumièges et du Mesnil,
pesteront longtemps les Mauristes. Chicaneurs, ingrats,
rebelles et
homicides. Cette mort demeura néanmoins impunie
parce que les religieux ne
voulurent faire aucune démarche pour découvrir
les coupables et que les
paroissiens en corps vinrent implorer leur clémence avec la
plus basse
soumission et les serments les plus solennels de
fidélité pour l’avenir.»
Les disciples de saint Benoît finissent par clore définitivement leur terrain et assurent obtenir pour « ces pauvres habitants » des avantages fiscaux : réunion et versement de 50.000 livres pour résorber des arrérages de taille, diminution d’impôts, exemption du logement des gens de guerre… Gestes réels de bonté? En avril 1655, les villageois se révèleraient effectivement peu reconnaissants. Car ils traduisent encore en justice les moines qu'ils qualifient de « tyrans et oppresseurs ». Leur objectif : offrir aux moines l’honneur de régler les 1.168 livres dont ils ont été taxés par le Roi le 29 décembre 1652. Droits de nouveaux acquêts. « Quelle perfidie ! tonnent les moines, quelle ingratitude ! Ils le sentirent et s’humilièrent encore une fois devant leurs seigneurs qu’ils laissèrent assez tranquilles pendant quinze ans. »
Enfin gain de cause !Nouveau
coup de théâtre ! En 1667, une
ordonnance royale casse la transaction de 1642. Motifs
invoqués : les religieux
étaient incompétents à
aliéner leurs biens, les paroissiens étaient
quant à eux
sous les coups d’une prise de corps au moment de la vente. Et
puis on arpenta
les terrains en question. Constat : les moines ont bien
usurpé de la
surface. Exactement 51 hectares, 33 ares et 50 centiares ! Les
villageois
retrouvaient tous leurs biens sans être tenus de rembourser
les moines des
taxes versées par leurs soins. Celles-ci, estimait-on,
étant largement
compensées par les 51 hectares indûment
accaparés par l’abbaye durant trente
ans.
Alors
voilà. En 1671, les villageois abattirent une
dernière fois les fossés des
moines pour mener paître leurs vaches au Homme.
L’abbaye fit saisir les
bestiaux. Et puis, en décembre, le jugement de renvoi
favorable aux habitants
fut prononcé par M. de la Galissonnière,
conseiller du roi en la généralité de
Rouen. Pièce qui fut précieusement
enfermée en l’église paroissiale Saint
Valentin. Les moines menèrent des poursuites
jusqu’en 1701. En vain. Jusqu’à
leur départ de l’abbaye, ils clamèrent
leur bonne foi. Et leur version.
4 juin 1853. L’abbaye n’est déjà plus que ruines. Et pourtant, les habitants vont devoir encore faire valoir leurs droits, pièces à l’appui. C’était dans l’étude de Me Alfred Rigoult, à Duclair. Il y a là Jean-Pierre-Valentin Beauvet, propriétaire, ancien notaire, maire de Jmièges et deux élus, des cultivateurs, Jean-Pierre Deconihoult, et Sever-Aimable Boutard qui sera un jour le premier magistrat de la commune. Les témoins furent Auguste Antoine Richer, cultivateur et Nicolas François Lefèvre, sabotier. Et le clerc signa… Leclerc ! Tout était donc rentré dans l’ordre.
Laurent QUEVILLY.
AnnexeLes participants à l'assemblée de Jumièges de 1575
Les généalogistes du cru feront leur miel de ces noms : Jacques Oyn (Ouin) dit Portier, Philippe Havart, Naudin Clérel, Jean Boutart dit Carbonneau, Marin Levesque, Andrieu Tropinel, Jean Busquet, Gabriel Pinchart, Michel d’Anneville, Martin Dubost, Simon Busquet, Jacques Clérel de Conihoult, Martin Guilley, Thomas Mainberte, Valentin Mainberte, Andrieu Bourdon, Jean Bertin dit Godet, Richard Nobert, Noël Oyn, Jacques Tropinel fils, Louis-Marin Corvée, Nicolas Naze, Andrieu Tuvache, Jean Quesnot, Michel Virvaux, Richard Clérel, Jacques de Conihoult dit du Flac, Thomas Clérel, Raullon Beaufils, Vincent Coq, Marin Neveu dit Aignan, Pierre Mainberte, Marin Mainberte, Pierre Boutart de Conihout, Jean Cauvin, Pierre Cauvin, Raoullin Oyn.
Furent nommés procureurs Jean Clérel du bourg, Gabriel Pinchard, Robert
de Conihoult dit du
Flac, Nicolas Boutart et Jean Busquet.
Les participants du Mesnil-sous-Jumièges
Guillaume Neveu, Robin de Conihoult, Philibert Alleaume, Charles Tirant, Philipat Duparc, Jacques Lesergeant, Colin Desdes, Richard Pigny, Pierre Parent, Richard Barbenchon, Jean de Conihoult fils, Pierre-Robert Boutart, Jean Secart, Simon Turquet, Estienne Thuillier, Jean Lambert, Claude de Conihoult, Guillaume-François-Jean Cauchoys, Robert Duparc, Jacques Duparc, Valentin Delamare, Nicolas Philippe, Henry Fleury, Philippe Dumoustier, Robert Fleury, Nicolas Guenet, Guillaume Tuvache, Robert Clérel.
Eux aussi désignèrent leurs procureurs : Pierre de Conihoult fils Roger, Valentin Thuillier, Pierre de Conihoult fils Jacques.Les participants de Jumièges à la réunion capitulaire de 1579
Le vendredi 3 avril 1579, à l’abbaye, le chapitre des religieux se réunit au son de la cloche sous l’autorité du prieur, Toussaint de Marcelles. Il y a là les procureurs de la paroisse : Jean Buquet, Gabriel Pinchard, Robert de Conihoult dit du Flac. Désignés quatre ans plus tôt, Jean Clérel et Nicolas Boutart ne son pas présents. Dans la salle encore : Naudin Clérel, Pierre d’Anneville, Guillaume Boutard fils, Cardin-Richard Boutard dit Sonichon, Noël Hullin dit Bétoult, Jean Boutard, dit Boisselier, Pierre Amand Ambroise Duquesne, Laurent Neveu, Marin Corvée, Valentin Boutard, autre Guillaume Boutard fils, Jean-Cardin Nivels dit Fichon, Andrieu d’Anneville, Guillaume Secard, tous paroissiens de Jumièges.
La délégation du Mesnil
Les trois procureurs du Mesnil sont bien là, eux : Pierre de Conihoult fils Roger, Pierre de Conihoult fils Jacques, Valentin Thuillier l’aisné. Ils sont assistés de Robin Turquet, Guillaume Boutard, Guillaume Neveu, Nicolas Desdes, Philipat Duparc, Robert Alleaume, Jacques Sergeant dit Buchet, Pierre Mainberte, Jean Boutard, Valentin Delamare, Jean Lambert, Philipat Dumoustier. Les tabellions royaux sont encore là. A savoir Pierre Dufour et son adjoint Robert Gresset. Comme témoins, on a fait appel à Messire Bénard Bénardin, curé du Mesnil et Noël Desmaret, de Duclair.


