La
fondation
de l’abbaye de
Jumièges
par saint Philbert
remonte à
l’année
654.
Les marais
asséchés
; les landes défrichées;
le territoire
assaini, ensemencé,
planté
de
vignes ;
des chemins
créés,
des
carrières
ouvertes ;
d'immenses bâtiments
conventuels
construits au milieu
d'un vaste
enclos, à
l'abri derrière
des murailles
à tourelles
; trois
grandioses églises
édifiées,
dont la
richesse intérieure
et
la splendeur
architecturale
n'ont jamais
été
surpassées
depuis; une
colonie cénobitique
obéissant
à
la règle de Saint-Benoît
de Nursia,
qui ne
comptait aux premiers joins
que soixante-dix-sept
frères,
s'élevant bientôt
jusqu'au nombre de
neuf cents
moines de chœur et
quinze cents
frères
convers
ou de
travail ;
tels sont,
à
une
époque
bouleversée
par les
révolutions
de palais,
les principaux
résultats
obtenus en
moins de
quarante ans par
l'abbé
Philbert,
un des
saints les
plus vénérés
de l'Église,
un des
plus beaux
noms de
l'humanité.
Or, ce
ne fut
pas qu'à
l'aide de
ses propres
richesses, grandes à
la vérité, qu'avec
les ressources
fécondes
de sa charité,
de
son éloquence, de
son génie que le
fondateur put mener
à
bonne
fin une œuvre aussi
complète
dans son
ensemble , aussi
parfaite dans ses
détails.
Il eut deux
puissants appuis, la reine Bathilde
et saint
Ouen, archevêque
de Rouen:
celui-ci employa tout
son crédit
à
la
cour et
toute son
influence épiscopale
pour
faciliter la réalisation
des projets
de son
ami ;
celle-là
combla de
biens le
monastère,
soit en
concessions
de terres,
soit en
sommes d'argent, soit en
dons de
pierres précieuses
destinées
à
l'ornement
des églises.
Bathilde, que les
fidèles
reconnaissants
ont depuis
honorée
comme sainte, était
d'origine saxonne et
avait été
esclave.
Cherchait-elle
par ses
vertus et
par sa
générosité
à
se
faire pardonner
en quelque
sorte son
élévation
inouïe
?
Elle aussi,
plus tard,
descendit du trône, comme Clotilde
et Radegonde,
pour entrer
dans un
couvent ;
elle aussi
quitta la
couronne pour le
voile. Sans
doute elle
dut s'applaudir
d'avoir concouru
à
l'édification
et à
la splendeur
de ces
asyles alors
qu'elle alla
chercher a Chelles
l'hospitalité
claustrale et
l'oubli de
ses grandeurs
évanouies.
(1) Ouvrage
attribué
à
Dom Adrien Langlois
qui, prieur
à
l'abbaye
de Jumièges
au commencement
du XVIIe
siècle,
y introduisit
la réforme.
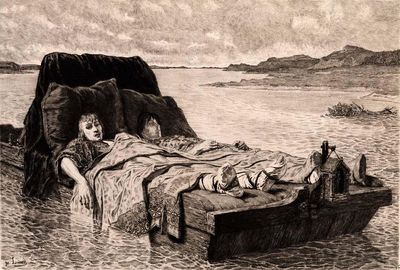
« C'est (dit l'auteur anonyme de cette précieuse chronique, cité par M. C.-A. Deshayes dans son Histoire de l’abbaye royale de Jumièges), c'est en ce sainct lieu où les deux fils aisnez de Clouis second du nom, et de saincte Baltilde, furent destinés du ciel pour faire leur pénitence. L’histoire rapporte comme ce (Ici seulement commence, à notre avis, la traduction du manuscrit original) Clouis ayant succédé fort ieune à la couronne de France, après le décez de son père Dagobert, espousa une étrangère, saxonne de nation, nommée Bauldour ou Baltide, que l'Eglise a canonizée au nombre des saincts, de laquelle Clouis eut cinq fils encore qu'aucuns chroniqueurs ayent teu les deux premiers nez, à cause de leur forfait qu'ils ont jugez indignes d'être révêlez à la postérité pour enfants du roy.
Quelques historiens rapportent qu'iceluy meu a de piété et dévotion d'aller visiter le sainct Sepulchre de N.S, et autres lieux de ta Terre Saincte, laissala régence du royaume à saincte Balthilde, son espouse, par le conseil et advis de ses princes et seigneurs. (Assemblée générale des arhimans et des leudes) Mais aussitost qu'il eut entrepris son voyage, accompaigné de la plus grande partie de sa noblesse qu'il avait choisie pour l'assister, plusieurs seigneurs indignez et malcontents de ce que le roy « les avoit laissés derrière, commencèrent à conspirer contre la royne, et en excitèrent plusieurs à sédition et révolte, disants qu'il n'appartenait pas qu'une femme et icelle estrangere commandast en France, voir mesme trouvèrent moyen de divertir et enlever ses deux fils aisnez de son obéissance.
La royne, advertie de la conspiration en donna soudain advis au roy son mary lequel ouïe cette nouvelle tourna bride en toute diligence. ce qu'ayant entendu les Conspirateurs firent amas de grandes armées soubs l'autorité de ses deux fils, pour lui empescher son retour et prendre le gouvernement du royaume, et de fait se présentèrent au champ de bataille contre lui ; mais Clouis assisté de ses fidèles (Le mot leude est souvent traduit eu latin par le mot fidelis ) serviteurs et se confiant à l'aide du Tout-Puissant, qui ne délaisse jamais les siens, mit en déroute cette multitude de rebelles, une grande partie demeurez sur la place, les autres, prenant la fuite, et les deux fils avec les principaux conspirateurs pris prisonniers et amenez à Paris, où le roy estant arrive fait assembler tout son conseil, princes et seigneurs (Nouvelle réunion de l'Assemblée générale.) pour donner judgement contre tous ces rebelles, lesquels furent condamnez à divers genres de mort, selon le démérite et qualité d'un chacun.
Mais pour le judgement de leurs princes supplièrent Sa Majesté les en vouloir excuser disants qu'il n'appartenoit qu'au roy et à la royne de châtier leurs enfants, que s'il ne lui plaisait les condamner lui-mesme, qu'il en donnast le judgement à la royne leur mère ; ce que le roy eust pour agréable. Alors la royne Balthilde, inspirée par l'esprit de Dieu, qui ne pouvoit laisser un tel excès impuni, aimant mieux que ses enfants fussent punis en leurs corps que d'estre réservez aux supplices éternels par une sévérité pitoyable et pour satisfaire aucunement à la justice divine, les déclara inhabiles à succéder à la couronne, et d'autant que la force et puissance corporelle qui leur avoit servi pour s'eslever contre leur père consiste aux nerfs ordonna qu'ils leur seroient coupez aux bras,
et ainsi rendus impotents, les feit admettre dans une petite nacelle ou bateau, avec vivres sur la rivière de Seine sans gouvernail ou aviron, assistés seulement d'un serviteur pour leur administrer leurs nécessitez ; remettant le tout à la providence et miséricorde de Dieu, sous la conduite duquel ce bateau dévalla tant sur la rivière de Seine qu'il parvint en Neustrie (aujourd’hui Normandie) et s'arresta au rivage d'un monastère appelé des anciens Gèmiéges, commencé à fonder par le roy Dagobert (La plupart des auteurs fixent la fondation de l'abbaye de Jumièges à l'année 651,c'est-a-dire sous Clovis II et non sous Dagobert. Il est cependant possible que ce soit ce dernier, un des plus grands princes de la dynastiemérovingienne qui ait, comme à Saint-Wandrille, autorisé à.Jumièges les premiers travaux, interrompus par sa mort ou par tout autre cause, maisrepris quelques années après et menés cette fois à bonne fin, grâce à la persévérance de saint Philbert et au concours de Bathilde et saintOuen) , dont sainct Philibert (qui on fut le premier abbé) en estant averti, les alla trouver accompaigné de ses religieux, sent quels ils estaient, la cause de un tel événement, et, admirant leur contenance et maintien tout auguste les a reçut gracieusement et les mena en son monastère, où par ses prières recouvrèrent leur santé, et furent instruits à la discipline monastique et vie spirituelle. Cependant, le roy et la royne, advertis de cet heureux succez, vindrent en toute diligence au monastère de Jumièges, où ils reçurent une grande consolation et contentement, et rendants actions de grâce à Dieu consentirent que le sainct propos et volonté de leurs enfants fust accompli, croyants fermement que Notre-Seigneur les ayoit destinez pour vivre et mourir dans ce sainct lieu, où leur grand-père Dagobert avoit déjà consacré son cœur et affection.
Et dès-lors le roy et la royne ayant esté ainsi présents à la vesture de leurs enfants voyants que leur delict étoit suffisamment satisfait et effacé par leur entrée en la religion y qui est comme un second baptesme, advisèrent à ne les priver de tout leur héritage et patrimoine, selon la rigueur de la sentence ; mais au lieu de leur droict et succession, donnèrent à ce monastère de grands privilèges et possessions pour amplifier le bien et l'augmenter de religieux. Et ainsi finirent ces deux enfants de France heureusement leurs jours en ce monastère qui à leur occasion. est appelé en la chronique de France l’abbaye des Énervés.
Telle
est cette
légende
dont
tous les
détails
s'accordent
si bien
entre eux
et avec
les faits
historiques.
Aussi sommes-nous
fort étonné
des doutes,
des contradictions,
des démentis
même
dont
elle a
été
l'objet.
M. E.-H.
Langlois surtout semble
lui avoir
porté
le
dernier coup
dans sa
notice lue
le 9
juin 1824
au sein
de la
Société
libre
d'Émulation
de Rouen.
Depuis cette
époque,
en
effet, elle
a définitivement
passé
pour
une fable
absurde, un événement
apocryphe, oeuvre de
quelque moine
ingénieux
qui l'inventa
au moyen-âge
dans le
dessein d'illustrer
par un
récit
brillant
le berceau
de son monastère.
Une voix pourtant, une
seule, celle
d'un poète
(Ulrich Guttinguer)
s'est élevée
depuis en
sa faveur,
mais pas
assez haut
pour la
réhabiliter,et les Énervés
de Jumièges
demeurent encore
sous le
coup du
jugement de M. Langlois.
Nous allons résumer
les principales
objections qu'on a
dirigées
coutre cette
légende
et
discuter
leur valeur
de bonne
foi. Nous
répondrons
ensuite aux
systèmes
par lesquels
on a
tenté
de
l'expliquer. Enfin
nous exposerons
succinctement les différentes
preuves
qui peuvent
établir
sa véracité
et lui
rendre le
caractère
authentique
auquel
elle a
droit à
nos yeux.
On a
prétendu
que Clovis
II étant
mort, suivant
certains historiens, à
vingt-deux ans (656),
et, suivant
d'autres, à vingt-six
(660), n'a
pu avoir
des enfants
en âge
de se
révolter contre lui. Cet
argument est facile à réfuter. La chronique
parle du
mécontentement
de quelques seigneurs
jaloux indignés
même
de
ce que
le roi
eût
confié le gouvernement
et la
tutelle de
ses enfants,
pendant son
absence à
la reine
Bathilde, à une femme d'origine étrangère,
à
une
saxonne, à une ancienne
esclave.
Or, on sait quelles étaient la fierté et la turbulence des Leudes et des Ahrimans dans les derniers temps mérovingiens. Il n'y a donc rien de surprenant à ce que quelques seigneurs aient été blessés d'un tel choix, qu'ils aient saisi ce prétexte pour en exciter plusieurs autres a sédition et révolte et tenter une révolution du palais.
Ainsi la
chronique attribue, ayant
tout, l'initiative et
là
poursuite
du complot à
quelques seigneurs et
non aux
jeunes princes,
qui n'avaient
guère
à
la mort
de leur
père
que
six à
sept ans,
ou au plus,
dix à
onze ans.
Les mécontents
commencèrent
donc à conspirer
contre la
reine voire
même
trouvèrent
moyen de
divertir et enlever
ses deux
fils aisnez
a de son obéissance.
C'est qu'ils
pensaient ôter
à Bathilde,
en
même
temps
que son
précieux
dépôt,
tout
crédit,
toute
autorité,
toute puissance. L'histoire mentionne nombre de
tentatives pareilles.
Sous
la Fronde,
les séditieux
n'ont-ils pas essayé
de s'emparer
de la
personne du jeune
roi Louis
XIV ?
Nous n'avons
pas à
faire ressortir davantage
l'analogie : autres
temps, autres intrigues; mais le
but est
le même.
L'autorité
semble être
attachée
à
la personne du
roi, et,
ici, une
fois maîtres
des fils
aînés
de
Clovis absent,
les rebelles
devaient avoir confiance
dans la
réussite de
leurs
projets.
Bathilde prévient
son
mari, qui
rebrousse chemin et
les révoltés
de leur
côté
assemblent
à
la
hâte
leurs
partisans «soubs l'authorité
de ses
deux fils
aisnez. »
On va
comprendre toute l'habileté de
cette conduite.
Clovis II était fou, et cette folie, qui avait provoqué son pèlerinage et qui datait du jour où sa main sacrilège avait profané les reliques de saint Denis, cette folie, dis-je, favorisait singulièrement les desseins des leudes s'ils réussissaient à mettre à leur tête ses deux fils aînés.
Les jeunes princes ne furent que des instruments ; il ne prêtèrent à la conspiration que le prestige de leur nom et de leur présence forcée et l'on conçoit pourtant l'efficacité de ce concours, quoique passif, dans une telle conjoncture. Si leur rôle avait été direct, sans doute l'Assemblée générale des Franks n'aurait pas récusé de les juger.
Qu'on
s'en tienne
à
la
lettre de
la chronique
des Énervés
et, une
fois la
part qu'ils
ont prise
à
ce
complot réduite
à
sa
véritable
importance,
on se préoccupera
alors beaucoup
moins de
leur âge.
Ainsi, quand
on a
objecté
l'âge
des Énervés
c'est qu'on
avait mal
compris, mal interprété
la légende que
nous avons
rapportée.
On ne saurait admettre,
dit-on encore,
qu'une mère,
une sainte, en
présence
de
deux enfants
coupables, ait prononcé un
arrêt
aussi
rigoureux, ait choisi
un supplice aussi
cruel. Ce
nouvel argument
n'est sérieux
aussi qu'en
apparence. Quelques mots
suffiront pour s'en
convaincre.
On se
rappelle la réponse
que fit
sainte Clotilde
à
Arcadiu. envoyé
vers elle
par ses
fils Clotaire
et Childebert.
Le messager,
porteur d'une
épée
et
de ciseaux,
lui demanda
ce qu'on
devait faire
de ses
petits-enfants
en la puissance de
leurs oncles
: «
J'aime mieux,
s'écria-t-elle,
les voir
morts que tondus !
»
A-t-on
jamais eu
l'idée,
à
cause de
cette imprudente
exclamation,
d'accuser
sainte Clotilde
d'avoir été
une mère
dénaturée, s'en est-on servi
pour attaquer
sa sainteté
?
N'est-il pas permis
de penser
qu'elle se
repentit bien vite
d'avoir prononcé
si légèrement,
si inconsidérément
cette
fière
parole,
qui devint
un arrêt terrible, une sentence
irréparable
?
Si d'ailleurs,
la reine
Bathilde a été
béatifiée,
ce
doit être
à
cause
de la
piété
de
ses dernières
années,
qu'elle
a passées
dans un
couvent; et, si elle eut
des remords,
ce fut,
il est
probable, dans les
derniers jours .de
son règne
où
ses
donations
aux monastères
sont considérables,
et, surtout, après qu'elle
fut descendue
du trône,
qu'elle songea
à
l'expiation.
On dit
encore :
«
Le
supplice était épouvantable !
»
A
coup sûr,
il l'était
moins que
la mort
violente des fils
de Clodomir,
Nous ferons,
en outre,
remarquer préalablement
qu'il
est impossible de
déterminer,
au juste,
la part
que les
Énervés
ont eue dans
cette révolte.
Quand ils
auraient été
âgés
de dix
à
onze ans, comme
il n'est
pas défendu
de le
supposer, sait-on bien
s'ils ne
se sont
pas associés
jusqu'à
un certain
point,
aux coupables
desseins des rebelles
une fois
qu'ils ont
été
en leur
pouvoir ! Dans ce siècle,
où
les conspirations des fils
contre leurs
pères
étaient
si fréquentes,
peut-on affirmer
que l'exemple
de leur
châtiment
fut inutile
tout-à-fait,
même
après celui des
véritables
coupables ?
Or, examinons
la nature
du supplice
qui leur
fut infligé.
Bathilde, dit la chronique, «
les déclara
inhabiles à
succéder
à
la couronne et
d'autant que la force
et puissance
corporelle qui leur
avoit servi
pour s'eslever
contre leur
père
consiste
aux
nerfs, ordonna
qu'ils leur
seroient coupez aux bras (
Il n'est
pas question
de l'énervation
des jarrets,
comme quelques
écrivains, amateurs
de supplices
raffinés,
l'ont complaisamment
répété).
C'était là un supplice ignominieux, qui les rayait de là famille royale et les rendait impropres a porter dorénavant les armes; mais il était, surtout aux yeux des barbares encore plus ignominieux que cruel et si l'on songe à la dureté des lois de cette époque à l'égard de fautes légères, on accordera que la tonsure seule eût été une punition insuffisante et non définitive, ce même siècle offrant plusieurs exemples de princes et de ministres auxquels fut infligée cette dégradation et qui, leurs cheveux repoussés, se sont empressés de sortir du cloître.
Si donc Bathilde aima mieux d'abord à voir ses enfants énervés aux bras que morts ou tondus, c'est sans doute qu'entre la mort, châtiment trop terrible, et la tonsure,peine trop faible, il n'y avait à choisir que ce moyen terme, leur cas, dans les mœurs inflexibles du temps pouvant bien passer, après tout, pour un crime de lèse-majesté et de parricide.
Il est
absurde,
ajoute-t-on, d'attribuer
à
un roi mérovingien
l'idée
d'un
pèlerinage
au Saint-Sépulcre,
en Terre-Sainte.
À
coup
sûr,
nous
ne prétendons
nullement répondre
à
fond à
cette objection,
attendu qu'à nos yeux aussi
une pareille
assertion a tout l'air d'un
anachronisme.
Néanmoins,
ne
pourrait-on
pas jusqu'à
un certain
point l'expliquer
?
Il existe
plusieurs versions de
cette légende.
Nous avons
préféré
la
plus courte,
à
cause
de sa
brièveté
d'abord, bien entendu,
et de
sa naïveté
ensuite. Mais,
de même que
celle qu'a
choisie
M, E.-H;
Langlois était la
traduction d'un texte
latin, de
même
la
nôtre
était
vraisemblablement
écrite
aussi
en latin
dans le
principe ; il est même fort à présumer
(et l'on
verra plus
bas sur
quoi nous
fondons cette
présomption)
que toutes
les autres
n'en sont
que des
amplifications
enjolivées
faites
à diverses
époques
et,
pour ce motif, offrant
plus de
prises à
la critique,
l'original latin serait
donc perdu
malheureusement.
Or, puisque dans les autres versions il s'est glissé une foule d'erreurs, pourquoi ne pas croire qu'il y avait simplement dans le texte primitif «Adlocasancta» (ce qui veut dire aussi bien à des lieux saints qu'aux Lieux-Saints ; mots que le traducteur aura mal interprétés en passant du sens général au sens particulier.
Du reste,
que ce soit au
Saint-Sépulcre
en la
Terre-Sainte
ou bien
à
un
saint sépulcre,
à
un
lieu saint
qu'on ait
fait entreprendre à
Clovis II
un pèlerinage
si brusquement
interrompu,
dans le
but d'expier
sa profanation
et d'obtenir
la guérison
de sa
folie intermittente
tout cela
no saurait
infirmer sérieusement
le
fait de
l’existence Énervés,
il vaut
mieux ne
voir là qu'une
erreur maladroite
du traducteur,
qu'une infidélité
de la
version et
rien de
plus.
Enfin, on
a conclu
la fausseté
de cette
légende
du
silence des
chroniqueurs
contemporains,
et surtout du
silence dé
l'auteur anonyme de
la vie
de saint Philbert
et de l'historien Guillaume
de Jumièges.
Qu'on se
souvienne des premiers
mots de
notre auteur.
«
Clovis,
dit-il eut cinq fils,
encore qu'aucuns chroniqueurs aient
teu les
deux premiers
nez, à cause de
leur forfait
qu'ils ont
jugez indignes
d'estre révélez
à
la
postérité
pour enfants
du roy,
»
On n'a pas trouvé cette explication satisfaisante. Mais, en général, de ce qu'un écrivain contemporain a passé sous silence certains événements, on doit douter, tout au plus, de leur authenticité ; on n'est jamais autorisé par son oubli à les nier formellement.
Combien de vérités historiques, d'ailleurs, méconnues ou ignorées jusqu'à ces derniers temps, ont enfin été remises au jour d'après des témoignages dignes de foi, quoique isolés ? Combien de faits acceptés aujourd'hui avaient pourtant été omis par la plupart des auteurs du temps, soit involontairement, soit à dessein, et pour des motifs dont ils ont emporté le secret ?
Il est incontestable que le VIIe siècle est celui de notre histoire dont les chroniques sont les plus obscures et les plus contradictoires, la chronologie même est incertaine. « C'est, dit M. Th, Lavallée, dans les légendes qu'est toute l'histoire de cette époque, tant les intérêts politiques sont absorbés par les intérêts religieux, Les rois, leurs cours et leurs intrigues n'intéressent qu'autant qu'ils sont mêlés aux affaires des moines, des évêques, des saints (Histoire des Français,T. 1 ,p.120. Voir Guizot, Histoire de la civilisation en France,T, II, lec.17.)
Outre
ces deux
autorités,
nous pourrions
en citer
une troisième
non moins
digne d'attention
et de
respect :
«
Les
hommes qui
les composèrent (Les Vies
des Saints)
il y
a treize
siècles,
dans le
seul but
d'exalter les vertus
religieuses,
ne se doutaient pas
qu'un jour
leurs
pieuses légendes
seraient les seuls
documents capables de
constater aux yeux
de la
science, l'état du
monde romain,
tourmenté.et
désolé
par
ses conquérants.
» Aug. Thierry, Lett. VII,
sur l'Histoire
de France,
P.97).
On doit donc
ne pas
rejeter
légèrement
ce fait
historique dont le
souvenir
fut pieusement
conservé
dans l'abbaye
de Jumièges.
La carrière
des Énervés
a été
courte,
et,
après
leur
châtiment
ils furent
vite oubliés
à
cause
de l'épouvantable
anarchie qui signala
quelques années plus
tard la
réapparition d'Ebroïn sur
la scène
politique. La tradition
cependant resta comme
ensevelie dans un
monastère.
Puis quand on l'exhuma, quand les moines voulurent perpétuer la mémoire des Énervés par des sculptures,par un tombeau, par des inscriptions, ils rencontrèrent plus d'adversaires que de partisans : il y eut plus de contradicteurs que d'apologistes. Les paroles de notre légendaire, citées plus haut, font, à n'en pas douter, allusion au silence du moine anonyme qui a écrit la vie do saint Philbert, sous l'abbé Cochin, son second successeur.
Nous ferons observer qu'il y avait à Jumièges sous le saint fondateur «un grand nombre d'évêques, de clercs et dé nobles laïques. » Or, le moine anonyme n'a pas non plus écrit la vie de ces évêques, de ces clercs et de ces nobles laïques, ni même indiqué leurs noms ou les circonstances qui les avaient amenés à Jumièges.
Ce ne fut, il
faut bien
se le
rappeler, que plus
tard que
les moines
cherchèrent
à
étendre
la réputation de
leurs maisons
en écrivant
tout ce
qui pouvait en
rehausser l'origine.
Vis-à-vis
de Guillaume
de Jumièges
l'objection
est facile
à
réfuter,
Il s'est
proposé,
avant tout,
d'écrire
les annales
des Normands
et de
leurs ducs,
et non pas l'histoire
d'un monastère.
Sans doute une
digression plus étendue
sur la
vie et
sur l'œuvre
de l'abbé
Philbert nous eût
offert beaucoup d'intérêt
;
niais eût-elle
été
bien
à
sa
place dans
son ouvrage.
II ne devait parler et n'a parlé qu'incidemment et très brièvement de Jumièges, de même que des autres abbayes de la province, il n'a consacré que cinq à six lignes à la fondation de son monastère. Voici du reste ce passage qu'on a eu en vue et l'on jugera s'il est vraiment de nature à rendre suspecte l'existence des Énervés : « Au temps de Clovis, roi des Francs, ce lieu fut bâti par le bienheureux Philbert avec l'assistance de la reine Bathilde a et il prit un tel développement qu'il en vint jusqu'à contenir neuf cents moines.
Un très grand nombre d'évêques, de clercs et de nubies laïques s'y retirèrent, dédaignant les pompes du siècle, afin de combattre pour le roi Christ et inclinèrent leur tête sous le joug le plus salutaire (Guillaume de Jumièges, 1,1. VI publié sous la direction de M. Guizot.).
Nous regrettons
cette discrétion,
cette concision,
cette sobriété de renseignements de
la part
de l'historien
Guillaume, mais nous
ne pouvons
l'en
blâmer
et l'existence
des Énervés
ne saurait,
être
sérieusement attaquée
à
cause
de son
silence à
leur égard.
Passons
à présent à l'examen des
systèmes qu'on a essayé de
substituer à notre chronique.
Dom Mabillon et dom Toussaint-Duplessis étaient
persuadés qu'elle reposait sur
un fait historique certain, dont la date aurait
été altérée, dont les noms
auraient été changés, puisqu'ils ont
tenté de l'expliquer d'après leurs
inductions personnelles.
Constatons
préalablement ceci : leur
incrédulité,
leur incertitude, leur embarras, portaient sur les personnages et sur
la date,
non sur l'événement.
Selon dom Mabillon, ce bénédictin d'une
érudition immense, une des lumières les
plus éclatantes de la Congrégation de Saint-Maur,
le tombeau attribué aux
enfants de Clovis II serait celui de Tassillon, duc de
Bavière, et de
Théodoric, son fils, que l'on dit avoir terminé
leurs jours dans un monastère,
peut-être celui de Jumièges, au commencement du Xe
siècle.
Or la pénitence à Jumièges de ces deux princes ne repose que sur de pures suppositions ingénieuses, séduisantes, il est vrai, mais qu'aucun texte, quel qu'il soit, ne corrobore; et d'un autre côté il n'a jamais non plus été question d'énervation à leur égard, tandis que la mort à Jumièges des Énervés, fils de Clovis, a été positivement affirmée par nombre de chroniqueurs qui, s'ils sont peu d'accord sur l'accessoire, ne se contredisent pas sur le point principal.
L'explication
fournie par dom Mabillon ne tient donc aucun compte des
détails
si curieux de
notre légende, détails d'une couleur historique
si
exacte. Outre cette faute
elle est inconciliable avec un. autre témoignage de valeur.
Le
tombeau des Énervés (Il est conservé
sous les
voûtes dans une ruine de) représente deux
jeunes princes âgés d'environ seize à
dix-sept ans,
et non pas le père et le
fils.
Il est vrai que lors de l'exhumation des restes qu'il recouvrait dans l'église Saint-Pierre, il y a quarante ans environ, M, Hodiesne, médecin, constata qu'ils appartenaient à deux sujets d'âge différent et cette circonstance décida M. Deshayes à se rallier à l'avis de M, E.-H. Langlois. Mais deux frères nés le même jour, qui ont fait profession ensemble, doivent-ils nécessairement, fatalement, mourir en même temps? Evidemment, non.
Dom Toussaint-Duplessis cherche davantage à concilier la
légende avec son
système. Mal-
heureusement son système ne s'appuie aussi que sur de pures
hypothèses, .il
suppose, en effet, la participation de deux fils de Carloman
(l'ainé des
enfants de Charles-Martel) dans la révolte de Gripon, leur
oncle, contre
Pépin-le-Bref ; il suppose leur énervation; il
suppose enfin leur tonsure, leur
pénitence et leur mort à Jumièges;
toutes hypothèses gratuites, sans base et
bien
plus improbables que les faits mentionnés dans
nôtre Chronique. Il faut avouer
que ce peu de « mots: Carloman vint en France en 753 et ses
enfants furent
tondus, il faut,
dis-je, avouer que ce
peu de mots est bien fécond pour « y avoir
trouvé tant de choses ou que le
microscope dont on s'est servi pour les découvrir a
extraordinairement grossi
les objets (Histoire manuscrite, p. 15). »
à des événements étrangers
et mal prouvés la vie absolument ignorée de deux
autres princes, N'était-il pas plus facile, plus simple,
plus raisonnable dé
procéder au rebours, c’est-à-dire
d'accepter préalablement l'existence des deux
fils de Clovis II, d'après notre Chronique, laquelle est
corroborée par divers
autres témoignages, par des inscriptions, par des
sculptures, par des
bas-reliefs, enfin par un tombeau monumental.
Un mot avant d'examiner particulièrement la nature et
l'importance de ces
témoignages.
Nous avons montré quels avaient été
les promoteurs, les vrais coupables de la
révolte, et dans quelles limites, en tout cas, il fallait
renfermer la participation des
jeunes princes. Par conséquent, la question d'âge
est à écarter. Or Clovis II
épousa Bathilde en 649, alors qu'il avait quinze ans (on
sait qu'au moyen-âge
les princes se mariaient très jeunes), et Thierry III,
l'aîné des trois fils
qui ont régné après leur
père, naquit en 651. Il y a donc entre le mariage et
cette naissance, un intervalle d'environ deux ans pendant lequel
là reine a pu
mettre au monde les deux jeunes princes. Les
Énervés sont donnés par la
légende
comme fils aînés et jumeaux, — Qu'y
a-t-il dans tout cela d'impossible et
d'absurde ? qu'y a-t-il dans tout cela d'invraisemblable ?
MM. les Religieux ont toujours honoré la mémoire
de Bathilde, qu'ils n'ont
cessé de regarder
comme leur bienfaitrice ; le monastère lui devait
« de grands privilèges et
possessions pour ampli fier le bien et l'augmenter do religieux, ce qui
explique la splendeur de ses églises et le
nombre des cénobites dans les commencements.
Les libéralités de cette reine, comme nous le
disions plus haut, ont un motif
naturel dans l'hospitalité si spontanément
offerte par l'abbé Philbert à ses
deux fils aînés, à qui il ouvrit son
abbaye comme un asile de paix, comme un lieu d'expiation, de
rédemption,
Bathilde n’aura-t-elle pas espéré en
outre que leur pénitence aiderait à la
guérison et au salut de Clovis II ?
Pro scelere proprio proquo labore patris
(en
poésie le mot labor signifie
quelques fois maladie).
A considérer le récit légendaire en
lui-même, sa simplicité, sa
naïveté, son
unité, sa brièveté, la
précision,
l'exactitude des mœurs qu'il dépeint, et qui n'ont
été bien connues
que de nos jours, grâce surtout aux savants travaux de MM,
Augustin Thierry, de
Sismondi, Guizot, ne sont-ce pas là autant de preuves de son
antiquité, et
partant, de sa véracité?
Dom
Toussaint-Duplessis faisait remonter le manuscrit
qu'il avait vu au chartrier de l'abbaye, à la fin du Xe
siècle, c'est-à-dire,
trois cents ans seulement après
l'événement, à l'époque
où les manuscrits
primitifs de Jumièges étaient encore
gardés à Haspres, en Flandre
(Cambrésis),
quand le monastère se relevait de ses ruines et qu'il
fallait de nouveau.créer
une bibliothèque. Dans ce même siècle,
Fulbert dit qu'il n'a écrit la vie de
saint Aicadre que d'après l'ordre des moines de
Jumièges, ses maîtres, et sur
des manuscrits auxquels il s'est borné à faire
quelques corrections. Les
interpolations de Fulbert ( Remarquez cette
parenthèse : « Le bateau
parvint
en Neustrie (aujourd'hui Normandie). » S'il n'y avait que des
additions de
cette nature à.reprocher à Fulbert, la chronique
des Énervés aurait été en
butte à moins d'attaques et sa défense serait
aujourd'hui plus facile) sont,
apparemment, devenues les incorrections qui ont
été si âprement signalées
dans
la légende des Énervés.
La vie exemplaire des moines au Xe siècle exclut tout
soupçon sur leur
sincérité. Enfin le
style sobre et la peinture fidèle des moeurs
mérovingiennes suffiraient, au
besoin à prouver que l'auteur vivait sous la
première race, ou au pis, fort peu
de temps après. Ajoutons que cette chronique est
à nos yeux un petit
chef-d'oeuvre de narration historique, La catastrophe des
Énervés offre tout
l'intérêt d'un drame : exposition,
péripéties, dénouement.
Il faut
avouer
qu'une pareille fiction serait celle d'un habile écrivain,
d’un adroit
imposteur, la vérité seule impose aussi
heureusement. Un moine d'imagination,
un copiste étourdi, contemporain des Croisades, peut avoir
commis le récit
romanesque cité,avec complaisance, par M. E.-H. Langlois. Un
écrivain sincère,
un témoin, un cénobite contemporain des faits a
seul pu saisir sur le vif les
détails dont on relève l'exactitude historique
à chaque ligne de notre
chronique.
Outre cet admirable récit, des statues, des bas-reliefs, des
fresques, des
distiques furent,
à diverses époques, placés en souvenir
des Énervés dans les églises et dans
le
cloître de l'abbaye de Jumièges (1).
(1)
D'après MM. les Religieux, voici
quelle serait l’éthymologie du mot
Jumièges:
Auctla refulgebat nongintis fratribus olim
Gemiéges ainsi appelé des deux fils
gémeaux de Clovis, brillait jadis par ses
neuf cents moines.
Nous n'insisterons que sur le monument le plus remarquable, un tombeau
placé au
milieu du
choeur de l'église Saint-Pierre et qui
représentait en relief deux jeunes
princes âgés, selon Tousaint-Duplessis d'environ
seize à dix-sept ans ; ils
étaient ceints d'un diadème et revêtus
de
longs manteaux parsemés de fleurs de lys d'or, avec une
agrafe de pierreries.
Selon M,
E.-H. Langlois, ces statues ne remonteraient guère qu'au
règne de saint Louis ; cela
est incontestable. Les quatre vers suivants, qui résument
tant bien que mal la légende, étaient
gravés autour du tombeau!
Patri bellica gens, bella salutis agens
Ad votum matris Bathitdis poenituere
Pro scelere propro, proque labore patris
(lVoici comment cette épitaphe a été traduite t
En l'honneur du Très-Haut reposent en ces lieux
Du valeureux Clovis les enfants belliqueux
Cette imitation en vers français si incomplète,
donne une Idée de l'infidélité
des versions en général.
Les autres légendes, que nous avons cru devoir écarter à cause de leurs longues digressions, de leurs erreurs, de leurs fréquente anachronismes, de leurs enjolivements romanesques datent aussi de cette époque. La version française citée par M, E.-H Langlois est du XVe siècle et l'original latin a été écrit, évidemment sous l'influence des Croisades. - Nous nous bornerons à ces rapprochements.
En effet, quoi qu'il en soit de cette inscription, notre intention est de la mentionner, non de la discuter, Comme toutes lès légendes, elle atteste le fait de l'existence des Énervés, c'est là le principal : l'accessoire, le détail, la forme ne peuvent venir qu'après et n'ont qu'une importance secondaire. Ces princes ont-ils existé, oui ou non ? Si nous avons réussi à le prouver, notre tâche est remplie ; la chronique, sauf quelques légères éliminations dont les copistes du moyen-âge sont responsables, doit être inévitablement admise.
Et puis, pourquoi ces bas-reliefs, ces statues, ces fresques, ces vers; pourquoi toutes ces légendes, pourquoi enfin ce tombeau, si dans l'esprit des moines l'histoire des Énervés était un mensonge? Il y a plus, d'ailleurs; cette conviction était bien sincère et de bon aloi, devait reposer sur des preuves incontestables puisqu'un anniversaire avait été institué en faveur des deux jeunes princes mérovingiens.
Cette cérémonie se célébrait chaque année le 18 mai, l'abbé était tenu d'officier en personne, le tombeau était couvert d'un drap mortuaire et l'on devait sonner toutes les cloches (Pro filiis Francorum pater abas celebrabit anniversarium » disaient d'anciennes pancartes de l’abbaye). Cette coutume, pieux témoignage de la reconnaissance de MM. les Religieux, était encore respectée dans le siècle dernier.—Ainsi, les moines auraient sciemment associé la religion pendant dix siècles, sans interruption, à une imposture historique, dont ils n'auraient pas été dupes eux-mêmes! Ils ont pu un instant douter par respect pour la science de. dom Mabillon, la plus grande autorité de la congrégation de Saint-Maur, mais ils n'ont pas cru devoir sacrifier à cette admiration pour son génie l'obit ordonné par la règle.
Les adversaires de notre chronique sont surtout à cheval sur cet argument: la fourbe des moines au moyen-âge. Comment concilieront-ils cette fourbe avec là rapacité, la soif de l'argent qu'ils reprochent aux mêmes moines ? les prières gratuites de ceux-ci, leur culte permanent, leur reconnaissance inaltérable s'expliquent mieux par leur conviction éclairée, inébranlable, s'appuyant sur une tradition fidèlement, sûrement gardée, et méritent toute l'attention de l'historien, du penseur qui étudie sans idée préconçue, sans esprit de parti, sans préjugé, et qui va droit a la recherche de la vérité.
En résumé, l'existence des Énervés est à nos yeux possible, vraisemblable, probable, certaine
enfin. Les absurdités, les contradictions qu'on a cru découvrir dans la chronique, résultent d'interprétations inintelligentes, incomplètes ou passionnées : on faisait, selon nous, fausse route en partant du tombeau et en côtoyant la légende.
Voici lé procédé de discussion qu'a suivi M. E.- H . Langlois! «Le tombeau est, à n'en pas douter, du XIIIe siècle, donc l'existence dés Énervés au VIe est un fait apocryphe. » Ce mode d'argumentation a-t-il besoin d'être réfuté ? Si on analyse notre chronique, on est étonné, répétons-le, de la sévère exactitude de ses détails historiques, et dès que la naissance des deux princes ne semble plus, physiquement parlant, un fait impossible, le lecteur désintéressé est irrésistiblement entraîné par la naïveté, le charme, et la sincérité du récit; c'est alors que le culte particulier des moines et les cérémonies de la religion viennent sanctionner le fait et affermir la croyance.
Si l'on nous demande à quoi bon une aussi longue discussion à propos d'un événement dont l'importance n'apparaît pas d'abord, nous répondrons que l'Histoire ne devant dédaigner aucun fait, la Chronique des Énervés peut, ainsi que d'autres récits, du même genre et du même siècle, jeter quelque lumière sur les mœurs des derniers Mérovingiens et, en particulier, sur la période obscure de 650 a 660 et sur les fréquentes révolutions du palais à cette époque. L'incertitude où l'on est sur la véritable date de la mort de Clovis II tombera peut-être devant son témoignage.
La folie de Clovis II et ses pèlerinages l'ayant fait disparaître absolument de la scène politique en 650, et la régence ayant appartenu dès-lors à la reine Bathilde, pourquoi quelques historiens n'auraient-ils pas cru à la mort de ce fantôme royal ? cet empire resté indivis pendant quatre années, cet héritage qu'on n'ose pas encore partager, ces désordres et cette rébellion, résultats d'une situation aussi embarrassée, la retraite forcée de Bathilde dans le couvent de Chelles en 660, ces événements n'ont d'explication raisonnable que si, adoptant les faits énoncés par notre Chronique, on reporte la mort de Clovis II à cette dernière date seulement.
Telles seraient, sans doute, les conséquences de l'admission de la Chronique des Énervés au nombre des.documents authentiques de l’histoire de France.
