Les énervés de Jumièges ! C'est ainsi que leurs voisins désignaient les habitants du cru. Enfants, on nous racontait que deux fils de roi, punis par leur père, avaient dérivé sur la Seine, les jarrets coupés, pour s'échouer à Jumièges où ils avaient depuis leur tombeau. Connue dans toute l'Europe, cette légende était-elle une belle supercherie...
 La
légende des énervés se situe
à
l'époque de Filibert, dans les années 660. Alors
que Clovis II, béni par sa
sainte femme Bathilde, entreprend de se rendre longuement en terre
sainte, le
gouvernement est confié à son fils
aîné sous la régence de la reine. Mais
voilà
que le dauphin s'oppose à sa mère, l'exclut du
conseil et entraîne avec lui son
cadet dans la révolte. Apprenant cela, Clovis rentre
précipitamment en France.
Ses fils lui opposent immédiatement une armée.
Alors, Clovis leur adresse un
messager de paix. Qui échappe de justesse à la
mort! Fort des prières de sa
vertueuse épouse, le roi finit par triompher des rebelles.
Il réunit ses leudes
qui n'osent porter jugement contre la lignée royale.
Bathilde, elle, a son idée:
"Je juge que doivent être affaiblies la force et la puissance
de leur
corps, puisqu'ils ont osé les employer contre le roi leur
père."
La
légende des énervés se situe
à
l'époque de Filibert, dans les années 660. Alors
que Clovis II, béni par sa
sainte femme Bathilde, entreprend de se rendre longuement en terre
sainte, le
gouvernement est confié à son fils
aîné sous la régence de la reine. Mais
voilà
que le dauphin s'oppose à sa mère, l'exclut du
conseil et entraîne avec lui son
cadet dans la révolte. Apprenant cela, Clovis rentre
précipitamment en France.
Ses fils lui opposent immédiatement une armée.
Alors, Clovis leur adresse un
messager de paix. Qui échappe de justesse à la
mort! Fort des prières de sa
vertueuse épouse, le roi finit par triompher des rebelles.
Il réunit ses leudes
qui n'osent porter jugement contre la lignée royale.
Bathilde, elle, a son idée:
"Je juge que doivent être affaiblies la force et la puissance
de leur
corps, puisqu'ils ont osé les employer contre le roi leur
père."
Le bateau fut
construit, des lits aménagés. Et les deux princes
embarquèrent en se signant
devant un grand concours de peuple. Ils
dérivèrent ainsi jusqu'en un lieu
appelé
Gemme. Filibert vint à eux et reconnut en leurs parures les
héritiers d'une
riche lignée. Il les conduisit jusqu'au moutier de Monsieur
Saint-Pierre pour
en faire de fidèles serviteurs de Dieu. Avertis, le roi et
la reine vinrent à
Jumièges, en agrandirent le monastère, lui
léguèrent des terres. Nombre de
seigneurs se firent moine tandis que les deux princes finirent leurs
jours ici
jusqu'à ce que "Notre
Seigneur reçust
leurs âmes en paradis".
Pure
légende ! Inepte roi
fainéant, Clovis est mort très jeune, 21 ans
peut-être, 26 tout au plus, un âge en tout cas
où ses enfants n'étaient pas en
mesure de se dresser contre lui. Pleutre, il ne si fit jamais
pèlerin en terre
sainte. Ses trois fils, Clotaire, Childéric et Thierry, ont
tour à tour régné
et n'ont jamais été moines, encore moins
énervés.
 Cette
histoire apparut en fait
bien plus tard, dans un
manuscrit du
XIIe siècle, sans doute pour justifier l'origine de biens
considérables
effectivement consentis par la reine Bathilde. Sous l'influence des
croisades,
on réécrit alors l'histoire pour mener tous ses
héros à Jérusalem. C'est dans
une vie de sainte Bathilde, rédigée en latin,
qu'apparaît le supplice des
Enervés: "Et lorsque les jeunes hommes eurent
été amenés devant leur
père, en présence de tous, elle ordonna qu'on
leur brûlât les nerfs des jarrets
avec des clous rougis au feu." Notons que les Annales de
Jumièges,
rédigées en 1225, on fait allusion à
un seul Enervé. Une fois supplicié, dit ce
récit, il fut directement enfermé à
Jumièges où il aurait fait don du quart de
ses biens. Une copie de ce texte fut grattée plus tard pour
mettre au nombre de
deux nos fameux Enervés. Voilà qui s'appelle faux
et usage de faux...
Cette
histoire apparut en fait
bien plus tard, dans un
manuscrit du
XIIe siècle, sans doute pour justifier l'origine de biens
considérables
effectivement consentis par la reine Bathilde. Sous l'influence des
croisades,
on réécrit alors l'histoire pour mener tous ses
héros à Jérusalem. C'est dans
une vie de sainte Bathilde, rédigée en latin,
qu'apparaît le supplice des
Enervés: "Et lorsque les jeunes hommes eurent
été amenés devant leur
père, en présence de tous, elle ordonna qu'on
leur brûlât les nerfs des jarrets
avec des clous rougis au feu." Notons que les Annales de
Jumièges,
rédigées en 1225, on fait allusion à
un seul Enervé. Une fois supplicié, dit ce
récit, il fut directement enfermé à
Jumièges où il aurait fait don du quart de
ses biens. Une copie de ce texte fut grattée plus tard pour
mettre au nombre de
deux nos fameux Enervés. Voilà qui s'appelle faux
et usage de faux...
Le corps des deux
princes,
affirme Dom
Cousin, auraient été retrouvés en
934 dans le chapitre et translatés en l'église
Notre Dame. Leur tombeau n'est
certainement pas de cette époque. Il jure même par
une erreur anachronique. Car
les deux princes sont vêtus d'habits ornés de
fleurs de lys. Or ces attributs
ne sont apparus qu'au XIIe. En étudiant de près
les motifs, on ne peut
qu'attribuer ces sculptures aux ciseaux d'un artiste du XIIIe. "En
sorte,
disait Hyacinthe Langlois, que ce monument n'a point donné
sujet à fable. Mais
la fable a donné sujet au monument." Pour
accréditer la légende, on fit
graver ce texte en latin :
Race belliqueuse et qui fit la guerre
Sur le désir de Bathilde ils se repentirent
Et pour leur propre crime et pour le mal causé à leur père.
|
|
|
Bel anachronisme !
L’abbaye est représentée ici telle
qu’elle n’était pas encore au temps de
Philibert… |
En l'église
Notre-Dame
étaient deux statues représentant le couple
royal.
Sur le socle de Clovis, un bas-relief montrait la barque à
la dérive et deux adolescents
recueillis. Sur celle de Bathilde, on le voir endosser l'habit
monastique. Au
XVe, un mystère fut composé sur ce
thème. Il est connu sous le nom de "Miracle
de Nostre Dame et de saincte Bauteuch, femme du roy Clodeveus qui, pour
la
rébellion de ses deux enfans, leur fist cuire les jambes,
dont depuis se
revertirent et devindrent religieux." 2.634 vers ! Trente-six
personnages !
Au XVIe siècle, on réalise une fresque de cette histoire pour le nouveau cloître de cette abbaye appelée parfois, dans la chronique de France l'abbaye des Enervés. Elle représente l'arrivée des deux princes. Sur la porte du même cloître, on va jusqu'à attribuer aux Enervés le nom même de Jumièges :
Gemegia
ex natis Clodovici gemellis
Aueta
refulgebat nongentis fratibus olim
Ronsard, en
1562,
évoque cette
épopée dans le chant IV de sa Franciade
pour amener le jeune lecteur à cette morale: ne jamais rien
faire à l'encontre
de ses parents. Quant aux moines, ils poussent leur conviction
jusqu'à fêter
chaque 18 mars l'anniversaire des Enervés. Ce
jour-là, c'est l'abbé en personne
qui officie.
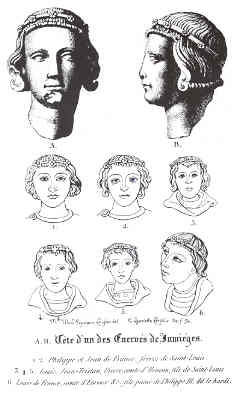
Qui étaient vraiment
ces
énervés? Voilà qui opposa plusieurs
érudits.
La
thèse Langlois
En publiant "Apologie pour l'histoire des deux fils aînés de Clovis II, énervés et moines de Jumièges", Don Adrien Langlois, prieur de l'abbaye en 1615, opte "naïvement" pour les fils de Clovis II qu'il handicape du reste des bras. En fait, c'est lui qui exhume des limbes de l'oubli cette fameuse légende. Dans quel but? Rappeler aux donateurs potentiels, à Louis XIII lui-même, que Jumièges a la faveur de la couronne depuis des temps immémoriaux. Et ça marche. Les dons affluent...
Langlois
trouva dans le poète Ulric Guttinguer un partisan convaincu.
Pour lui, la légende
est bien attestée par d'anciens chroniqueurs,
excepté Guillaume de Jumièges. Il
s'appuie notamment sur le Miracle de sainte Bauteuch qui, à
ses yeux, ne peut
avoir été inventé de toutes
pièces.
La
thèse Duplessis
Le
père Duplessis,
lui,
échafaude une tout autre version en remontant au
père de Charlemagne. Pépin le Bref avait pour
frère Carloman. Ce dernier aurait
vu ses deux fils se dresser contre lui avec l'aide de leur oncle
Gripon. Gripon
a bien existé, il s'est bien révolté
contre Carloman. Mais l'histoire n'a pas
retenu l'énervement de ses neveux. Si ce n'est qu'ils
entrèrent en religion...
 La
thèse Mabillon
La
thèse Mabillon
Il fallut attendre Mabillon pour approcher peut-être la vérité. Sa thèse? Sous Charlemagne, deux de ses opposants, Tassilion, Duc de Bavières, et son fils Théodon, moururent à Jumièges au terme d'un exil monastique. Ils avaient cherché à soulever les Huns contre l'empereur. Voilà qui inspira à ses yeux la légende des énervés. Et c'est à l'emplacement de leur sépulture, datant des années 800, que l'on érigea au XIIIe siècle le faux tombeau des énervés. En 1883, Eugénie-Caroline Saffray, dame de Chervet, publie sous le pseudonyme de Raoul de Navery Les mystères de Jumièges, sur le thème des Enervés. Elle réfute la thèse Langlois mais aussi Mabillon puisque pour elle, Tassillon est mort en Bavière. Alors, elle épouse la thèse Duplessis. Reste que lorsque l'on creusa sous le tombeau des énervés, on découvrit deux squelettes, dont celui d'un vieillard, les pieds tournés vers l'Est, ce qui indique des séculiers.
La thèse SavalleEnfant de Jumièges, Emile Savalle rejoint Langlois et Guttinguer et donne pour certaine la légende. Il est appuyé en cela par Julien Loth, l'homme qui publia les manuscrits inédits de l''histoire de l'abbaye de Jumièges. Lire sa thèse:

Autres
hypothèses...
 Quand,
en 1760, un moine écrit
la chronique de Jumièges, il avance cette
hypothèse. Deux princes ont certes été
enterrés à Jumièges. Mais le terme
énervés ne suppose pas qu'on leur
coupât les jarrets. Simplement, ils furent débilités,
autrement dit tondus, inaptes à porter la couronne : debilitare
quasi nervos
auferre...
Quand,
en 1760, un moine écrit
la chronique de Jumièges, il avance cette
hypothèse. Deux princes ont certes été
enterrés à Jumièges. Mais le terme
énervés ne suppose pas qu'on leur
coupât les jarrets. Simplement, ils furent débilités,
autrement dit tondus, inaptes à porter la couronne : debilitare
quasi nervos
auferre...
Maintenant,
une autre influence est encore
possible, c'est la révolte de
Robert et Henri, fils de Robert Le Pieux contre leur mère,
la reine Constance.
C'était en 1030. Henri eut alors des
libéralités pour Jumièges.
Pour Hyacinthe Langlois, cette légende a été fabriquée sous Richard-Cœur-de-Lion ou de Jean-sans-Terre. Aucune trace antérieure!
Le tombeau des Enervés disparut sous les gravats de 1793. On le retrouva mutilé, dans les années 1830. Il portait encore des traces de couleur or et azur.
Le romantisme du XIXe siècle s'empara de cette légende pour la populariser jusqu'en Amérique. Et faire connaître ainsi Jumièges un peu partout. C'est en 1838 que E. Frère exhuma de la bibliothèque nationale le Miracle de sainte Bauteuche alors que Hyacinthe Langlois consacre à la légende un brillant essai.
L'affaire des tableauxEn 1869, le peintre Gabriel Martin remporta le prix Bouctot pour une toile intitulée Les énevés de Jumièges. Elle fut longtemps accrochée à l'hôtel des Sociétés savantes de Rouen, rue Beauvoisine. Elle est depuis 2009 en dépôt au musée des Beaux-Arts.
"La
parole a ensuite été donnée
à M. Decorde,
pour lire, au nom de M. Hellis, le rapport
présenté par
la Commission chargée de juger le concours relatif au Prix
Bouctot.
"Ce prix devait
être
décerné à la meilleure oeuvre d'art,
peinture,
sculpture ou gravure, dont le sujet serait puisé dans
l'Histoire
de la Normandie. Un seul tableau avait été
envoyé.
Il représentait Les Énervés de
Jumiéges,
sujet qui rentrait complètement dans les conditions du
programme. Conformément au rapport
présenté par la
Commission, l'Académie a été d'avis de
décerner le prix à l'auteur de ce tableau. C'est
un jeune
peintre, M. Gabriel Martin, né à Rouen, demeurant
à Paris, rue de Madame, n° 52.
"M. Martin,
présent à
la séance, est venu, à l'appel de son nom,
recevoir ce
prix des mains de M. le Président. Les applaudissements qui
ont
accueilli le lauréat, s'adressaient en même temps
à
son oeuvre qui décorait là salle dans laquelle
l'Académie tenait sa séance."
Le tombeau des
Enervés, Le Musée universel, 1857.
En 1911, Martin écrira au maire de Rouen : « À la fin de ma carrière, je serais heureux d’offrir à ma ville natale mon tableau des Énervés. J’espère que la ville voudra bien accepter cette offre d’un de ses concitoyens. » En 2009, le musée des Beaux-arts récupère le tableau, remisé dans un local d’entretien à l’Hôtel des Sociétés savantes, rue Beauvoisine. Restauré grâce à la famille Martin, il sera exposé du 13 septembre au 6 janvier 2019.
Mais c'est surtout la toile d'Evariste Luminais qui est passée à la postérité. On doit même dire LES toiles. L’une, conservée aujourd’hui en Australie, fut exposée au Salon de 1880. L’autre est un fleuron du musée des Beaux-Arts de Rouen. On compte aussi une étude où apparaît un troisième personnage, assis en pleurs à l'avant de l'esquif.
Des amis, connaissant ma passion pour Jumièges, me dirent un jour avoir été surpris de découvrir le tableau des Enervés à Sydney. Plus de cent ans plus tôt, on exprimait déjà le même étonnement. Voici un article du Matin. Il est daté du 8 juin 1889.
L'interview de Luminais On
sait
que, d'après les lois et conventions internationales qui
règlent la propriété artistique,
aucune
reproduction d'un tableau vendu, sauf stipulations contraires, ne peut
être faite sans le consentement de la personne devenue
propriétaire du sujet traité.
On
sait
que, d'après les lois et conventions internationales qui
règlent la propriété artistique,
aucune
reproduction d'un tableau vendu, sauf stipulations contraires, ne peut
être faite sans le consentement de la personne devenue
propriétaire du sujet traité.
Ces
quelques mots nous
semblent utiles pour expliquer l'étonnement d'un voyageur
visitant l'exposition
des
beaux-arts, au
Champ-de-Mars « C'est étonnant,
s'écria-t-il devant
plusieurs personnes, je vois ici deux tableaux que j'ai
déjà vus au musée de Sydney, en
Australie; l'un,
les Enevés de Jumièges, de M. Luminais, l'autre,
Les
derniers moments de Chlodobert, de M. Maignan Quel est ce
mystère ? Où se trouvent les originaux,
à Paris ou
à Sydney? Les Australiens se croient les seuls
propriétaires des originaux ! Est-ce qu'ils se tromperaient?
»
On
fit cercle autour du
voyageur, qui disparu bientôt en faisant d'autres
commentaires haute
voix.
Averti
de l'incident,
nous nous fîmes un devoir de nous procurer de plus amples
renseignements.
Nous
apprîmes
Que le voyageur
qui s'était ainsi exprimé, causant une
certaine
émotion parmi les personnes présentes, est un
professeur
à San-Francisco, M. D. qui avait visité
dernièrement lesprincipales villes de l'Australie. M. D.
était descendu à l'hôtel de Gibraltar,
rue
Saint-Hyacinthe.
Hier,
nous nous
présentâmes à cet hôtel, mais
il nous fut
répondu que M. D. venait de partir pour Londres,
où
il doit séjourner quelque temps.
Caricature parue dans le
Charivari du 1er mai 1880
Désireux
d'éclaircir ce
mystère, nous nous présentâmes chez M.
Maignan, 1,
rue de La Bruyère mais M. Maignan était parti
pour la
campagne.
Nous avons eu la bonne
fortune de rencontrer M. Luminais, il son domicile, boulevard Lannes.
M. Luminais se met entièrement à notre disposition. Nous lui expliquons le but de notre visite.
Par ce temps de contrefaçon littéraire et artistique, disons-nous, il ne serait pas impossible qu'on ait vendu au musée de Sydney une contre-façon, une copie de votre tableau si remarqué au Salon de 1880. Renseignez-nous à cet égard.
Il est parfaitement exact, nous répond M. Luminais, que j'ai vendu au musée de Sidney mon tableau Les Enervés de Jumièges, qui a figuré au Salon de 1880.
Alors?
|
||||||||||||||
Ce n'est pas, à proprement parler, une reproduction que j'ai faite; je le répète, il y a des différences sensibles entre le tableau que j'ai vendu à Sydney et celui que je viens d'exposer.
Nous n'insistons pas.
Nous nous
retirons on emportant la conviction que cet incident ne sera pas sans
causer quelque émoi ; nous assisterons sans doute
à un
débat des plus intéressants au point de vue de la
propriété artistique.
Flaubert
lui-même, au
milieu des ruines de
Jumièges, s’était juré
d’écrire leur histoire. Ce qui ne resta
qu’un projet. Mais mois
d’un an
avant sa mort, le père de Madame Bovary s’en
confiait encore à Marxime du Camp.

Jean Hugo (1894-1984) Gouache
intitulée Les Enervés de Jumièges (9 x
13.5 cm) annotée au dos d'un
texte tiré de La Franciade de Pierre de Ronsard
Simone de Beauvoir, alors professeur à Rouen, raconte dans La Force de l'âge : "Je tombai en arrêt devant un tableau dont j'avais vu, enfant, une reproduction sur la couverture du Petit Français illustré et qui m'avait fait grande impression: les Énervés de Jumièges. J'avais été troublée par le paradoxe du mot énervé, pris d'ailleurs dans un sens impropre puisqu'on avait en fait tranché les tendons des deux moribonds. Ils gisaient côte à côte sur une barque plate, leur inertie imitait la béatitude alors que, torturés par la soif et la faim, ils glissaient au fil de l'au vers une fin affreuse. Peu m'importait que la peinture fût détestable; je suis restée longtemps sensible à la calme horreur qu'elle évoquait."
Dans son discours de réception à l'Académie française, en 1960, Henry Troyat fait allusion aux Enervés. Ils inpirèrent aussi Simone de Beauvoir, Guibert, Salvador Dali qui vient à Rouen, le 4 décembre 1967, pour voir ce chef d'œuvre de l'art pompier. En 2018, à l'occasion de la sortie du nouveau dictionnaire Robert, Jean-Noël Jeanneney eut cette superbe sortie dans les colonnes du Figaro : « J'ai toujours été frappé de l'évolution du mot “ énervé ”, qui vient des énervés de Jumièges. Autrefois, cela voulait dire qu'ils n'avaient plus de nerf, qu'ils étaient devenus une sorte de flanelle molle; aujourd'hui, cela a une tout autre signification.»
|
|
||
|
Une
baigneuse de Renoir éclabousse les Enervés.
Un clin d'œil de la Normandie impressionniste |
Sacré
travail de mise en scène ! Et de recherche d''accessoires. Une reconstitution photographique par l'association A l'ail. |
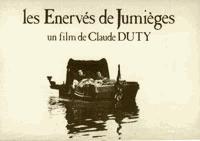
On retrouvera le tableau au XXe siècle reproduit à l'intérieur d'un album d'Alain Souchon, "C'est déjà ça", accompagnée de ce commentaire: "Plus de nerf, la belle vie...".
En 1986, Claude Duty en fit un court-métrage onirique. Superbe.
Bref, supercherie ou non, la légende entretenue par les moines fut un joli coup du pub. Elle n'a pas fini de faire ses effets...
Laurent QUEVILLY.

Durement
châtiés de leur terrible faute,
Les deux fils de Clovis, énervés par le feu,
Blêmes, veules, brisés, sont couchés
côte à côte
Dans un bateau qui vogue « à la garde de Dieu
».
Entre ses bords déserts la Seine solennelle
Emporte lentement ce funèbre convoi.
On vont-ils ? Nul ne sait. Au fond de leur prunelle
Flottent l'hébétement, la souffrance et l'effroi.
A Jumièges,
enfin, la barque touche lerre.
On accourt, on les sauve, et des Religieux
Sous les arceaux bénis de leur saint monastèr e
Offrent à ces martyrs un asile pieux.
Car Dieu recueille ceux que le monde abandonne ;
Aux humaines douleurs il daigne compatir :
Il n'est crime si grand qu'un jour il ne pardonne
A qui possède en soi la fleur du repentir.
ADRIEN DÉZAMY.

E.-Hyacinthe Langlois, Essai sur les énervés de Jumièges, 1838, Edouard Frère, Rouen.
Jumièges, Ulric Guttinguer, 1839, Nicétas Periaux, Rouen.
Savalle, Dissertation sur les Enervés de Jumièges
Le Matin, 8 juin 1889.
Raoul de Navary, Les Mystères de Jumièges, 1883, Paris, Delagrave.
G. Huet, La légende des énervés de Jumièges, Revue de l'école des chartes, 1916.
Chanoine Jouen, Jumièges, 1954, Lecerf, Rouen.
Congrès scientifique du XIIIe centenaire, Lecerf, 1955.
Dominique Bussillet, Les Enervés de Jumièges, Cahiers du temps, 2007.
Châteaux et ruines de France, Alexandre de Lavergne, 1845, illus. Théodore Frère.
Le Musée universel, 1857-58.








